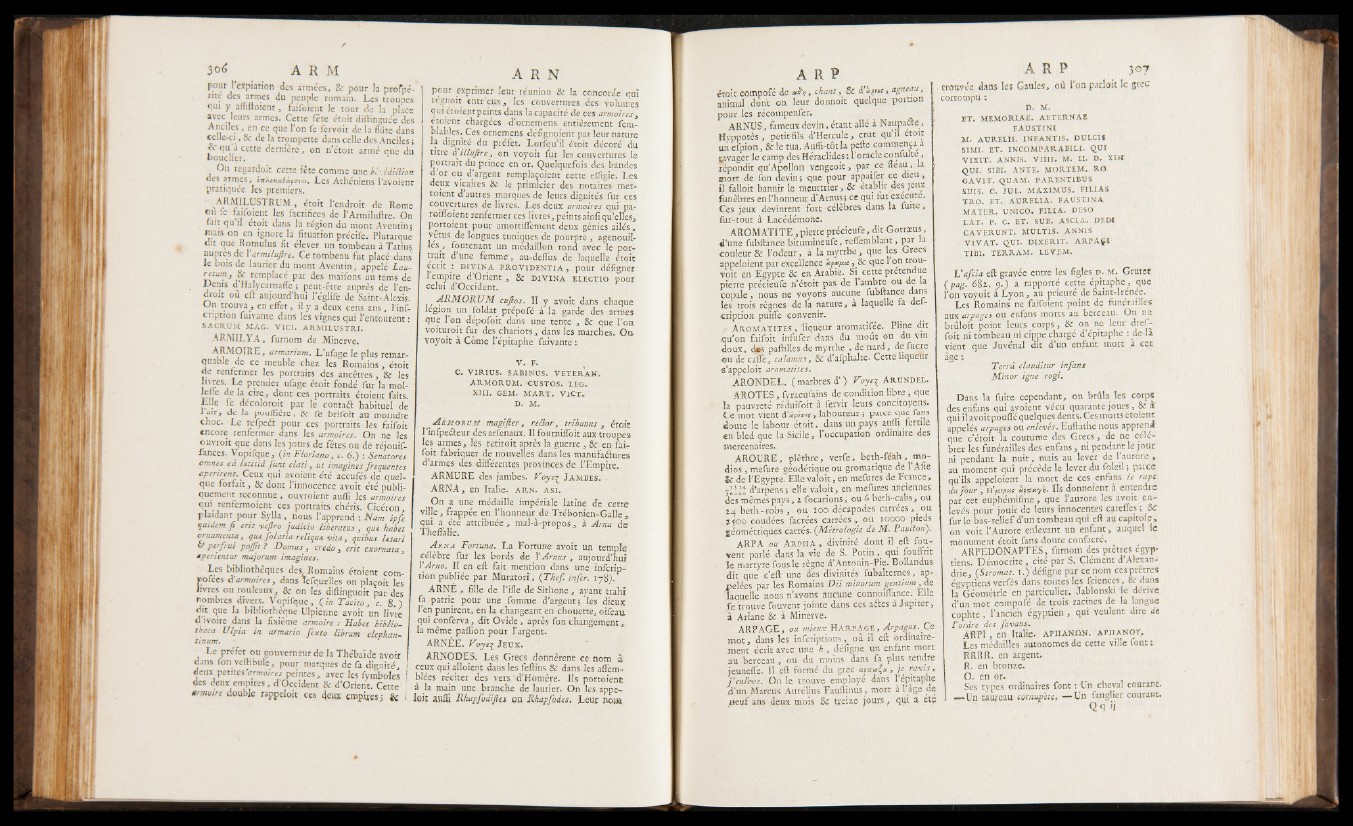
3 ° 6 A R M
pour l'expiation des armées, & pour la profpé-
rite des armes du peuple romain. Les troupes
qui y afliftoient, faifoient le tour de la place
ayec leurs armes. Cette fête étoit diftinguée des
Anales , en ce que Ton fe fervoit de la flûte dans
celle-cii, & de la trompette dans celle des Anciles j
& q u ’ à cette dernière, on n’ étoit armé que du
bouclier.
On regardoit cette fête comme une baJdiciion
des armes j bn\ox.u&c&f<riov. Les Athéniens l’avoient
pratiquée les premiers.
ARMILUSTRUM, étoit l ’endroit de Rome
ou fe faifoient les facrifices de l’Armiluftre. On
fait qu il etoit dans la région du mont Àventin j
mais on en ignore là fituation précife. Plutarque
dit que Romulus fit élever un tombeau à Tatius
auprès de 1 armiluftre. Ce tombeau fut placé dans
Je bois de laurier du mont Aventin, appelé Lau-
retiimj & remplacé par des maifons au tems de
Denis d’Halycarnaffe 5 peut-être auprès de l’endroit
ou eft aujourd hui l’églife de Saint-Alexis.
On trouva, en effet , il y a deux cens ans , l ’inf-
cription fuivante dans les vignes qui l’entourent :
SACRUM MAC. VICI. ARMILUSTRI.
ARMILYAj furnom de Minerve.
ARMOIRE y armarium. L ’ ufage le plus remarquable
de ce meuble chez les Romains, étoit
J e renfermer les portraits des ancêtres, & les
Lvres. Le premier ufage étoit fondé fur la mol-
r n a ,c*re* ^°nt ces portraits étoient faits.
Elle fe décolorait par le contait habituel de
J air, de la pouffière, & fe brifoit au moindre
choc. L e refpeét pour ces portraits les faifoit
encore renfermer dans les armoires. On ne les
ouvrait que dans les jours de fêtes ou dé réjouif-
fances. Vopifque, (in Floriano, c. 6 .) : Senatores
omnes ea l&titià Jitnt elati, ut imagines frequentes
apcrïrent. Ceux qui avoient été accufés de quelque
forfait, & dont l’innocence avoit été publiquement
reconnue, ouvraient auffi les armoires
qui renfermoient ces portraits chéris. Cicéron,
plaidant pour Sylla, nous l’apprend : Nam ipfe
qutdem f i erit veftro judicio liberatus , que. habet
ornamenta , que folatia relique vite, quïbus letari
& perfrui pojfit ? Doimis, credo , erit exomata,
apcrientur majorum imagines.
Les bibliothèques des Romains étoient comp
oses à'armoires, dans Tefquelles on plaçoit les
livres ou rouleaux, & on les diftinguoit par des
nombres divers. Vopifque, ( in Taeito, c. 8 .)
dit que la bibliothèque Ulpienne avoit un livre
à ivoire dans la fixième armoire : Habet biblio-
theca Vlpia in armario fexto librum elephan-
tinum.
Le préfet ou gouverneur de la Thébaïde avoit
dans fon Yeftibulè, pour marques de fa dignité, i
deux petites 'armoires peintes, avec les fymboles j
des deux empires, d’Occident & d’Orient. Cette
armoire double rappelait ces deux empires j &
A R N
pour exprimer leur réunion & la concorde qui
regnoit entr’eux, les couvertures des volumes
<jui étoient peints dans la capacité de ces armoires-,
etoient chargées d’ornemens entièrement fem-
blables. Ces ornemens délîgnoient par leur nature
. dignité du préfet. Lorsqu’il étoit décoré du
titre à illufire y on voyoit fur les couvertures le
portrait du prince en or. Quelquefois des. bandes
d’or ou d’argent remplaçoient cette effigie. Les
deux vicaires & le primicier des notaires met-
toient d’autres marques de leurs dignités fur ces
couvertures de livres. Les deux armoires qui pa-
roiffoient renfermer ces livres., peints ainfi quelles,
portoient pour amortiffement deux génies ailés,
vêtus de longues tuniques de pourpre , agenouil-
es.J Soutenant un médaillon rond avec le portrait
d une femme, au-deffus de laquelle étoit
I écrit : d iv in a p r o v id e n t ia , pour défigner
r.empire d’Orient, & d iv in a e l e c t io pour
celui d’Occident.
A RM O RUM cuflos. II y avoit dans chaque
légion un foldat prépofé à la garde des armes
que l’on dépofoit dans une tente , & que l’on
voituroit fur des chariots , dans les marches. On
voyoit à Corne l’épitaphe fuivante i
v. F.
C. VIRIUS. SABINUS. VETERAN»
ARMORUM. CUSTOS; LEG»
XIII. GEM. MART. VICT»
D. M,
AnMORVjtf magiftery reEtor3 trîbunus , étoit
l ’infpeéleur des arfenaux. Il fourniffoit aux troupes-
les armes, lès retiroit après la guerre , eu fki-
foit fabriquer de nouvelles dans les manufa&ures
d’armes des différentes provinces de l’Empire.
ARMURE des jambes. Voye^ J a m b e s »
ARN A , en Italie, a r n . a s i »
On a une médaille impériale latine de cette
ville, frappée en l’honneur de Trébonien-Galle,
qui a été attribuée, mal-à-propos, à Arna de
Theffalie.
^Arna Fortuna. La Fortune avoit un temple
célèbre fur les bords de YArnus , aujourd’hui
YArno. II en eft fait mention- dans une. infcrip-
tion publiée par Muratorî, {Tkef. injcr. 178).
ARNE , fille de l’ifle de Sithone , ayant trahi
fa patrie pour une fomme d’argent ; les dieux
l’en punirent, en la changeant en chouette, oifeau
qui conferva, dit Ovide, après fon changement*
la même paffion pour f argent.
ARNÉE. Voye£ J e u x .
ÀRNODES. Les Grecs donnèrent c e nom à
ceux qui alloient dans les feftins & dans les affem-
bîées réciter des vers d’Homère. Ils portoient
à la main une branche de laurier. On les appe-
loit auffi Rkapfodijies on Rkapfades,. Leur nom
A R P
ctoit compofé de a h , chant 3 & d > agneau,
animal dont on leur donnait quelque portion
pour les récompenfer. N
ARNUS, fameux devin, étant allé à Naupaéle,
Hyppotès , petit-fils d’Hercule, crut q uil etoit
un efpion, & le tua. Auffi-tôtla pefte commença a
çtvager le camp des Héraclides : 1 oracle confulte,
répondit qu’Apollon vengeoit, par ce fléau, la ,
mort de fon devin; que pour appatfer ce dieu,
il falloit bannir le meurtrier, Sc établir des jeux
funèbres en l’honneur d’Arnus; ce qui fut execute.
Ces jeux devinrent fort célèbres dans la fuite,
fur-tout à Lacédémone.
AROMATITE , pierre précieufe, dit Gorræus,
d’une fubftance bitumineufe, reffemblant, par la
couleur & l’odeur, à la myrrhe, que les Grecs
appeloient par excellence 3 & que 1 on trou-
voit en Egypte & en Arabie. Si^ cette prétendue
pierre précieufe n*étoit pas de l’ambre ou de la
copale, nous ne voyons aucune fubftance dans
les trois règnes de la nature, à laquelle fa def-
cription puiffe convenir.
- Aromatites , liqueur aromatifée. Pline dit
^qu’on faifoit infufer dans du moût ou du vin
doux., cWs paftilles de myrrhe , de nard, de fucre
on de caffe, calamus, 8c d afphalte. Cetts liqueur I
s ’appeloîc aromatites.
AROKDEL. ( marbres d‘ ) Voye^ A rundee.
AROTE S, fyracufaitis de condition libre, que
la pauvreté réduifoit à fervir leurs concitoyens.
Ce mot vient d’«p»W, laboureur ; parce que fans
doute le labour étoit, dans un pays auffi fertile
en bled que la Sicile, l’occupation ordinaire des
mercenaires- v
AROURE, plèthre, verfe, beth-féah, rno-
dios , mefure geodétique ou gromatique de 1 Afie
& de l’Egypte. Elle valoir, en mefures de France,
d’arpenss elle vaioit, en mefures anciennes
dêrmêmespays, 1 Locations, ou 6 beth-cabs, ou
X4 beth-robs, ou loo décapodes carrées, _ ou
. xyoo.coudées facrées carrées, ou iooqo pieds
géométriques carrés. ('Métrologie de M. Paubion).
ARPA ou Ar ph a , divinité dont il eft fou-
vent parlé dans la vie de S. P o t in q u i fouffrit
- le martyre fous le règne d’Antonin-Pie. Bollandus
dit que .c’eft une des divinités fubalternes, appelées
par les Romains DU minoritm gentium, de
laquelle nous n’avons aucune connoiffance. Elle
fe trouve îouvent jointe dans ces a êtes a Jupiter,
à Ariane & à Minerve. ,
ARPÀG E, ou mieux Harpage, Arpagus. Ce
mot, dans les inferiptions, où il eft ordinairement
écrit avec une h , déiîgne un enfant mort
,au berceau, ou du moins dans fa plus tendre
jeuneffe. Il eft formé du grec , je ravu y
j ’enleve. On le trouve employé dans l’ épitaphe
d’un Mar'cus Aurélius Fauftinus , mort a l age de
neuf ans deux mois & treize jours f qui a ,etP
À R P 3 ° 7
trouvée dans les G aules, où l’on parloit le grec
corrompu |
d . M.
ET. m e m o r ia e . a e t e r n a e
f Au s .t i n i
m . AURELII. INF ANTIS. DU LOIS
SIMI, ET. INCOMPARABILr. QUI
VIXIT. ANNIS. V I III. M. II. D. XIH
QUI. SIBI. ANTE. MORTEM. RO
GAVIT. QUAM. PARENT1BUS
SUIS. C. JUL. MAXIMUS. FILIAS
TRO. ET. AURELIA. FAUSTINA
MATER. UNICO. FILIA. DESO
LAT. P. C. ET. SUB. AS CI A- DEDt
CAVERUNT. MULTIS. ANNIS
VIV A T . QUI. DIXERIT. ARP.AÇI
TIBI. TERRAM. LEVEM,*
Vafcia e ft gravée entre les fîgles D- m . Grutet
(page 682. 9.) a rapporté cette épitaphe, que
l’on voyoit à L y on , au prieuré de Saint-Irénée.
Les Romains ne faifoient point de funérailles
aux arpages ou enfans morts au berceau. On ne
brûloït point leurs corps, & on ne leur dref-
foît ni tombeau ni cippe chargé d’épitaphe : de-la
vient que Juvénal ait d’ un enfant mort a cec
âge ;
Terra clauditur infans
Minor igné rogi.
j Dans la fuite cependant, on brûla les corps
des enfans qui avoient vécu quarante jours, & à?
qui il a voit pouffé quelques dents. Ces morts étoient
appelés arpages ou enlevés. Euftathe nous apprend
que c’étoit la coutume des Grecs, de ne célébrer
les funérailles des enfans, ni pendant le jour
ni pendant la nuit, mais au lever de l’aurore ,
au moment qui précède le lever du foleil ; parce
qu’ils appeloient la mort de ces enfans le rapt
du fo u r , H'/xtpus kpx*y\i. Us donnoient a entendre
par cet euphémifme, que l’aurore les avoit enlevés
pour jouir de leurs innocentes çareffes ; &
fur le bas-relief d’ un tombeau qui eft au capitole,
on voit l’Aurore enlevant un enfant, auquel le
monument étoit fans doute confacré.
' ARPEDONAPTES, furnom des prêtres égyptiens.
Démocrite, cité par S. Clément d’Alexandrie,
(Stromat. i.) défigne par ce nom ces prêtres
égyptiens verfés dans tontes les fciences, & dans
la Géométrie en particulier. Jablonski le dérive
d’ un mot compofé de trois racines de la langue
cophte, l’ancien égyptien , qui veulent dire de.
l'ordre des favons.
ÂRPÏ , en Italie. ArnANQN. a p u a N o r ,
Les médailles autonomes de cette ville font :
E.RRR. en argent.
R. en bronze.
O. en or.
Ses types ordinaires font : Un cheval courant.
— Un taureau cornupete. — Un fanglier courant.
Q q >/