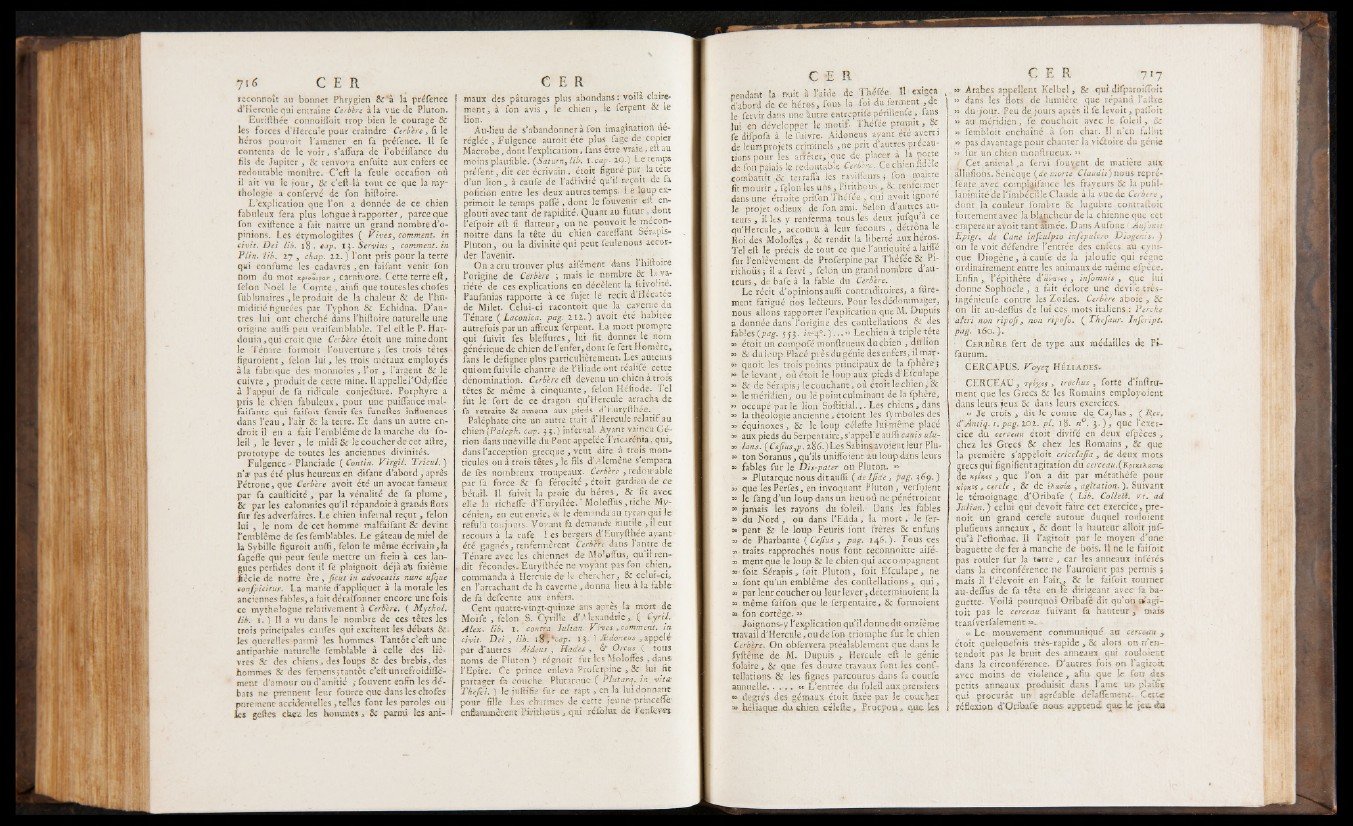
reconnoît au bonnet Phrygien &"à la préfence
d’Hercule qui entraîne Cerbère à la vue de Pluton.
Eurifthée connoifloit trop bien le courage &
les forces d’Hercule pour craindre Cerbère 3 fi le
héros pouvoit l'amener en fa préfence. Il fe
contenta de le voir* s’afliira dé l’obéifiance du
fils de Jupiter , & renvoya enfuite aux enfers ce
redoutable monftre. C ’eft la feule occafion où
il ait vu le jour, & c’eft-là tout ce que la mythologie
a confervé de fon hiftoire.
L ’explication que l’on a donnée de ce chien
fabuleux fera plus longue à rapporter, parce que
fon exjftence a fait naître un grand nombre d’opinions.
Les étymologiftes ( Vives, comment. in
civit. Dei lib. 18 , cap. 13. Servius , comment, in
P lin. iib. 27 , chap. 22. ) l’ont pris pour la terre
qui confume les cadavres,en faifant venir fon
nom du mot xpfoZopoT , carnivore. Cette terre eft,
félon Noël le Comte , ainfi que toutes les chofes
fublunairesle produit de la chaleur & de l’hn-
miditié figurées par Typhon & Echidna. D’autres
lui ont cherché dans l’hiftoire naturelle une
origine aufli peu vraifemblable. Tel eft le P. Har-
douin, qui croit que Cerbère étoit une mine dont
le Ténare formoit l’ouverture 5 fes trois têtes
figuroient, félon lu i, les trois métaux employés
à la fabrique des monnoies , l’or , l’argent & le
cuivre , produit de cette mine. Il appelle l’Odyflee
à l’appui de fa ridicule conjecture. Porphyre a
pris le chien fabuleux, pour une puifîance mal-
faifante qui faifoit fentir fes funeltes influences
dans l’eau , l'air & la terre. Et dans un autre endroit
il en a fait l’emblème de la marche du fo-
le i l , le lever , le midi & le coucher de cet aftre,
prototype de toutes les anciennes divinités.
Fulgence - Planeiade ( Contin. Virgil. Tricul. )
n’æ pas été plus heureux en difant d’abord , après
Pétrone, que Cerbère avoit été un avocat fameux
par fa caufticité par la vénalité de fa plume,
& par les calomnies qu’ il répandoit à grands flots
fur fes adverfaires. Le chien infernal reçut , félon
lui , le nom de cet homme malfaifant & devint
l’emblème de fes femblables. Le gâteau de miel de
la Sybille figuroit auffi, félon le même écrivain,la
fagefle qui peut feule mettre un frein à ces langues
perfides dont il fê plaignoit déjà a% fixième
■ siècle de notre ère, ficut in advocatis nunc ufque
confpîcitur. La manie d’appliquer à la morale les
anciennes fables, a fait déraîfonner encore une fois
ce mythologue relativement à Cerbère. ( Mythol.
lib. 1. ) Il a vu dans le ’ nombre de ces têtes les
trois principales caufes qui excitent les débats &.
les querelles-parmi les hommes- Tantôt c’eft une
antipathie naturelle femblable à celle des lièvres
& des chiens., des loups & des brebis, des
hommes & des ferpens ; tantôt ceft un refroidifle-
ment d’amour ou d’amitié ; fouvent enfin les débats
ne prennent leur fource que dans tes chofes
parement accidentelles, telles font les paroles ou
les geftes chez- les hommes, & parmi tes animaux
des pâturages plus abondans : voila claire*
ment, à fon avis , le chien, le ferpent & le
lion. ' | '
Au-lieu de s’abandonner à fon imagination déréglée
, Fulgence auroit été plus fage de copier
Macrobe, dont l’explication, fans être vraie, eft au
moins plaufible. (Saturn3 lib. î.cap. 20.) Le temps
préfent, dit cet écrivain, étoit figuré par ^ te^e
d’un lion, à caufe de l’activité qu il reçoit de fa
pofition entre les deux autres temps. Le lçmp ex-
primoit le temps paffé , dont le fouvenir eft englouti
avec tant de rapidité. Quant au futur, dont
l’efpoir eft fi flatteur, on ne pouvoit le mécon-
noktre dans la tête du çhien careflant Sérapis-
Pluton, ou la divinité qui peut feule nous accorder
l’avenir. # .
On a cru trouver plus aifément dans 1 hiltoire
l’origine, de Cerbère > mais le -nombre 8e la variété
de ces explications en décèlent la frivolité.
Paufanias rapporte à ce fujet lé récit d’Hécatee
de Milet. Celui-ci racontoit que la caverne du
Ténare ( Laconica. pag. 212.) avoit ete habitée
autrefois par un affreux ferpent. La mort prompte
qui fuivit fes blefliires, lui fit donner le nom
générique de chien de l’enfer, dont fe fert Homere-,
fans le défigner plus particulièrement. Les auteurs
quiont fuivile chantre de i’ Iliade ont réalife cette
dénomination. Cerbère eft devenu un chien a trois
têtes & même à cinquante, félon Hefiode. Tel
fut le fort de ce dragon qu’Herctile arracha de
fa retraite & amena aux pieds d’ Euryfthee.
Paiéphate cite u n autre trait d ’ H e r c u l e relatif au
chien (Palepk. cap. 3.3..) infernal. Ayant vaincu Ge-
rion dans une ville du Pont appeFéeTricarénia, qui,
d a n s l ’ a c c e p t ib n grecque , veut dire à trois monticules
ou à trois têtes, le f i ls d ’ A l c m è n e s’empara
de fes nombreux troupeaux. Cerbère , redoutable
par fa force & fa férocité , étoit gardien de ce
bétail. Il fuivit la proie du héros , & fit avec
elle la richefle d’Euryftée. * Molofîiis, riche Mycénien,
en e u t en -v ie , & le demanda au tyran qui le
refufa toujours. Voyant fa demande mutile , i l eut
r e c o u r s à la rufe 1 es bergers d’Euryfthee ayant
été gagnés,renfermèrent Cerbère dans 1 antre de
Ténare avec les chiennes de M o lpf in s , qu i! rendit
fécondes.. Euryfthée ne voyant pas fon chien,,
commanda à Hercule de le chercher, & celui-ci,
en l’arrachant de la caverne , donna lieu, a la fable
de fa defcente aux enfers. • . -
Cent quatre-vingt-quinze ans après la mort de
Moïfe , félon.S. Cyrille d’Alexandrie, ( Cyril.
Alex. lib. 1. contra Julian. Vives 3 comment. in
civit. Dei , lib. î f l'c a p . 13. ) Ædoneus'Tappelé
par d’ antres Aideus , Hades , 6* Orcus ( tous
noms de Pluton ) régnoit fur les- Moloffes , dans
l’Epîre. Ce prince enleva Proferpine , 8c~ lui fit
partager fa- couche. Plutarque ( Plutarq. in vit a
Thefci. J le juftîfie fur ce rapt, en la lui donnant
pour filfe L e s charmes de cette jeune princefïb’
enflammèrent Pii’iîhoüs, qui réibiut dé Penkvet
pendant l,a nuit à l’aide de Théfée. Il exigea .
d’abord de ce héros, fous la foi du ferment, d e
le fervir dans u n e 'a u t r e entreprife pénlleufe , fans
lui en développer le motif. Théfée promit, &
fe difpofa à le fuivre. Aidoneus ayant été averti
de leurs projets criminels ,ne prit d’autres précautions
pour les a r r ê t e r , ’ q u e de. placer à la p o r t e
de fon palais le redoutable Cerlerc. C e c n ie n Ii-ocle
combattit Sç t e r r a fia les r a v i f le u r s 3 fon maure
fit mourir , f é l o n le s u n s , F i r i t h o iis , 8c renfermer
dans une étroite prifon Théfée , qui avoit ignore
le projet, odieux de fon ami.,Selon, d autres auteurs
, il les y renferma tous les deux jufqu a ce
qu’Hercule, accouru à leur fecours , détrôna le
Roi des Moloffes-, & rendit la l ib e r t é a u x h é r o s .
Tel eft le précis de tout ce q u e l’antiquité alaiffe -
fur l’enlèvement de Proferpine par Théfée Pi- ■
rithoüsj il a fervi , félon un grand nombre d’au- i
teurs, de bafe à la fable du Cerbère
Le récit d’opinions aufli çontraditoires, a fure- ;
ment fatigué nos le&eurs. Pour les dédommager,
nous allons rapporter l’explication que M. Dupuis
a donnée dans l’origine des qonftellatiQns & des
fables {pag. 5 5 3 . in^0. L e c h i e n a triple te-te
» étoit un compofé monftrueuxduehten , dû lion
3» & du l o u p .P l a c é près du génie des enfers, il may-
w quoit les trois points principaux de la fphère;j
3° le levant, où étoit le loup aux pieds d’Efculape
30 & de S é r a p is 3 le couchant, où étoit le chien &
33 le méridien, ou lé point culminant de la fphere,
30 occupé par le lion Softîtial... Les chiens, dans '
’O la théologie ancienne, étoient les fymboles des
33 équinoxes, & le loup célefte lu i -m êm e p l a c é
so aux pieds du Serpentaire, s’appelle aufli canis ulu- ;
»s lans. ( C&fius3p. 286.)Les Sabins avoient leur Plu- :
33 ton Soranus, qu’ils uniffoient au loup dans leurs
>» fables fur le Dis-pater ou Plutôt. »
30 Plutarque nous ditauflû ( de IJJde , pag. 369. )
>3 que les Perfes, en invoquant Pluton , verfoient
00 le fangd’un loup dans un lieu où ne pénétroient
» jamais les rayons du foleiL Dans les fables
s> du Nord, ou dans l’Edda, la mort, le fer-
30 pent & le loup Feuris font frères & enfans
de Pharbante (Cefius , pag. 146.). Tous ces
»-traits rapprochés nous font reconnoître aifé-
» ment que le loup & le chien qui accompagnent
foit Sérapis, foit Pluton, foit Efculape , ne
» font qu’un emblème des conftellations ,. q u i,
30 par leur coucher ou leur lever , déterminoient la
30 même faifon que le ferpentaire, & formoient
30 fon cortège. >3
Joignons-y l’explication qu’il donnedu onzième
travail d’Hercule, ou de fon triomphe fur le chien
Cerbère. On o b f e r v e r a préalablement que dans le
fyftême de M. Dupuis , Hercule eft le génie
folaire, & que fés douze travaux font les co-nf- .
tellations & les figues parcourus dans fa courfe
annuelle...........« L’entrée du folefl aux premiers
*» degrés des gémaux étoit fixée par le coucher |
» hélîaque du chien, célefte, Procyoa, que les t
33’ Arabes appellent Ke lbel, & qui difparoiflbit
oo- dans les flots de lumière que répand l’aftre
,03 du jour. Peu de jours après il fe levoit, paffoit
30 au-méridien , fe couchoit avec le fo le il, &
0? fembîoit enchaîné à fon char. Il n’en fallut
oo pas davantage pour chanter la victoire du génie
03 fur un chien monftrueux. o>
J Cet.animal ,.a fervi fouvent de matière aux
allufiohs. Sénèque {de morte Claudii) nous repréfente
.avec compl.gifance les frayeurs & la pufij-
lanîmité de l’imbécille Claude à la vue de Cerbtre,
dont la couleur fombre & lugubre contraftoit
fortement avec la blancheur de la chienne que cet
.empereur avoit tant aimée. Dans Aufone ( Âujbuii
Epigr. de Cane infculpto infepulcro Diogenis. )
on le voit défendre l’entrée des enfers au cynique
Diogène, à caufe de la jaloufie qui règne
ordinairement entre les animaux de même efpèce.
Enfin , l’épithète d’««îrwj , infomnis , que lui
donne Sophocle, a fait éclore une devife très-
ingénieufe contre les Zoïles. Cerbère aboie , &
on lit au-deflus de lui ces mots italiens : Perche
àltri non ripofi, non ripofo. ( Thefaur. Infcript.
pag. léo. ).
• , Cerbère fert de type aux médailles de Pî-
faurum.
CERCAPUS. Voyez HÉIIADES.
CERCEAU, , trochûs , forte d’infiniment
que les Grecs 8>c les Romains employoient
dans leurs jeux & dans leurs exercices. ce Je crois , dît Je comte de Caylus, (Rec,
d’Antiq. I. pag. 101. pi. ib. n°. 3 .) , que l’exercice
du cerceau étoit divifé en deux efpèces ,
chez les Grecs & chez les Romains, & que
la première s’appeloit. cricelafia , de deux mots
grecs qui lignifient agitation du cerceau.{Kpix.iXa<ricc.
de xpUoç , que l’on a dit par métathèfe pour
KÎfxoç, cercle , & de ïhourU , agitation. ). Suivant
le témoignage . d’Orîbafe ( Lib. Colleté, vi. ad
Julian.') celui qui devoir faire cet exercice, pre-
noit un grand cercle autour duquel rouloi.ent
plufieurs anneaux , .& dont la hautenr alFoit juf-
qu’à l’eftomac. 11 l’agi toit par le moyen d’une
baguette de fer à manche .de bois. 11 ne le faifoit
pas rouler fur la tarre, car les anneaux inférés
dans la circonférence ne Pauroîent pas permis ;
mais il l’ élevoit en l’a i r , & le faifo-it tourner
au-deflus de fa tête en le dirigeant avec fa baguette.
Voila pourquoi Oribafé dit qu’on n>’agi-
toit pas le cerceau fuivant fa hauteur , maïs
tranfverfalement ^ -•
ce Le mouvement communiqué au cerceau y
étoit quelquefois très-rapide , 8c alors on n’ën-
tendoit pas le bruit des anneaux qui roiflorenc
dans la circonférence. D’autres fois on Tagftok
avec moins de violence, afin que le fon des
petits anneaux produisît dans l’ame un pîailar
qui procurât un agréable délaflement. Cette
réflexion d’Oribafè noos apprend que le je« ; «àa