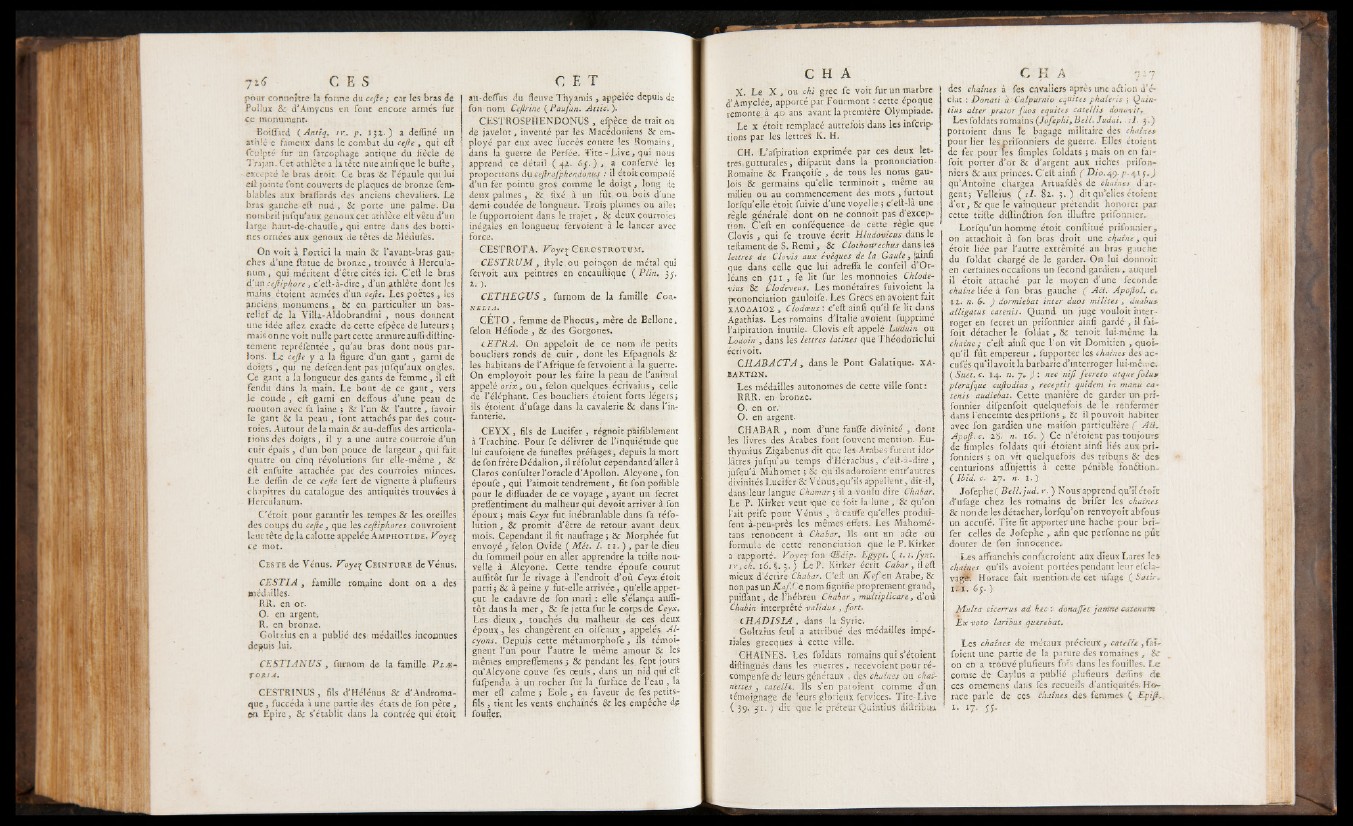
pour connaître la forme du cefle y car les bras de I
Pollux & d’Amycus en font encore armés fur
ce monument»
Boiflard ( Antiq, iv.. p. 132. ) a deffiné un
athlète fameux dans le combat du cefle , qui eft
feu!pré fur un fâixophage antique du liècle de
Trajan. Cet athlète a la tête nue ainfi que le bufte,
excepté le bras droit. Ce bras & F épaule qui lui
eft jointe font couverts de plaques de bronze fem-
blables aux bralfards des anciens chevaliers. Le
bras gauche eft nud, & porte une palme. Du
nombril jufqu’ aux genoux cet athlète elt vêtu d’un
large haut-de-chaulTequi entre dans des bottines
ornées aux genoux île têtes de Méduies.
On voit à Fortici la main & l’avant-bras gauches
d’une ftatue de bronze, trouvée à Hercula-
num, qui méritent d’être cités ici. C’eft le bras
d’un ceflipkore, c’eft-à-dire, d’un athlète dont les
mains étoient armées d’un cefle. Les poètes, les
jançiens, monumens, & en particulier un bas-
relief de la Villa-Aldobrandini , nous donnent
une idée allez exafite de cette efpèce de luteurs;
mais on ne voit nulle part cette armure auftî diftinc-
tement repréfentée , qu’au bras dont nous parlons.
Le cefle y a la figure d’un gant, garni de
doigts, qui ne delcendent pas jusqu'aux ongles.
Ce gant a la longueur des gants de femme, il eft
fendu dans la main. Le bout de ce gant, vers
le coude, eft garni en deffous d’ une peau de
mouton avec fa laine ; & l’un & l’autre, fa voir
le gant & la peau, font attachés par des courroies.
Autour de la main & au-deflus des articulations
des doigts, il y a une autre courroie d’un
cuir épais , d'un bon pouce de largeur , qui fait
quatre ou cinq révolutions fur elle-même , &
eft enfuite attaçhée par des courroies minces.
Le delfin de ce cefle lert de vignette à plufièurs
chapitres du catalogue des antiquités trouvées à
Herculanum.
C’éroit pour garantir les tempes & les. oreilles
des coups du cefle, que les ceftiphores couvroient
leur tête de la calotte appelée Amphotide. Voye\
ce mot.
Ceste de Vénus. Voye% Ceinture de Vénus.
C E S T IA , famille romaine dont on a des
médailles.
RR. en or.
O. en argent,
R. en bronze.
Goltzius en a publié des médailles inconnues
depuis lui,
C EST IAN U S , furnom de la famille P z æ -
fORlA.
CESTRINUS, fils d’Hélénus & d’Androma-
que, fuccéda à une partie des états de fon père ,
en Epire, & s’établit dans la contrée qui étoit
au-deffus du fleuve Tnyamis, appelée depuis de
fon nom Ceflrine ( Paufan. Attic. ).
QESTROSPHENDONUS , efpèce de trait ou
de javelot, inventé par lès Macédoniens & employé
par eux avec fuccès contre les Romains,
dans la guerre de Perfée. Tite - L iv e , qui nous
apprend ce détail ( 42. 6 y . ) , a confervé les
proportions duceflrofphendonus : il étoit compofé
d’un fer pointu gros comme le doigt., long de
deux palmes, &; fixé à un fut, ou bois d’une
demi coudée de longueur. Troi§ plumes ou ailes
le fupportoient dans le trajet., & deux courroies
inégales en longueur fervoient à le lancer avec
force.
CESTROTA. Voyei Ge ro st ro tum .
C E S T R U M ftyle .ou poinçpn de métal qui
fervoit aux peintres en encauftique ( P//«, 35. WBÊÊ
CETHEGUS , furnom de la famille C or-
NELIA.
CÉTO , femme de Phocus, mère de Bellone,
félon Héfiode, & des Gorgones.
lE TRA. On appejoit de ce nom de petits
boucliers ronds de cu ir , dont les Elpagnols &
les. hafeitans de l’Afrique fe fervoient à la guerre.
On employoit pour les faire la peau de l’animal
appelé orix y ou., félon quelques écrivains, celle
de l’éléphant. Ces boucliers étoient forts légers;
ils é.toient d’ufage dans la cavalerie & dans l’infanterie.
C E Y X , fils de Lucifer , régnoit pkifiblement
à Trachine. Pour fe délivrer de l’inquiétude que
lui caufoient de funeftes préfages, depuis la mort
de fon frère Dédalion, il réfolut cependantd’aller à
Claros confulter l’oracle d’Apollon. Alcyone, fon
époufe, qui l’aimoit tendrement, fit fon poffible
pour le difluader de ce voyage , ayant un fecret
preffentiment du malheur qui devoit arriver à fon
époux ; mais Ceyx fut inébranlable dans fa réfo-
lution, & promit d’être de retour avant deux,
mois. Cependant il fit naufrage ; & Morphée fut
envoyé, félon Ovide ( Met. I. 11. ) , par le dieu
du. fommeil pour en aller apprendre la trifte nouvelle
à Alcyone. Cette tendre époufe courut
auflitôt fur le rivage à l’endroit d’où Ceyx étoit
parti; & à peine y fut-elle arrivée, qu’elle appér-
çut le cadavre de fon mari : elle s’élança aufli-
tot dans la mer, & fe jetta fur le corps de Ceyx.
Les dieux , touchés du malheur de ces deux
époux j les changèrent en oifeaux, appelés A lcyons.
Depuis cette métamorphofe, ils témoignent
l’ un pour l’autre le même amour & les
mêmes èmpreftemens 3 & pendant les. fept jours
qu'Alcyonè epuve fes oeufs, dans un nid qui eft
fufpendiv à un rocher fur la furface de l’eau, la
mer efl calme ; E o le , en faveur de fes petits-
fils , tient les vents enchaînés & les empêche dp
fonder,
X. Le X / o u chi grec fe voit fur un marbre
d’Amyclée, apporté parFourmont : cette époque
remonte.à 40 ans avant la première Olympiade.
Le x étoit remplacé autrefois dans les inferip-
tions par les lettres K. H.
CH. L ’afpiration exprimée par ces deux lettres,
gutturales, difparüt dans la prononciation
Romaine & Françoife , de tous les noms gaulois
& germains quelle terminoit , même au.
milieu ou au commencement des mots , furtout
lorfqu’elle étoit fuivie d’une voyelle ; c’eft-là une
règle générale' dont on ne connoît pas d’exception.
C’eft en conféquence de cette règle que
Clovis, qui fe trouve écrit Hludovicas dans le
teftament de S. Remi, & Clothow échus dans les
lettres de Clovis aux évêques de la Gaule , (ainfi
que dans celle que lui adreffa le confeil d’Orléans
en 511 , fe lit fur les monnoies Chlode-
vius & Clodeveus. Les monétaires fuivoient la
prononciation gauloife. Les Grecs en avoient fait
XAOAAIOS , Clodoeus : c’eft ainfi qu’il fe lit dans
Agathias. Les romains d’Italie avoient fupprimé
ï’afpiration inutile. Clovis eft appelé Luduin ou
Lodoinr, dans les lettres latines que Théodoriclui
écrivoit.
CH A B A C T A y dans le Pont Galatique. XABAKT&
N.
Les médailles autonomes de cette ville font :
R RR. en bronze.
O. en or.
O. en argent.
CHABAR , nom d’une faufife divinité , dont
les livres des Arabes, font fouvent mention. Eu-
thymius Zigabenus dit que lés-Arabes furent ido"
lâtres. jufqu’au temps d’Héraclius, c’eft-à-dire ,
jufqu’à Mahomet ; & qu’ils adoroient etltr autres
divinités Lucifer & Venus,qu’ ils appellent, dit-il,
dans'leur langue Chamarÿ il a voulu dire Chabar.
Le P. Kirker veut *que ce foit la lune , & qu’on
l’ait prife pour Vénus , -àxratffe qu’elles produi-
fent à-peu-près les mêmes effets. Les Mahomé-
tans renoncent à Chabar. Ils ont un a été ou
formule de cette renonciation que le P. Kirker
a rapporté. Voye^ion (Bïdip. Egypt. ( t.i\fynt.
ivy ch. 16. §. 3 . ) Le P. Kirker écrit Cabar, il eft
mieux d écrire Chabar. C’eft un K e f en Arabe, &
nonpasunKaf.Ce nomfignifie proprement grand,
p limant, de l’hébreu Chabar, mitltiplicare, d’où
Chabin interprété validas , fort,
CHADISTA, dans la Syrie.
Goltzius feu! a attribué des médailles impériales
grecques à cette ville.
CHAINES. Les foldats romains qui s’étoient
dtftingués dans les guerres, recevcient pour ré-
compenfe de leurs généraux , des chaînes ou chaînettes
, catelle. Ils s’ en paroient comme d'un
témoignage de leurs glorieux fervices. Tite-Live
( 39. 3 1 .) dit que le préteur Quintius diftribixi
des chaînes à fes cavaliers après une aétion d’éclat
: Donati a ' Calpurnio équités phaleris 5 Quintius
aller pr&tor fuos équités catellis donavit,
Les foldats romains (.Jofephi, Bell. Judai.. il. 3.)
portoient dans le bagage militaire des chaînes
pour lier lés .prifonniers de guerre. Elles étoient
de fer pour Tes fimples foldats ; mais on en fai-
foit porter d’or & d’argent aux riches prifon-
niers & aux princes. C'elt ainfi ( D/0.49./J.41 j.J
qu’Anto'ine chargea Artuafdès de chaînes d’ar-
j gent; Velleius ( i l . 82. 3 .) ditqu’èlies étoient
d’o r , & que le vainqueur prétendit honorer par
cette trifte diâinélron fon illuftre prifonnier.
Lorfqu’un homme étoit conftitué prifonaier,
on attachoit à fon bras droit une chaîne y qui
étoit liée par l’autre extrémité au bras gauche
du foldat chargé de le garder. On lui donnoic
en certaines occafions un fécond gardien, auquel
il étoit attaché par le moyen d’une fécondé
chaîne liée à fon bras gauche ( Act. ApoftoL c,
I I . n. G. ) dormiebat inter duos milites y duabus
alligatus catenis. Quand un juge vouloit interroger
en (ecret un prifonnier ainfi gardé, il fai-
foit détacher le foldat, & tenoit lui-même la
’ chaîne y c’eft ainfi que l'on vit Domitien , quoi-
i qu’ il fut empereur , fupporter les chaînes des ac-
I eufés qu’ilavoit la barbarie d’interroger lui-même^
| ; ( Suet. c. 14. n. 7» j) î nec nifi fecreto atque folus
'• plerafque euftodias , receptis quidem in manu ul-
' tenis audiebat. Cette manière de garder un prr-
! fonnier difpenfoit quelquefois de le renfermer
dans l’enceinte desprifons, & il pouvoir habiter
! avec fon gardien une maifon particulière ( AU,
\ Apofl. c. 2$. n. 16. ) Ce n’étoient pas toujours
: de fimples foldats qui étoient ainfi liés aux pri-
: fo-nniers y on vit quelquefois des tribuns & des
; centurions affujettis à cette pénible fonction-
; ( Ibid. c. 17 . n. ï . )
! Jofephe C BelL jud. v. ) Nous apprend qu’îîétofc
d’ ufage chez les romains de brifer les chaînes
& non de les détacher, lorfqu’on renvoyoit abfous
un accufé. Tite fît apporter une hache pour brifer
celles de Jofephe , afin que perfonne ne pût
douter de fon innocence^
Les affranchis confacroient aux dieux Lares les
chaînes qu’ils avoient portées pendant leur efcla-
vad$£ Horace fait mention, de cet lifage ( Satir,
im . 6$ .} ;.
Mufta cicerrus ad h&c :• donajfet jantree catenam
E x voto■ laribus qu&rebat.
Les chaînes àe métaux précieux, cateffa. 3 faï-
foient une partie de la parure des romaines , &
on en a trouvé plufièurs fois dans les fouilles. Le
comte dé Caylus a publié plufièurs deiTms de
ces omemens dans fes recueils d’antiquités. Horace
parle de ces chaînes des femmes C Epifl-
! i - 17-