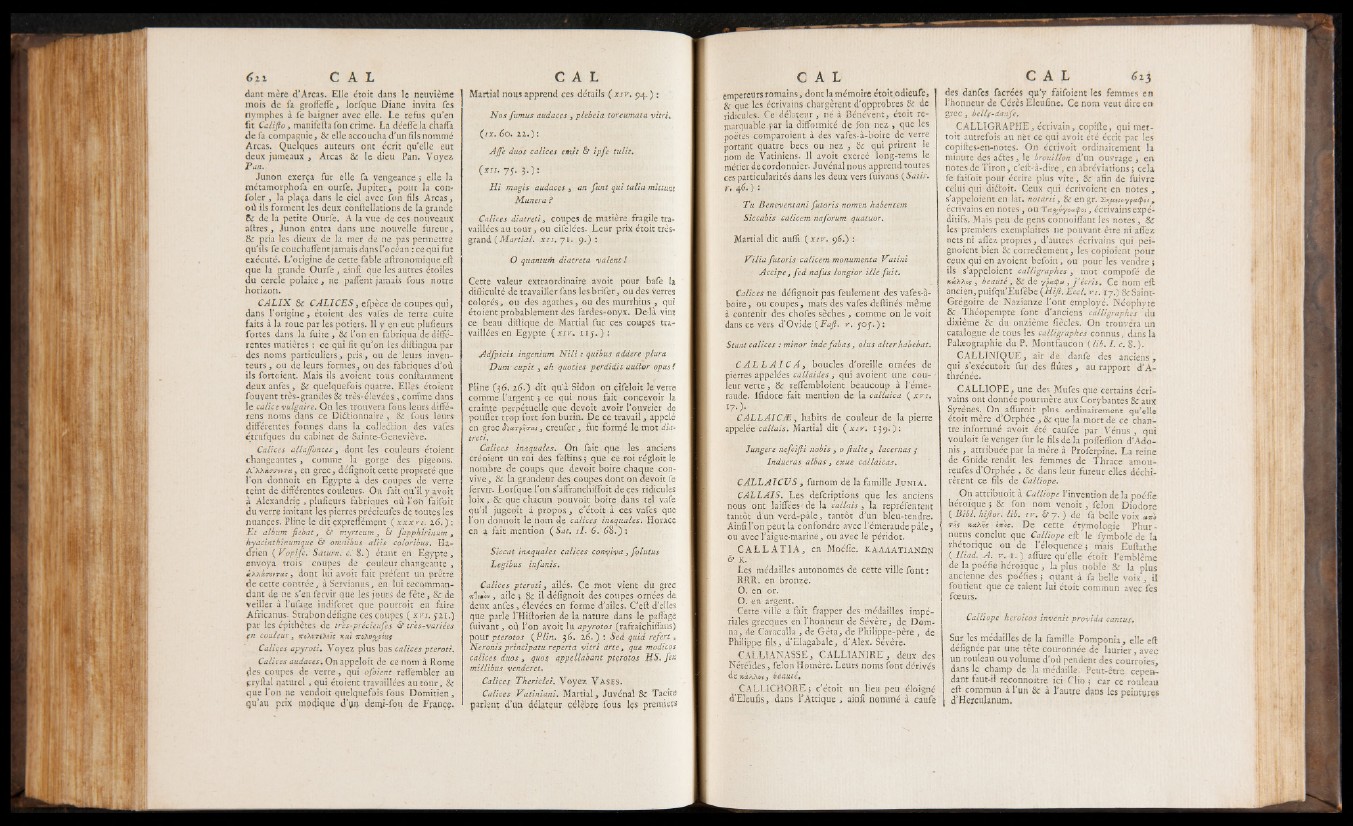
dant mèrè d’Arcas. Elle étoit dans le neuvième
mois de fa groffeffe , lorfque Diane invita fes
nymphes à fe baigner avec elle. Le refus qu’en
fit Califto , manifelta fon crime. La déelfe la chalfa
de fa compagnie, 8c elle accoucha d’un fils nommé
Areas. Quelques auteurs ont écrit qu’elle eut
deux jumeaux , Areas & le dieu Pan. Voyez
Part.
Junon exerça fur elle fa vengeance j elle la
métamorphofa en ourfe. Jupiter, pour la con*
fo le r , la plaça dans le ciel avec fon fils Areas,
où ils forment les deux conftellations de la grande
8c de la petite Ourfe. A la vue de ces nouveaux
aftres, Junon entra dans une nouvelle fureur ,
& pria les dieux de la mer de ne pas permettre
qu’ ils fe couchaffent jamais dans l’océan : ce qui fut
exécuté. L’origine de cette fable afironomique eft
que la grande Ourfe, ainfî que les autres étoiles
du cercle polaire, ne paffçnt jamais fous notre
horizon.
C A L I X 8c C A L I C E S 3 efpèce de coupes qui,
dans l’origine, étoient des vafes de terre cuite
faits à la roue par les potiers. Il y en eut plufieurs
fortes dans la fuite, & l’on en fabriqua de différentes
matières : ce qui fit qu’on les diftingua par
des noms particuliers , pris , ou de leurs inventeurs,
ou de leurs formes, ou des fabriques d’où
ils fortoient. Mais ils avoient tous conftainment
deux anfes, & quelquefois quatre. Elles étoient
fouvent très-grandes & très-éle v.ées^eomme dans
le calice vulgaire. On les trouvera fous leurs diffé-
rens noms dans ce Dictionnaire, 8c fous leurs
différentes formes dans la collection des vafes
dtrufques du cabinet de Sainte-Geneviève.
Calices allajfontes, dont les couleurs étoient
changeantes, comme la gorge des pigeons.
A , en grec, défignoit cette propreté que
l’on donnoit en Egypte à des coupes de verre
teint de différentes couleurs. On fait qu’il y avoit
à Alexandrie , plufieurs fabriques où l’on faifoit
du verre imitant les pierres précieufes de toutes les
nuanpes. Pline le dit expreffémçnt ( x x x r t . 26.) :
Et album fiebat, & myrteum, & fàpphïrinum ,
hyacinthinumque & omnibus aliis coloribus. Hadrien
( Vopifc. Saturn.c.' S.) étant en Egypte,
envoya trois coupes de couleur changeante,
«xxotro'irctç, dont lui avoit fait préfent un prêtre
de cette contrée, à Servianus, en lui recommandant
de ne s’en fervir que les jours de fête, & de
veiller à l’ufage indiferet que pourroit en faire
Africanus. Stra.bon défigfte ces coupes ( xvi. 511.)
par les épithètes de tres-précieufes & tres^variées
en couleur y vohvrihus xxï vro^o^oôyç
Calices apyroti. Voyez plus bas calices pteroti.
Calices audaces. On appeloit de ce nom à Rome
çles coupes de verre, qui ofoient relfemhler au
pryftal naturel , qui étoient travaillées au tour, 8c
que l’on ne vendoit quelquefois fous Domitien,
qu’au prix mpdicjue d’vu? demi-fou de F^nçe.
C A L
Martial nous apprend ces détails ( x iv , 94. ) «
Nos fumus audaces , plebeia toreumata yitri.
( ix .6 o .1 2 .) ;
Ajfe duos calices émit & ipfe tulit.
O 1- 7 JHi
magis audaces , an funt qui talia mittunt
Munera ?
Calices diatreti, coupes de matière fragile travaillées
au tour y ou cifelées. Leur prix étoit très-
grand (Martial. x n . 7 1 . . 9 . ) :
O quantum diatreta valent l
Cette valeur extraordinaire avoit pour bafe la
difficulté de travailler fans les brifer, ou des verres
colorés, ou des agathes, ou des murrhins, qui
étoient probablement des fardes-onyx. De là vint
ce beau diftique de Martial fur ces coupes travaillées
en Egypte (x iv . 115.,) \ ;
Adfpicis ingenium N ili : quibus addere plura
J)um cupit y ah quoties perdid.it auttor opus f
Pline (36. 2.6.") dit qu’à Sidon on çifeloit le verre
comme l’argent} ce qui nous fait concevoir la
crainte perpétuelle que devoit avoir l’ouvrier de
pouffer trop fort fon burin. De ce travail, appelé
en grec fouT^a-ai, creufer, fut-formé le mot diatreti
^
Càliçes inaquales. On fait que les anciens
créoient un roi des feftins ; que ce roi régloit le
nombre de coups que devoit boire chaque conv
ive , 8c la grandeur des coupes dont on devoit fe
fervir. Lorfque l’on s’affranchiffoit de çes ridicules
Ioix, 8c que chacun pouvoit boire dans tel vafe
qu’il jugeoit à propos, ç’étoit à ces vafes que
l’on donnoit le nom de calices in&qitales. Horace
en a fait mention ( Sat. i l . 6. 68 .) :
Siccat inaquales calices çonyiva, folutus
Le gibus in f unis.
Calices pteroti, ailés. Ce mot vient du grec
7cItiov, aile 5 8c il défignoit des coupes ornées de.
deux anfes, élevées en forme d’ailes. C’eft d’elles
que parle l'Hiftorien de la nature dans le paffage
fuivant, où l’on avoit lu apyrotos (rafraîçniffans)
pour pterotos {Plin. 36. 26.) : Sed qui'd refert,
Nerohis principatu reperta vitri arte 3 que modicos
calices duos , quos appçllabant pterotos NS- fe#
millibus venderet.
Calices Thericlei. Voyez V ases.
Calices Vatiniani. Martial , Juvénal 8c Tacite
parlent d’un délateur célèbre fous les premiers
empereurs romains, dont la mémoire étoit odieufe,
& que les écrivains chargèrent d’opprobres & de
ridicules. Ce délateur, né à Bénévent, étoit remarquable,
par la difformité de fon n e z , que les
poètes comparaient à des vafes-à-boire de verre
portant quatre becs ou nez , 8e qui prirent le
nom de Vatiniens. Il avoit exercé long-tems le
métier de cordonnier. Juvénal nous apprend toutes
ces particularités dans les deux vers fuivans (Satir.
r. 46. ) :
Tu Beneventani futoris nomen habentem
Siccabis calicem na forum quatuor.
Martial dit auffi ( x iv . 96.) :
Vilia futoris calicem monumenta Vatini
Accipe y fed nafus longior ille fuit.
Calices ne défignoit pas feulement des vafes-à-
boire , ou coupes, mais des vafes deftinés même
à contenir des chofes sèches , comme on le voit
.dans ce vers d’Ovide (Eafi. v. 505.):
S tant calices : minor inde fabas , olus alterhabebat.
C A L L A I C A y boucles d’oreille ornées de
pierres appelées callaides -3 qui avoient une cou- ••
leur verte, & reffembloient beaucoup à l'émeraude.
lfidore fait mention de la callaica ( x v i ,
17.).
C A L L A I CÆ, habits de couleur de la pierre
appelée callais. Martial dit (.x iv . 139.) :
Jungere nefeifti nobis , o fuite , lacernas y
lndueras albas , exue callaicas.
C A L L A I CUS y furnom de la famille Ju n ia .
CALLAIS. Les deferiptions que les anciens
nous ont laiffees-de la callais, la repréfentent
tantôt d un verd-pâle, tantôt d’un bleu-tendre.
Ainfil’on peut la confondre avec l'émeraude pâle,
ou avec l’aigue-marine, ou avec le péridot.
C A L L A T 1A , en Moéfie. k a a a a t ia n q n
H II ^
Les médailles autonomes de cette ville font?
RRR. en bronze.
O. en or.
O. en argent.
Cette ville a fait frapper des médailles impériales
grecques en l’ honneur de Sévère, de Dom-
na, de Caracalla , de Géta, de Philippe-père , de
Philippe fils, d’Elagabale, d’Alex. Sévère.
CALLIANASSE, CALLIANIRE , deux des
Néréides, félon Homère. Leurs noms font dérivés
de jc«Aâo?, beauté.
CALLICHOREj c’ étoit un lieu peu éloigné
d’Eleufis, dans l’Attique , ainfi nommé à caufe
des danfes facrées qu’y faifoient les femmes en
l’honneur de Cérès Eleufine. Ce nom veut dire en
grec, belle-danfe.
CALLIGRAPHIE, écrivain, copifie, qui met-
toit autrefois au net ce qui avoit été écrit par les
copiftes-en-notes. On écrivoit ordinairement la
minute des aétes, le brouillon d’un ouvrage , en
notes de Tiron, c’ eft-à-dire, en abréviations j cela
fe faifoit pour écrire plus v ite , & afin de fuivre
celui qui diétoit. Ceux qui écrivoient en notes ,
s’appeloient en lat. notariiy & en gr. x ^ t i o y ,
écrivains en notes , ou Tct%uypa<pot, écrivains expéditifs.
Mais peu de gens connoifïant les notes, 8c
les-premiers exemplaires 11e pouvant être ni affez
nets ni affez propres, d’autres écrivains qui pei-
gnoient bien & corre&ement, les copioient pour
ceux qui en avoient befoin, ou pour les vendre ;
ils s’appeloient calligraphes, mot compofé de
xaxxoç y beauté, & de yputya, f écris. Ce nom eft
ancien, puifqu’Eufèbe {Hift. Eccl. vi. 17.) & Saint-
Grégoire de Nazianze l’ont employé. Néophyte
& Théopempte font d’anciens calligraphes du
dixième & du onzième fiècles. On trouvera un
catalogue de tous les calligraphes connus, dans la
Palæographie du P. Montfaucon ( lib. I. c. 8.).
CALLINIQUE, air de danfe des anciens,
qui s’exécutoit fur des fiâtes , au rapport d’A-
thrénée.
CAL LIOPE, une des Mufes que certains écrivains
ont donnée pour mèrè aux Corybantes & aux
Syrènes. On ^ affuroit plus ordinairement qu’ elle
étoit mère d’Orphée , & que la mort de ce chantre
infortuné avoit été caufée par Vénus, qui
vouloit fe venger fur le fils de la poffeffion d’Ado-
nis , attribuée par la mère à Proferpine. La reine
de Gnide rendit les femmes de Thrace amou-
reufes d’Orphée , 8c dans leur fureur elles déchirèrent
ce fils de Calliope.
/ On attribuoit à Calliope l’invention de la poéfie
héroïque j & fon nom venoit, félon Diodore
C Bibl. hiftor. lib. iv. & 7. ) de fa belle voix »no
»»xî}ç o%oç. De cette étymologie Phur -
nutus conclut que Calliope eft le fymbole de la
rhétorique ou de l’ éloquence 5 mais Euftathe
( Iliad. A. v. -i. ) afiure qu elle étoit l’emblème
de la poéfie héroïque , la plus noble 8c la plus
ancienne des poéfies 5 quant à fa belle v oix , il
foutient que ce talent lui étoit commun avec fes
foeurs.
Calliope heroicos invenit provida cantus.
Sur les^médailles de la famille Pomponia, elle eft
défignée par une tête couronnée de laurier, avec
1 un rouleau ou volume d’où pendent des courroies,
dans le. champ de la médaille. Peut-être cependant
faut-il reconnoitre ici Clio ; car ce rouleau
eft commun a 1 un 8c a l autre dans les peintures
d’Herculanum.