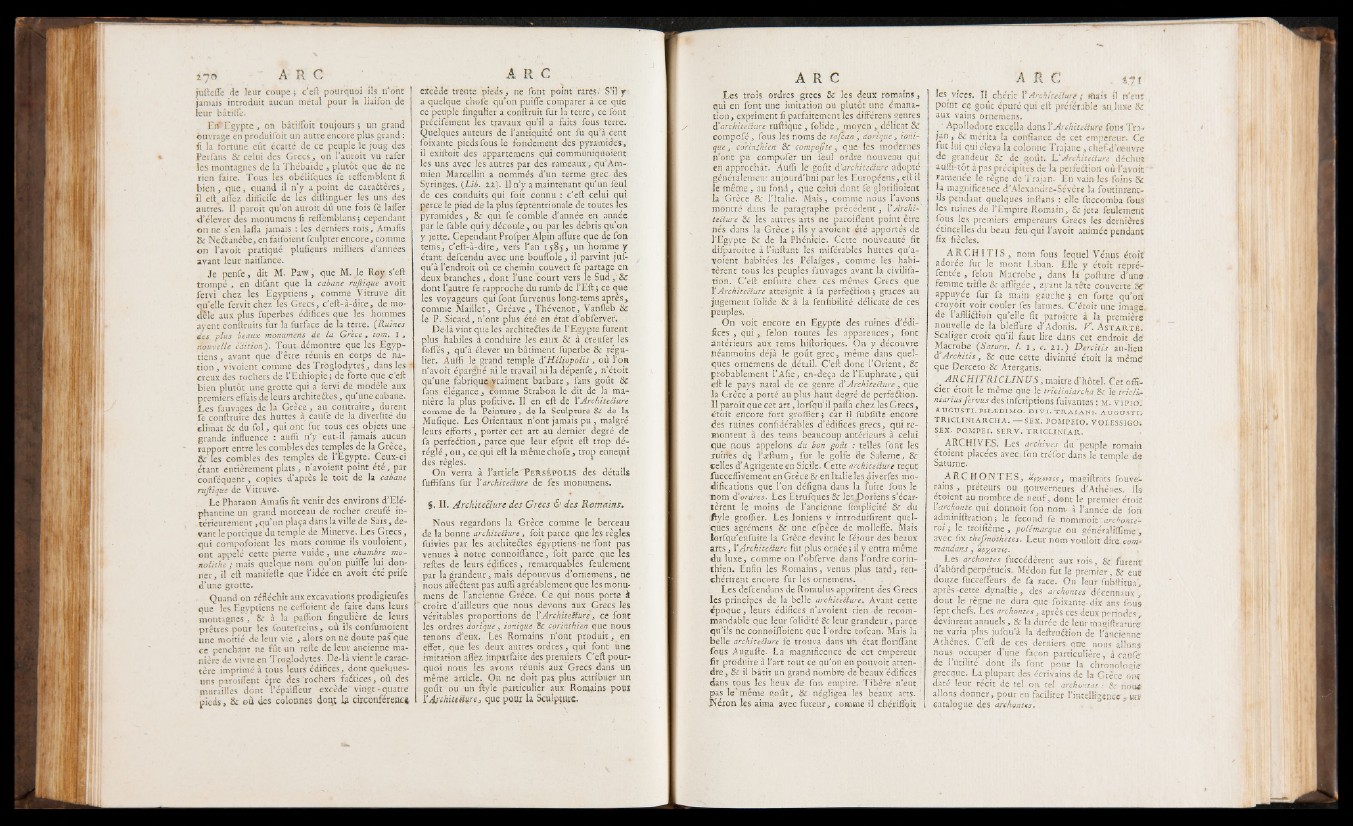
jufteffe de leur coupe j c’eft pourquoi ils n'ont
jamais introduit aucun métal pour k liaifon de
leur bâtifie.
Eift Egypte, on bâtifloit toujours } un grand
ouvrage en produifoit un autre encore plus grand :
fi la fortune eût écarté de ce peuple le joug des
Perfans & celui des Grecs , on l’auroit vu rafer :
les montagnes de la Thébaïde , plutôt que de ne
rien faire. Tous les obélifques fe reflemblent li
bien , que, quand il n’y a point de caraétères,
il eft allez difficile de les diftinguer les uns des
autres. Il paroît qu’ôn auroit dû une fois fé laffer
d’élever des monumens li relTemblans} cependant
on ne s’en lafla jamais : les derniers rois, Amafîs
& Neétanèbe, en faifoient fculpter encore, comme
on l’avoit pratiqué plulieurs milliers d’années
avant leur nailïance.
Je penfe, dit M. Paw, que M. Je Roy s’eft
trompé , en difant que la cabane ruftique avoit
fervi chez les Egyptiens , comme Yitruve dit
qu’elle fervitchez les Grecs, c’eft-à-dire, de modèle
aux plus fuperbes édifices que les hommes
ayent conllruits fur la furface de la terre. (Ruines
des plus beaux monumens de la Grèce, tom. I ,
nouvelle édition). Tout démontre que les Egyptiens
, avant que d’être réunis en corps de nation,
vivoient comme des Troglodytes, dans les '
creux des rochers de L’Ethiopie j de forte que ç ’eft
bien plutôt une grotte qui a fervi de modèle aux
premiers eflais de leurs archite&es, qu’une cabane.
Les fauvages de la Grèce, au contraire, durent
fe conftruire des huttes à, caufe de la diverfîté du
climat & du fo l, qui ont fur tous ces objets une
grande influence : aufli n’y'eut-il jamais aucun
rapport entre les combles des temples de la Grèce,
& les combles des temples de l’Egypte. Ceux-ci
étant entièrement plats, n’avoieht point été, par
conféquent, copies d’après le toit de la cabane
ruftique de Vitruve.
Le Pharaon Amalîs fit venir des environs d’Elé-
phantine un grand morceau de rocher creufé in-
. térieurement, qu’on plaça dans la ville de Sais, devant
le portique du temple de Minerve. Les Grecs ,
qui compofoient les. mots comme ils vouloient ,
ont appelé cette pierre vuide, une chambre monolithe
> mais quelque nom qu’on puiffe lui donner,
il eft manifefte que l’idée en avoit été prife
d’une grotte.
Quand on réfléchît aux excavations prodigieufes
que les Egyptiens ne ceffoient de faire dans leurs
montagnes, & à la paflion fingulière de leurs
prêtres pour les fouterreins, où ils çonfumoient
une moitié de leur vie , alors on ne doute pasque
ce penchant ne fût un relie de leur ancienne manière
de vivre en Troglodytes. De-là vient le caractère
imprimé à tous leurs édifices, dont quelques-
uns paroiflent êfre des rochers faétices, où des
murailles dont l’épai fleur excède’ vingt-quatre
pieds, & où des colonnes do%t U circonférence
excède trente pieds, ne font point rares. S’il y
a quelque chofe qu’on puiffe comparer à ce qiie
ce peuple finguüer a conftruit fur la terre, ce font
précifément les travaux qu’il a faits fous terre.
Quelques auteurs de l’antiquité ont fu qu’ à cent
foixante pieds fous le fondement-dès'pyramides,
il exiftoit des appartenons qui communiquoient
les uns avec les autres par des rameaux, qu’Am-
mien Marcellin a nommés d’un terme grec des
Syringes. (Lib. 22). Il n’y a maintenant qu’ un feul
de ces conduits qui foit connu : c’eft celui qui
perce le pied de la plus feptentrionale de toutes les
pyramides, & qui fe comble d’année en année
par le fable qui y découle, ou par les débris qu’on
y jette. Cependant Profper Alpin allure que de foa
tems, c’ eft-à-dire, vers l’an iy S y , un homme y
étant defeendu avec une bouffole, il parvint juf-
qu’à l’endroit où ce chemin couvert fe partage en
deux branches, dont l’une court vers le Sud ,■ &
dont l’autre fe rapproche du rumb de l’E ft} ce que
les voyageurs qui font furvenus long-tems après,
comme Maillet, Gréave, Thévenot, Vanfleb 8c
le P. Sicard, n’ont plus été en état d’obferver.
De-là vint que les archite&es de l’Egypte furent
plus habiles à conduire les eaux & à cireufer les
foliés, qu’à élever un bâtiment fuperbe & régulier.
Auffi le grand temple à*Héliopolis, ou l’on
n’avoit épargné ni le travail ni la dépenfe, n’étoit
qu’une fabriquqaytaiment barbare, fans goût &
fans élégance, comme Strabon le dit de la manière
la plus pofitive. Il en eft de Y Architecture
comme de la Peinture, de la Sculpture 8c de la
Mufique. Les Orientaux n’ont jamais pu, malgré
leurs efforts, porter cet art au dernier degré de
fa perfection, parce que leur efprit eft trop déréglé,
ou , ce.qui eft la même chofe, trop ennepii
des règles.
On verra à l’article "Persépol i s des détails
fuffifans fur Y architecture de fes monumens.
§. II. Architecture des Grecs & des Romains•
Nous regardons la Grèce comme le berceau
de la bonne .architecture , foit parce que les règles
fuivies par les architectes égyptiens ne font pas
venues a notre connoiffançe, foit parce. que les
relies de leurs édifices, remarquables feulement
par la grandeur, mais dépourvus d’ornemens, ne
nous affeCtent pas suffi agréablement que les monumens
de l’ancienne Grèce. Ce qui nous porte à
" croire d'ailleurs que nous devons aux Grecs les
véritables proportions de Y Architecture 3 ce font
les ordres dorique , ionique 8c corinthien que nous
tenons d’eux. Les Romains n’ont produit, en
effet, que les deux autres ordres, qui font une
imitation allez imparfaite des premiers C’èft pourquoi
nous les avons réunis aux Grecs dans un
même article. On ne doit pas plus attribuer un
goût ou un ftyie particulier aux Romains pous
YÀj-chïuftitre, que pour la Sculpture.
Les trois ordres grecs & les deux romains,
qui en font une imitation .ou plutôt une émanation,
expriment fi parfaitement les différens genres
d* architecture ruftique , foîide, moyen , délicat &
compofé, fous les noms de tojean, dorique, ionique
, corinthien 8 c comporte, que les modernes
n’ont pu compofer un feul ordre nouveau qui
en approchât. Auffi le‘ goût d'architecture adopté
généralement aujourd’hui par les Européens, eft il
le même, au fond, que celui dont fe glorifioient
la Grèce 8c l’Italie. Mais, comme nous l’avons
montré dans le paragraphe précédent, 1*Architecture
8c les autres arts ne paroiflent point être
nés dans la Grèce 5 ils y avoient été apportés de
l’Egypte & de la Phénicie. Cette nouveauté fit
difparoître à l’inftant les miférables huttes qu’a-
voient habitées les Pélafges, comme les: habitèrent
tous les peuples fauvages avant la civilifa-
tion. C’eft enfuite chez ces mêmes Grecs que
Y Architecture atteignit à fa perfeClion j grâces au.
jugement folide & à la fenfibilité délicate de ces
peuples. -, •
On voit encore en Egypte des ruines d’édifices
, qui,, félon toutes les apparences, font
antérieurs aux tems hiftoriques. On y découvre
néanmoins déjà le goût grec, même dans quelques
ornemens de .détail. C’eft: donc l’Orient, &
probablement l’Afie, en-deça de l’Euphrate, qui
eft le pays natal de ce genre d‘Architecture 3 que
la Grèce a porté au plus haut degré de perfection.
Il paroît que cet art, lorfqu’il paffa chez les Grecs,
étoit encore fort groffier} car il fubfifte encore
des ruines confidéràbles d’édifices grecs, qui remontent
à . des tems beaucoup antérieurs à celui
que nous appelons du.bon goût : telles font les
ruiifes dç Pæftum, fur le golfe de Salerne, &
celles d’Agrigente en Sicile. Cette architecture reçut
fucceffivement en Grèce & en Italie les diverfes modifications
que l’on défigna dans la fuite fous le
nom d‘ordres. Les Etrufques & lecJDoriens s’écartèrent
le moins de l’ancienne fimplicité & du
ftyie groffier. Les Ioniens y introduifirent quel- .
'ques agrémens 8c une efpèce de mollefle. Mais
lorfqu’enfuite la Grèce devint le féjour des beaux
arts, Y Architecture fut plus ornée} il y entra même
du luxe, comme on l’obferve dans I’prdre corinthien.
Enfin les Romains, venus plus tard, ren- ■
chérirent encore fur les ornemens. -
Les defeendans de Romulus apprirent des Grecs «
les principes de la belle architecture.- Avant cette ■
époque, leurs édifices n’avoient rien de recommandable
que leur folidité & leur grandeur, parce
qu’ils ne connoifloient que l ’Ordre tofean. Mais la '
belle architecture fe trouva dans un état floriflarit
fous Augufte. La magnificence de cet empereur
fit produire à l’art tout ce qu’on en pouvoir atteri- -
dre , 8c il bâtit un grand nombre de beaux édifices 1
dans tous les lieux de fort empire. Tibère n’eut •
pas le*même goût, & négligea les beaux atts. j
.Néron les aima avec fureur, comme il chérifloit l
les< Vices. Il chérit l Architecture y friais il n’eut
point ce goût épuré qui eft préférable au luxe &
aux vains ornemens.
Apollodore excella dans Y Architecture fous T iw
/an, & mérita la confiance de cet empereur. Ce
fut lui qui éleva la colonne Trajane, chef-d’oeuvre
de grandeur & de goût. L ’Architecture déchut
auffi-tôt à pas précipités de la perfection où l’avoit
ramenée le règne de Trajan. En vain les foins &
la magnificence d’AlexandreTSévère la foutinrent-
ils pendant quelques inftans : elle fuccomba fous
les ruines de l’Empire Romain, & jeta feulement
fous les premiers empereurs Grecs les dernières
étincelles du beau feu qui l’avoit animée pendant
fîx fiècles.
A R C H I T I S , nom fous lequel Vénus étôif
adorée fur le mont Liban. Elle y étoit repré-
fentee, félon Mncrobe, dans la pofture d’une
femme trifte & affligée, ayant la tête couverte 8c
appuyée fur fa main gauche ; en forte qu’orf
croyôit voir couler fes larmes. C’étoit une imagé,
de l’affliétioh qu’elle fit paroîrre à la première
nouvelle de la bleflure d’Adonis. H . A s t a r t é .
Scaliger croit qu’il faut lire dans cet endroit dé
Macrobe (Saturn. /. 1 , c. 2 1 . ) Dercitis au-lieu.’
d’Architis, & que cette divinité étoit la même'
que Derçetov& Atergatis.
.. A R CHITRI CLIN U S , maître d'hôtel. Cet officier
étoit le même què lé tricliniarcha 8c le triclL-
niariusfervus des inferiptions fuivantes : M. v ip io ;
AUGUSTI. FHÆDIMO. DIVI. TRAIANI. AUGUSTIi
TRICLINIARCHA. — SEX. POMPEIO. YOLESSIGO;
SEX. POMPEÏ. SERY. TRICLINIAR.
f ARCHIVES. Les archives du peuple romain
étoient placées avec fon tréfor dans le temple de
Saturne.
_ARC H O N T E S , llp%ovTtç, magiftfàts foüve-
rains , préteurs ou gouverneurs d’Athènes. Ils
étoient au nombre de, neuf, dont le premier étoic
Y archonte qui donnoit fon nom- à l’année de fon
adminiftration j le fécond fe nommoit archonte*
r°i > k troifieme, polémarque ou généraliffime ,
avec fix thefmotkètes. Leur nom vouloir àkccom*
mandans ap^otrtç.
, Les archontes fuccédètent aux rois, & furent'
d’abord perpétuels. Médon fut le premier, &r eut
douze fiiccelTeurs.de fa race. On leur fubfHtua»
après-cette dynaftie, des archontes décennaux ,,
dont le régné ne dura que foixante-dix ans fous
fept chefs. Les archontesy après çes deux périodes,
devinrent annuels, 8c la durée de leur nîagiftraturfe
ne varia plus jufqu’à la deftruéHon de l’ancienne'
Athènes’. Ç’eft de ces derniers que nous allons^
nous occuper d’une façon particulière, à caufe
de Ttïtiüté dont iis font pour la chronologie
grecque. La plupart des écrivains de la Grèce ont'
daté leur récit de tel ou tel archmtat ; Sr nous
allons donner, pour en faciliter l’intelligence $ u»
catalogue des archontes'.