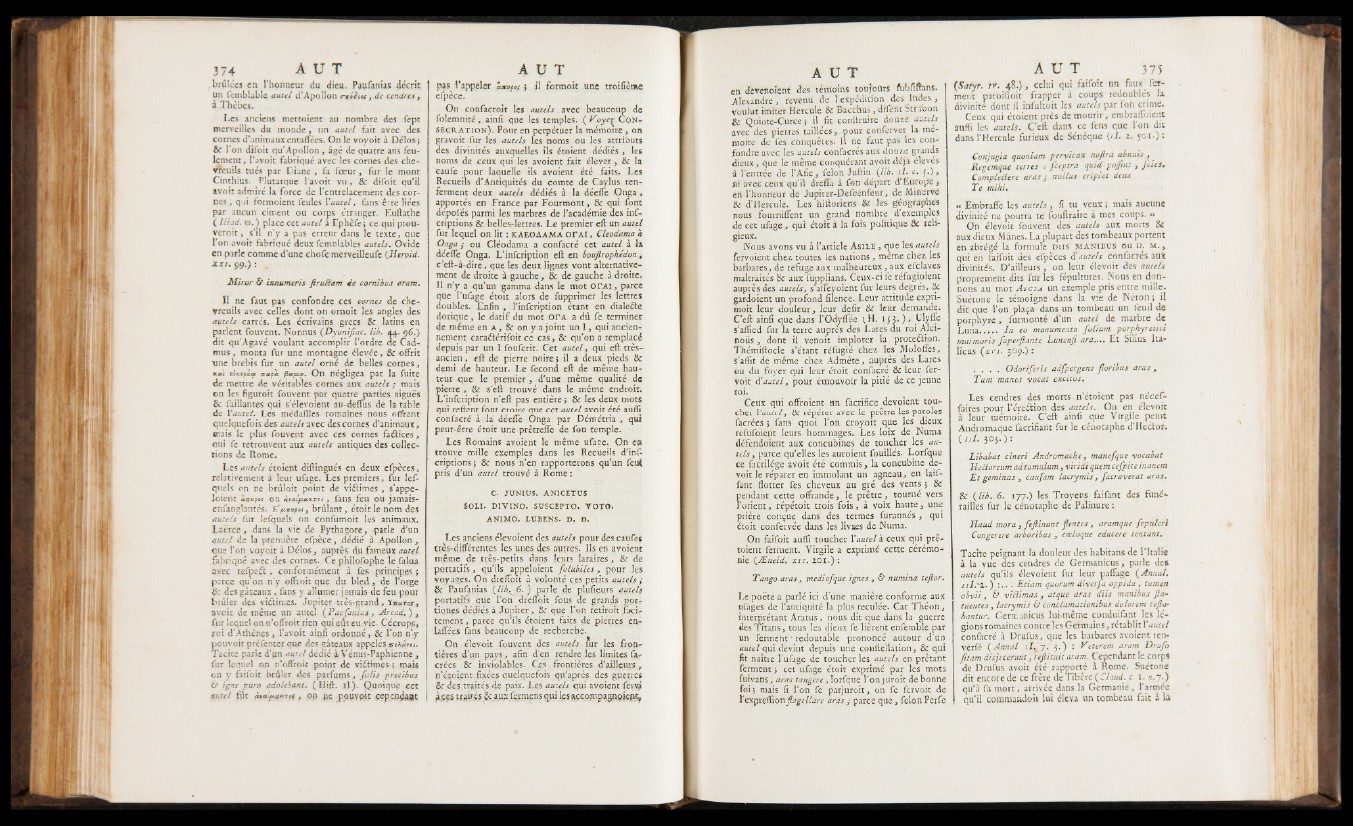
. brûlées en l’honneur du dieu. Paufanias décrit
un femblable autel d’Apollon onifots, de cendres y
à Thèbes.
Les anciens mettoient au nombre des fept
merveilles du monde, un autel fait avec des
cornes d’animaux entaffées. On le voyoit à Délos,
& l*on difoit qu’Apollon, âgé de quatre ans feulement,
l’avoit fabriqué avec les cornes des chevreuils
tués par Diane , fa foe u r , fur le mont
Cinthius. Plutarque l'avoit v u , & difoit qu’il
»voit admiré la force de l'entrelacement des cornes,
qui formoient feules Yautel * fans êrre liées
par aucun ciment ou corps étranger, Euftathe
( jlliad. 0. ) place cet autel a Ephèfej ce qui prou-
v eroit, s’il n’y a pas erreur dans le texte, que
l'on avoit fabriqué deux femblables autels. Ovide
en parle comme d’une chofe merveilleufe (Heroid.
x x / .p 0 .) : .
Miror & innumeris Jiruclam de cormbüs cram.
Il ne faut pas confondre ces carnes de chevreuils
avec celles dont on ornoit les angles des
autels carrés. Les écrivains grecs & latins en
parlent fouvent. Nonnus (Dyonifiac. lib, 44. 96.)
dit qu’Agavé voulant accomplir l’ordre de Cad-
mus, monta fur une montagne élevée, & offrit
une brebis fur un autel orné de belles cornes,
x«ù tixfpaof vttfu pu Lies. On négligea par la fuite
de mettre de véritables cornes aux autels ,* mais
on les figuroit fouvent par quatre parties aiguës
& failla-ntes qui s’élevoient au-deflus de la table
de Yautel. Les médailles romaines nous offrent
quelquefois des autels te des cornes d’animaux,
mais le plus fouvent avec ces cornes faétices,
oui fe retrouvent aux autels antiques des collections
de Rome,
Les autels étoient diftingués en deux efpèces,
relativement à leur ufage. Les premiers, fur lef-
queîs on ne brûloit point de victimes , s’appe-
loient as-opo/ ou «y«ip*TO(, (ans feu ou jamais-
enfanglantés. ü'p*vfoi3 brûlant, étoit le nom des
autels fur lefquels on confumoit les animaux.
Laërce, dans la vie de Pythagofe, parle d’un
autel de la première efpèce, .dédié à Apollon ,
que l’on voyoit à Délos, auprès du fameux autel
fa b riqué avec des cornes. Ce philofophe le falua
avec re fp e fl, conformément à Ces principes j
parce qu’on n’y offroit que du b led, de l’orge
des gâteaux, fans y allumer jamais de feu pour
brûler des victimes. Jupiter très-grand, Y*«™*,
avoit de même un autel ( Paufanias, Arcad.) ,
fur lequel on n’offroit rien qui eut eu vie. Cécrops,
roi d’Athènes, l’avoit ain.fi ordonné, 8c l’on n^y
pouvoit préfenter que des gâteaux appelés,«-txAfot.
Tacite parle d’pn autel dédié à Vénus-Paphienne ,
fur lequel on n’offroit point de victimes 5 mais
on y faifoit brûler des parfums, folis precibus
& igné pure adolebant. (Hift. i l ) . Quoique cet
autel fpt àtu'pjtKT^ , on pe ppuvpit cependant
pas l ’appeler faeyt# j II fbrmoit une troifième
efpèce.
On confacroit les autels avec beaucoup de
folemnité, ainfi que les temples- ( Voye^ Consé
c r a t io n ). Pour en perpétuer la mémoire, on
gravoit fur les autels les noms ou les attributs
des divinités auxquelles ils étoient dédiés , les
noms de ceux qui les avoient fait élever, & la
eaufe pour laquelle ils avoient été faits. Les
Recueils d’Antiquités du comte de Caylüs renferment
deux autels dédiés à la déefle Onga,
apportés en France par Fourmont, & qui font
dépofés parmi les marbres de l’académie des inscriptions
& belles-lettres. Le premier eft un autel
fur lequel on lit : KAEOAAMA o rA I , Cleodama a
Onga j ou Cléodama a confacré cet autel à la
déeffe Onga. L ’infcription eft en bouftrophédon,
c ’eft-à-dire, que les deux lignes vont alternativement
de droite â gauche, & de gauche à droite.
Il n’y a qu’un gamma dans le mot o rA i , parce
que l’ ufage étoit alors de fupprimer les lettres
doubles. Enfin , l’infcription étant en dialeéte
dorique , le datif du mot orA a dû fe terminer
de même en A, & on y a joint un I , qui anciennement
caraélérifoit ce cas, 8c qu’on a remplacé
depuis par un I fouferit. Cet autel, qui eft très-
ancien , eft de pierre noire > il a deux pieds &
demi de hauteur. Le fécond eft de même hauteur
que le premier, d’une même qualité de
pierre , & s’eft trouvé dans le même endroit.
L ’infcription n’ eft pas entière j & les deux mots
qui reftent font croire que cet autel avoit été auflî
confacré à la déefle Onga par Démétria , qui
peur-être étoit une prêtreffe de fon temple.
Les Romains avoient le même ufage. On en
trouve mille exemples dans les Recueils d’inf-
criptionsj 8c nous n’ en rapporterons qu’un feui
pris d’un autel trouvé à Rome :
C. JUNIUS. ANICETUS
Sou- DIVINO. SUSCEPTO. TOTO.
ANIMO. LUBENS. D. D.
Les anciens élevoîent des autels pour des caufes
très-différentes les unes des autres. Ils en avoient
meme de très-petits dan? leurs laraires, 8c de
portatifs, qu’ ils appelaient folubiles, pour les
yoyages. On dreffoit à volonté ces petits autels ;
8c Paufanias ( lib^^fi. :) parle de plufieurs autels
portatifs que l ’on dreffoit fous de grands portiques
dédiés à Jupiter, &r que l’on retirait Tacitement
, parce qu’ils étoient faits de pierres en-
Uffées fans beaucoup de recherche.
On élevoit fouvent des autels, fur les frontières
d’ un pays, afin d'en rendre les limites fa-
crées 8c inviolables. Ces frontière« d'ailleurs ,
n’croient fixées quelquefois qu’après des gpeçres
&r des . traité s de paix. Les autels qui avoient fervi
à.çes trgiré5,& a,ux ferme ns qui les ^çcojnpagnpieptp
en devenoient «les témoins toufoCirs fubfiftans. I
Alexandre, revenu de 1 expédition des Indes , 1
voulut imiter Hercule 8c Bâcchus, drfértt Stribon
& Quinte-Curce > il fit conftruire douze autel.s
avec des pierres taillées, pour conferver la mémoire
de fes conquêtes. 11 fie faut pas les con-*
fondre avec les autels confacrés aux douze grands
dieux, que le meme conquérant avoit déjà él-eves
à l’entrée de l’Afie, félon Juftin {lib. i l . c. y .) ,
ni avec ceux qu’ il dreffa à fôn dép'aft d’EUfop'é 3
en l’honneur dé Jupiter-Defeënfëut, de Minerve
& d’HercuIè. Les hiftoriens U les géographes
nous fourniffent un grand nombre d’exemples
de cet ufage, qui étoit à la fois politique 8c religieux.
Nous avons vu à l’article Asile , que les autels
fervoient chez toutes les nations, mêm,e chez le$
barbares, de refuge aux malheureux , aux elclaves
maltraités 8c aux fupplianS. Ceux-ci fe réfugioierit
auprès des autels* s’affeyoient fur leurs degrés, &
gardoient un profond filence. Leur attitude expri-
moit leur douleur, leur defîr & leur demande.
C’eft ainfi que dans l’Odyffée iH. 15 3 .)*^ üiyffe
s’aflied fur la terre auprès des Lares du roi Alci-
noüs, dont il venoit implorer la protection.
Thémiftocle s’étant réfugié chez les Moloffes,
s’affit de même chez Admète, auprès des Lares
ou du foyer qui leur étoit confacré & leur fer-
voit à*autel * pour émouvoir la pitié de et jeune
roi.
Ceux qui offroient un facrifice dévoient toucher
Yautel3 & répéter avec le prêtre les paroles
facrées > fans quoi l’on croyoït que les dieux
refufoiept leurs hommages. Les loix de Numa
défendoient aux concubines de toucher les autels
, parce qu elles les auroient fouillés. Lorfque
ce facrilége avoit été commis , la concubine de-
voit le réparer en immolant un agneau, en laif-
fant flotter fes cheveux au gré. des vents î &
pendant cette offrande, le prêtre, tourné vers
l’orient, répétoit trois fois , à voix haute, une
prière conçue dans des termes furannés, qui
étoit confervée dans les livues de Numa.
On faifoit auffi toucher Yautel à ceux qui prê-
toient ferment. Virgile a exprimé cette cérémonie
{Æneid. x n . 201.) :
Tango aras » xnedioƒque ignés , 6* niimina teftor.
Le poëte a parlé ici d'une manière conforme aux
ufages de l’antiquité la plus reculée. Car Théon,
interprétant Aratus, nous dit que dans la guerre
des Titajis, tous lés dieux fe lièrent enfemble par
un ferment? redoutable prononcé autour d'un
autel qui devint depuis une confteilation, & qui
fit naître l’ ufage de toucher les autels en prêtant
ferment i cet ufage étoit exprimé par les mots
fui vans, aras tangere, lorfque l’on juroit de bonne
foi j mais fi Ton fe parjuroit, on fe fervoit de
I e x p r e f f i o n llare aras ; parce que, félon Perfè
(Satyr. iv . 48 .) , celui qui faifoit un faux^ ferment
paroifloit frapper à coups redoublés la
divinité dont il infultoit les autels par fon crime.
Ceux qui étoient près de mourir, embraiïoient
auffi les autels. C’eft dans ce fens que l’on dit
dans l'Hercule furieux de Sénèque {il. 2. y o i- ) :
Conjugid quoniam pervicax nofira abnuis,
Regemque terres : feeptra quid poffint , feiei»
Compleftcre aras ,* nullus eripiet deus
Te mihii
c« Embraffe les autels, fi tu veux i mais aucune
divinité ne pourra te fouftraire à mes coups. >»
On élevoit fouvent des autels aux morts 8c
aux dieux Mânes. La plupart des tombeaux portent
en abrégé la formule diis m anibus ou d . m. ,
qui en faifoit des efpèces d* autels confacrés aux
divinités. D’ailleurs, on leur élevoit des autels
proprement dits fur les fépultures. Nous en donnons
au mot As c i a un exemple pris entre mille.
Suétone le témoigne dans la vie de Néron j il
dit que l’on plaça dans un tombeau un feuil de
porphyre, furmonté d’un autel de marbre de
Lima....... In eo monumento folium porpkyretici
marmoris fuperfiante Lunenfi ara.... Et Silius Ita-
licus ( x n . 309.) :
. . . . Odoriferis adfpergens floribus aras ,
Tum, mânes vocat excitos.
Les cendres des morts n’étoient pas nécef-
faires pour l’ére&ion des autels. On en élevoit
à leur mémoire. C’eft ainfi que Virgile peint
Andromaque facrifiant fur le cénotaphe d’Hector.
{ n i . 303,):
Libabat cineri Andromache, manefque vocabat
Hecioreum ad tumulum , viridi quem cefpite inanem
E t geminas , caufam lacrymis, facraverat aras.
8c {lib. 6 . 177.) les Troyens faifant des funérailles
fur le cénotaphe de Palinure :
Haud mora , feftinant fientes , aramque fepulcri
Congerere arboribus, coeloque educere tentant.
Tacite peignant la douleur des habitans de l ’Italie
à la vue des cendres de Germanicus, parle des
autels qu’ils élevoîent fur leur paffage {Annal,
ni.*'2. ) :.. . Etiam quorum diverfa oppida , tamçn
obvii, 6* viclimas, atque aras diis manibus fta-
tuentes , lacrymis & conclamationibus dolorem tefta-
bantur. Germanicus lui-même conduifant les légions
romaines contre les Germains, rétablit Yautel
confacré à Drufus, que les barbares avoient ren-
verfé {Annal ; J. 7. 3. ) : Veterem aram Drufo
fitam disjecerunt, refiituit aram. Cependant le.corps
de Drufus avoit été rapporté à Rome. Suétone
dit encore de ce frère de Tibère {Claude c. 1. n.7.)
qu’à fa mort, arrivée dans la Germanie, l’armée
qu’il commando« lui éleva un tombeau fait à la