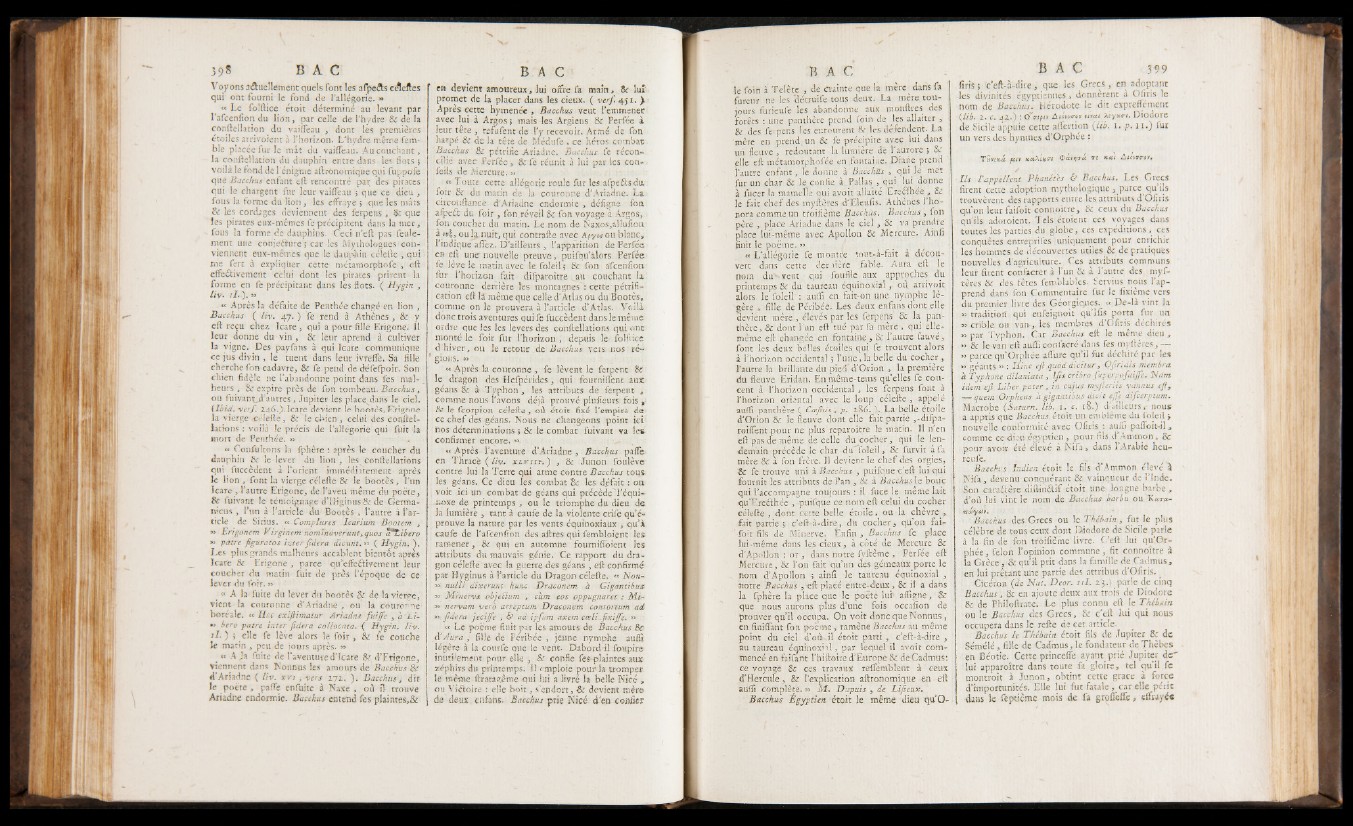
Voyons j&uellement quels font les afpeCts celeftes
qui ont fourni le fond de l’allégorie. »
«e Le folftice étoit déterminé au levant par
Fafcenfîon du lion, par celle de l’hydre 8c de la
conftellation du vaifleau , dont lès premières
étoiles arrivaient à l’horizon. L’hydre même fem-
ble placée fur le mât du vaifleau. Au couchant,
la conftellation du dauphin entre dans les flots 3
voilà le fond de l'énigme aftronomiq’ue qui fuppofe
que Bacckus enfant eft rencontré par des pirates
qui le chargent fur leur vaifleau 5 que ce dieu ,
fous la forme du lion, les effraye ; que les mâts
& les cordages deviennent des ferpens , 8c que
les pirates eux-mêmes fe précipitent dans la mer,
fous la forme de dauphins. Ceci n’eft pas feulement
une conjeéture ; car les Mythologues conviennent
eux-mêmes que le dauphin eélefte , qui
me fert à expliquer cette métarnorphofe, eft-
effectivement celui dont les pirates prirent la
fo rme en fe précipitant dans les flots. ( Hygin ,
liv. ri..). »
«« Après la défaite de Penthée changé en lion ,
Bacckus ( liv. 47. ) fe rend à Athènes 3 & y
eft reçu chez Icare , qui a pour fille Erigone. Il
leur donne du vin , 8c leur aprend à cultiver
la vigne. Des payfans à qui Icare communique
ce jus divin , le tuent dans leur ivrefle. Sa fille
cherche fon cadavre, & fe pend de défefpoir. Son
chien fidèle ne l’abandonne point dans les malheurs
, & expire près de fon tombeau. Bacckus,
ou fuivant^d’atitres, Jupiter les place dans le ciel.
[Ibid, verf 246.)Jcare devient le bontés,.Erigone
la vierge eélefte, & le chien, celui des conftel-
lations : voilà le précis de l ’allégorie qui fuit la
mort de Penthée. » ' •"•••
« Confultons la fphère : après le coucher du
dauphin & le lever du lio n , les conftellation s
qui fuccèdent à l’orient immédiatement après
le lion , font la vierge eélefte 8c le bootès , l’un
Icare, l’autre Erigone, de l’aveu même du poète,
8c fuivant le témoignage d’H-îginus & de Germa-
nicus j l’un à l’article du Bootè s, l’autre à l’ article
de Sirius. «- CompJures Icarium Bootem ,
» Erigoncm Virginem nomïnàverunt> quos amT,ibero
» pâtre figurât os inter Jidera dicunt. » (Hygin. Y
Les plus grands malheurs accablent bientôt apres
Icare & Erigone , parce qu’effeélivement leur
coucher du matin fuit de près l’époque de ce
lever du loir. »
_ « A la fuite du lever du bootès 8c de la vierge,
vient la couronne d’Ariadne , ou la couronne
boréale. « Hcc exijlimatur Ariadna fuiffe , a 'Li-
" bero pâtre inter fidera collocata. ( Hygin. liv.
jL ) 5 elle fe lève alors le fo ir , & fe couche
le marin , peu de jours après. »
• cc A J a fuite de l’aventure d’Icare & d’Erigpne,
viennent dans Nonnus les amours de Bacckus 8c
d’Ariadne ( liv. x v j , vers 272* ) . Bacckus/ dit
le poè te , pafle enfuite à Naxe , où fl- trouve
Ariadne endormie. Bacckus entend fes plaintes,&
e» devient amoureux, lui offre fa main, 8 c lui
promet de la placer dans les cieux. ( verf. 4 J i. V
Après cette hymenée , Bacckus veut l’emmener
avec lui à Argosj mais les Argiens &r Perfée à
leur tête tefufent de l’y recevoir. Armé de fon
harpé & de la tête de Médufe , ce héros combat
Bacckus & pétrifie Ariadne.. Bacckus fe réconcilié
avec Perfée, & fe réunit à lui par les confiais
de Mercure, »
« Toute cette allégorie roule fur les afpeéts du,
foir 8c du marin de la couronne d’Ariadne. La
circonftance à1 Ariadne endormie , défigne fon
afpeét du foir , fon.réveil & fon voyage à Argos,
fon coucher du matin. Le.nom de Naxos,allufion
àyu|, ou la.nuit, qui contrafte avec Apyoç ou blanc,
l’indique aflez. D’ailleurs , l’apparition de Perfée
en eft une nouvelle preuve, puifqu’ alors Perfée
. fe lève le matin avec le foleii > & fon afcenfîon
fur l’horizon fait difparoître .au couchant la
couronne derrière les montagnes : cette pétrification
eft là même que celle d’Atlas ou du Bootès,
comme on le prouvera à l’article d’Atlas. Voilà
.donc trois aventures qui fe fuccèdent dans le même
ordre que les les levers des conftellations qui ont
monté le foir fur l’horizon, depuis le- folftice
d'hiver, ou le retour.de Bacckus vers nos régions.
«: Après la couronne , fe lèvent le ferpent 8c
le dragon des Hefpérides, qui fourni fient aux
géans 8c à Typhon, les attributs de ferpent ,
comme nous l’avons déjà prouvé plufîeurs fo is ,
& le feorpion eélefte, où étoit fixé l’empiré de
ce chef des géans. Nous ne changeons point ici
nos déterminations 5 8c le combat fuivant va les
confirmer encore. ».
« Après ■ l’aventure d’Ariadne , Bacckus pafle
en Thracè ( l i v . x l v u t . ) , & Junon foulève
contre lui la Terre qui arme contre Bacckus tous
les géans. Ce dieu les combat ‘8c les défait : on
voit ici un combat de géans qui précède'Téqui-
iïoxe de printemps , ou le triomphe du dieu de
la lumière , tant à caufe de la violente crife qu’éprouve
la nature par les vents équinoxiaux , qu’ à
caufe de l’ afeenfion des aftres qui fembloient les
ramener, 8c qui en automne fournifloient fes
attributs du mauvais génie. Ce rapport du dragon
céleftë avec la guerre des géans , eft confirmé
par Hyginus à l’article du Dragon eélefte, « Non-*
nulli dïxerunt hune Draconem à Gigantibus,
» MinervA objettum , cùm eos oppugnaret : Mi-
» nervam ver b arrepturk' Draconem contortum ad
»• fidera jeciffe , & ad ipfum axem coeli.fixiffe. »
« Le poème finit par les amours de Bacckus 8c
d’Aura , fille de Péribée , jeune nymphe aufli
légère à la courfe que le vent. Dabord-il foupire
inutilement pour elle ? 8c confie fes-plaintes aux
zéphirs du printemps. Il emploie pourra tromper
le même ftratagême qui lui a livré la belle Nice ,
ou Victoire : elle b oit, s'endort, 8c devient mère
dé deux enfâns. Bacçhus prie Nice. d’en confier
l e f o in à T e l è t e , d e c r a in t e q u e l a m è r e^ d a n s fa
fu r e u r n e le s c ié c ru i fe t o u s d e u x . L a m è r e t o u jo
u r s f u r i e u f ë l e s a b a n d o n n e a u x m o n f t r e s d e s
f o r ê t s : u n e p a n t h è r e p r e n d f o in d e le s a l l a i t e r , ■
& d e s fes p e n s le s e n t o u r e n t & l e s d é f e n d e n t . L a
m è r e e n p r e n d , u n & f e p r é c ip i t e a v e c lu i d a n s
u n f l e u v e , r e d o u t a n t la lu m iè r e d e l’ a u r o r e > 8c
e l l e e f t m é t a m o r p h o f é e e n f o n t a in e . D i a n e p r e n d
l ’ a u t r e e n f a n t , le d o n n e à Bacckus , q u i l e m e t
f u r u n c h a r 8c l e c o n f i e à P a l l a s , q u i lu i d o n n e ;
à f u c e r la m a m e l l e q u i a v o i t a l l a i t é E r e é ïh é è , & 1
l e fa i t c h e f d e s m y f t è r e s d ’ E l e u f i s . A t h è n e s l’ h o -
n o r a c o m m e u n t r o i f i è m e Bacckus. Bacckus , f o n
p è r e , p la c e A r i a d n e d a n s l e c i e l , & v a p r e n d r e
p l a c e lu i -m êm e a v e c A p o l l o n 8c M e r c u r e . A i n f i
f in i t le p o è m e , m /
ré L ’ a l l é g o r i e f e .m o n t r e t o u t Tà - f a i t à d é c o u v
e r t d a n s c e t t e • d e r l i è r e f a b l e . A u r a e f t le
n o m d u v e n t q u i fo u f f l e a u x a p p r o c h e s d u
p r in t em p s 8c d u t a u r e a u é q u i n o x i a l ,- o ù a r r i v o i t
a lo r s l e f o l e i i ' : a u f l i e n f a i t - o n u n e n ym p h e l é g
è r e , f i ll e d e 'P é r i b é e . L e s d e u x e n f a n s d o n t e l l e
d e v ie n t m è r e , é le v é s p a r le s f e r p e f is 8c l a p a n t
h è r e , & d o n t i ’ u n e f t t u é p a r fa m è r e , q u i e l l e -
m êm e , e f t c h a n g é e e n f o n t a in e , 8c l ’ a u t r e f a u v e ,
f o n t l e s d e u x b e l le s é t o i l e s q u i fe t r o u v e n t a lo r s .
à l’ h o r i z o n o c c i d e n t a l ; l ’ u n e , l a b e l le d u c o c h e r ,
l ’a u t r e l a b r i l l a n t e d u p i e d d ’ O r i o n , la p r em iè r e
d u f l e u v e E r id a n . E n m . êm e - t em s q u ’ e l l e s f e c o u -
c e n t à l ’ h o r i z o n o c c i d e n t a l , le s f e r p e n s f o n t à
l ’ h o r i z o n o r i e n t a l a v e c l e l o u p e é l e f t e , a p p e lé
a u f l i p a n t h è r e ( Coefius ,• p. 2 8 6. )., L a b e l l e e t o i l e
d ’ O r io n 8c l e f l e u v e d o n t e l l e f a i t p a r t ie , - d i f p a -
r o i f l e n t .p o u r n e p lu s r e p a r o ï t r e l e m a t in . I l n’ e n
e f t p a s d e m êm e d e c e l l e d u c o c h e r , q u i l e l e n d
em a in p r é c è d e le c h a r d u " f o l e i i , 8c f u r v i t à fa
m è r e & a f o n f r è r e . 11 d e v ie n t l e c h e f d e s o r g i e s ,
8c f e t r o u v e u n i à Bacckus , p u i fq u e c ' e f t lu i q u i
f o u r n i t le s a t t r i b u t s d e P a n , & à Bacckus l e b o u c
q u i l’ a c c o m p a g n e t o u j o u r s : i l f u c e l e m êm e l a i t
q u 'E r ë é l h é e , p u i fq u e c e n o m e f t c e l u i d u c o c h e r
e é l e f t e , d o n t c e t t e b e l l e é t o i l e , o u l a c h è v r e , ,
f a i t p a r t ie ; c ’ e f t - à - d i r e , d u c o c h e r , q u ’ o n f a i -
- fo i t f i ls d e M in e r v e . E n f i n , Bacckus f e p l a c e
lu i -m êm e d a n s l e s c i e u x , à c ô t é d e M e r c u r e 8c
d ’A p o l l o n : o r , d a n s n o t r e l ÿ f t ê m e , P e r f é e e f t
M e r c u r e , & l ’ o n f a i t q u ’ u n d e s g ém e a u x p o r t e le
n o m d ’ A p o l l o n 5 a in f i l e t a u r e a u é q u in o x i a l ,
•n o t r e Bacckus , -e ft p l a c é e n t r e - d e u x , & i l a d a n s
l a fp h è r e l a p l a c e q u e l e p o è t e lu i ' a f l i g n e , &
q u e n o u s a u r o n s p lu s d ’ u n e f o i s o c c a f io n d e
p r o u v e r q u ’ i l o c c u p a . O n v o i t d o n c q u e N o n n u s ,
e n fin i f la n t f o n p o è m e , r am è n e Bacckus a u m êm e
p o in t d u c i e l d ’ o ù » i l é t o i t p a r t i , c ’e f t - à - d i r e ,
a u t a u r e a u é q u i n o x i a l , p a r l e q u e l i l a v o i t c o m m
e n c é e n f a i f a n t l’ h i f t o i r e d ’ E u r o p e 8c d e C a d m u s :
c e v o y a g e 8c c e s t r a v a u x r e f le m b le n t à c e u x
d ’ H e r c u l e , 8c l ’e x p l i c a t io n a f t r o n o m iq u e e n e f t
a u f l i C om p l è t e . » JYI, Dupuis , de Lifieux.
Bacckus Egyptien étoit le même dieu q uOfins
; c’eft-à-dire, que les Grecs, en adoptant
les divinités égyptiennes, donnèrent à Ofiris le
nom de Bacckus. Hérodote le dit expreflement
' (lib. 1. c. a l.) : d'rtpiv uveti Xtytsrt. Diodore
de Sicile appuie cette affertion (lib. 1. p. II .) fur
un vers des hymnes d’Orphée :
TynKcL fUV Kttl'ibri rt kui Aicvorov.
Ils Vappellent Phanétes & Bacckus. Les Grecs
firent cette adoption mythologique, parce qu’ils
trouvèrent des rapports entre les attributs d’Ofiris
qu’on leur faifoit connoïtre, 8c ceux du Bacckus
qu’ils adoroient. Tels étoient ces voyages dans
toutes les parties du globe, ces expéditions, ces
conquêtes entrepril'es uniquement pour enrichir
: les hommes de découvertes utiles & de pratiques
nouvelles d’agriculture. Ces attributs communs
leur firent confacrer à l’un & à l’autre des myftères
8c dés fêtes femblabies. Servius noits l’apprend
dans fon Commentaire fur le fixième vers
du premier livre des Géorgie]!1.es. « De-la vint la
»tradition qui eufeignoit qu’l fis porta fur un
» cribje. ou van-,, les membres d’Ofiris déchirés
» par Typhon. Car Bacchus eft le même dieu,
» & le van eft aufli confacré dans fes myfteres,—
»'parce qu’Orphée aflure qu’il fut déchiré par les
» géants » : Ilinc efl quod dicitur , Qjiridïs jnembra
a Typhone dilaniata , Ifis cribro fuperpofuiffe. 'Nam
idem eft Liber pater, in cujus myfteriis vannas eft,
— quem Orpheus a gigantibus diat effe difeerptum.
Macrobe (Saturn. lib. 1. c. 18.) d ailleursnous
a appris que Bacchus. étoit un emblème du foleii j
nouvelle conformité avec Olïris : aufli pafloit-il,
comme ce dieu égyptien, pour fils d Ammon, 8c
• pour avoir été élevé à Nifa, dans l’Arabie heu-
re.ufe,. " /
Bacchus Indien étoit le fils d’Ammon élevé à
Nifa, devenu conquérant 8c, vainqueur de l’Inde.
Son caractère diftiriétif étoit une longue barbe,
d’où lui vint le nom de Bacchus barbu ou K«r«-
%a'ycdv.
Bc'cchus des Grecs ou le Tkêbain, fut le plus
célèbre de tous ceux dont Diodore de Sicile parle
à la-fin de fon troifieme livre. C.’ett lui qu’Orphée,
félon l’opinion commune, fit connoïtre à
la Grèce, & qu’il prit dans la famille de Cadmus,
en lui prêtant une partie des attribus d’Ofiris.
Cicéron (de Nat. Deor. n i . 23.) parle de cinq
Bacchus, & en ajoute deux aux trois de Diodore
& de Fhiloftrate. Le plus connu eft le Thcbain.
ou le Bacchus des Grecs, & c’eft lui qui nous
occupera dans le refte de cet article.
Bacchus le Thébain étoit fils de Jupiter & de
Sémélé, fille de Cadmus, le fondateur de Thèbes
en Béotie. Cette princelfe ayant prié Jupiter d e '
lui apparoîcre dans toute fa gloire, tel qu’il fe
montroit à Junon, obtint cette grâce à force
d’importunités. Elle lui fut fatale, car elle périt
| dans le fepticme mois de fa groflèffe, effrayé*