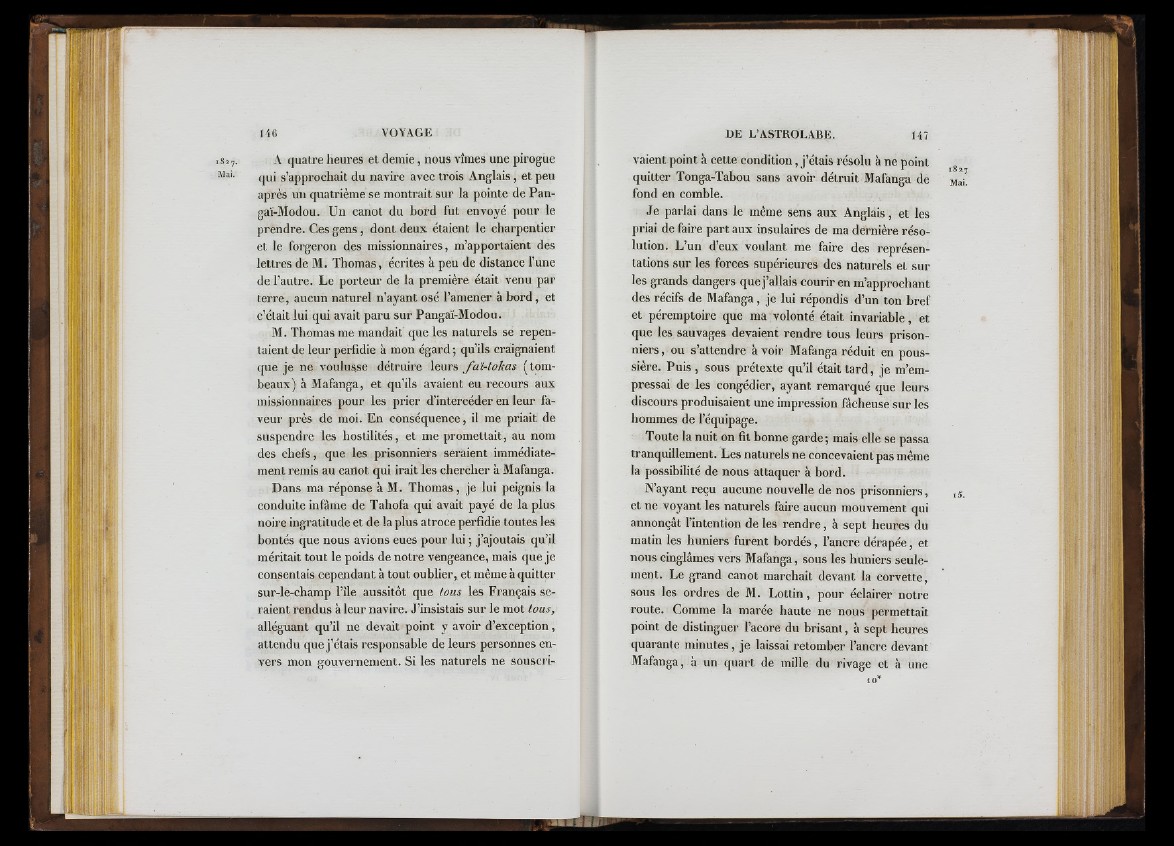
A quatre heures et demie, nous vîmes une pirogue
qui s’approchait du navire avec trois Anglais, et peu
après un quatrième se montrait sur la pointe de Pangaï
Modou. Un canot du bord fut envoyé pour le
prendre. Ces gens, dont deux étaient le charpentier
et le forgeron des missionnaires, m’apportaient des
lettres de M. Thomas, écrites à peu de distance l’une
de l’autre. Le porteur de la première était venu par
terre, aucun naturel n’ayant osé l’amener à bord, et
c’était lui qui avait paru sur Pangaï-Modou.
M. Thomas me mandait que les naturels se repentaient
de leur perfidie à mon égard ; qu’ils craignaient
que je ne voulusse détruire leurs faï-tokas (tombeaux)
à Mafanga, et qu’ils avaient eu recours aux
missionnaires pour les prier d’intercéder en leur faveur
près de moi. En conséquence, il me priait de
suspendre les hostilités, et me promettait, au nom
des chefs, que les prisonniers seraient immédiatement
remis au cadot qui irait les chercher à Mafanga.
Dans ma réponse à 51. Thomas , je lui peignis la
conduite infâme de Tahofa qui avait payé de la plus
noire ingratitude et de la plus atroce perfidie toutes les
bontés que nous avions eues pour lui ; j’ajoutais qu’il
méritait tout le poids de notre vengeance, mais que je
consentais cependant à tout oublier, et même à quitter
sur-le-champ l’île aussitôt que tous les Français seraient
rendus à leur navire. J’insistais sur le mot tous,
alléguant qu’il ne devait point y avoir d’exception,
attendu que j ’étais responsable de leurs personnes envers
mon gouvernement. Si les naturels ne souscrivaient
point à cette condition, j ’étais résolu à ne point
quitter Tonga-Tabou sans avoir détruit Mafanga de
fond en comble.
Je parlai dans le même sens aux Anglais, et les
priai de faire part aux insulaires de ma dernière résolution.
L ’un d’eux voulant me faire des représentations
sur les forces supérieures des naturels et sur
les grands dangers quej’allais courir en m’approchant
des récifs de Mafanga, je lui répondis d’un ton bref
et péremptoire que ma volonté était invariable, et
que les sauvages devaient rendre tous leurs prisonniers
, ou s’attendre à voir Mafanga réduit en poussière.
Puis, sous prétexte qu’il était tard, je m’empressai
de les congédier, ayant remarqué que leurs
discours produisaient une impression fâcheuse sur les
hommes de l’équipage.
Toute la nuit on fil bonne garde; mais elle se passa
tranquillement. Les naturels ne concevaient pas même
la possibilité de nous attaquer à bord.
N’ayant reçu aucune nouvelle de nos prisonniers,
et ne voyant les naturels faire aucun mouvement qui
annonçât l’intention de les rendre, à sept heures du
matin les huniers furent bordés, l’ancre dérapée, et
nous cinglâmes vers Mafanga, sous les huniers seulement.
Le grand canot marchait devant la corvette,
sous les ordres de M. Lottin, pour éclairer notre
route. Comme la marée haute ne nous permettait
point de distinguer l’acore du brisant, à sept heures
c[uarante minutes, je laissai retomber l’ancre devant
Mafanga, à un quart de mille du rivage et à une
1827
Mai.
i5.