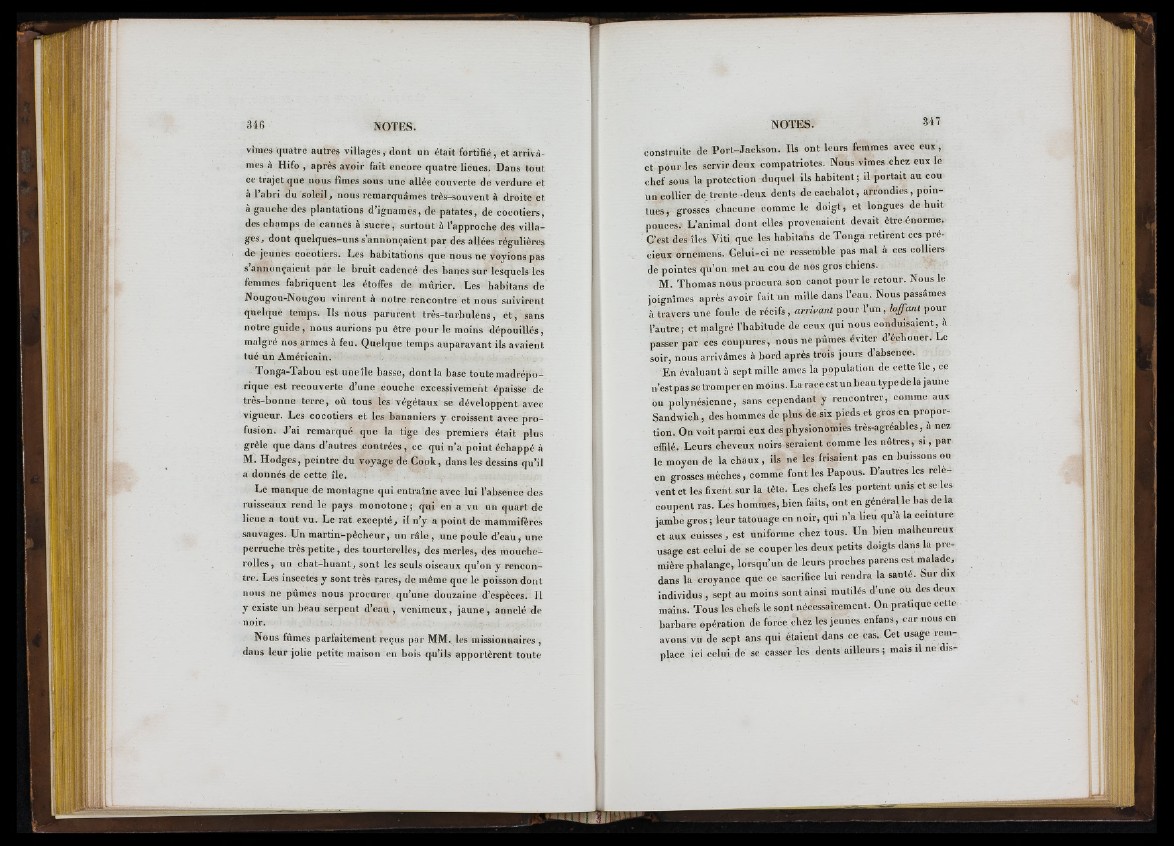
vîmes quatre autres v i lla g e s , d ont un était fo r tifié , et ar riv âmes
à Hifo , après av o ir fait enco re q ua tre lieues. Dans tout
ce trajet que nous fîmes sous une allée couverte de v e rdure et
a 1 abri du s o le il, nous remarquâmes très-souvent à dro ite et
à g auche des plantations d ’ign am e s , de p ata tes , de co co t ie r s ,
des champs de cannes à su c r e , surtout à l’approche des v illa g
e s , d ont quelques -un s s’an n on ca ien t par des allées régulières
de jeunes co cotiers . L c s hab itations que nous ne v o y ion s pas
s’annonça ieut par le b ru it cadencé des bancs sur lesquels les
femmes fab riquen t les étoffes de m ûrier. Les habitans de
Nou go u -N ou go u v inrent à notre rencontre et nous suivirent
que lque temps. Ils nous p aruren t tr è s - tu rb u len s , e t , sans
notre gu id e , nous aurions pu être p o u r le moins d ép o u illé s ,
malgré nos armes à feu. Q u e lq u e temps aup a rav an t ils avaient
tué un Amé r ica in .
T on g a -T ab o u est une île basse, d ont la base toute m ad rép o -
rique est re cou v e r te d’une co u ch e excessivement épaisse de
trè s-b on n e te r re , où tous le.s végétaux se d é v elopp en t avec
vigu eu r . Le s co cotie rs et les bananiers y croissent avec p ro fusion.
J’ai remarqué que la tig e des premiers était plus
g rê le que dans d ’autres co n t ré e s , ce qui n’a p o in t échapp é à
M . H o d g e s , p e in tre du v o y a g e de C o o k , dans les dessins qu ’il
a donnés de ce tte île .
L e manque de montagne qui entraîne avec lu i l’absence des
ruisseaux rend le p ays m on o ton e ; qui en a vu un qua rt de
lieue a to u t vu . L e rat e x c ep té , il n’y a p o in t de mammifères
sauvages. U n m a r t in -p ê ch eu r , un râle , une poule d ’e a u , une
perruche très p e t it e , des tourterelles, des merles, des mouche-
ro lle s , un ch a t-h u an t , sont les seuls oiseaux qu’on y ren con tre.
Lc s insectes y sont très rares, de même que le poisson dont
nous ne pûmes nous p rocurer q u ’une douzaine d’espèces. Il
y existe un beau serpent d’eau , v en im eu x , ja u n e , annclé do
n oir.
Nous fûmes parfaitement reçus par M M . les missionnaires ,
dans leu r jo lie petite maison en bois qu’ils apportèrent toute
eonstrnile de P o r t-J a ck so n . Ils ont leurs femmes avec e u x ,
et p o u r les servir deux compatriotes. Nous vîmes chez eux le
ch e f sous la prote ction du qu e l ils h ab iten t; il p ortait au cou
un co llie r de tr ente -d eu x dents de c a ch a lo t , a r ron d ie s , p o in tu
e s , grosses chacune comme le d o ig t , et longues de huit
pouc es . L ’animal dont elles prov enaient devait être énorme.
C ’ est des îles V it i que les hab itans de T o n g a retirent ces p ré c
ieux ornemens. C e lu i - c i ne ressemble pas mal à ces colliers
de pointes q u ’on met au co u de nos gros chiens.
M . T h om a s nous p ro cu ra son cano t p o u r le retour. Nous le
jo ignîmes après av o ir fa it un mille dans l’eau . Nous passâmes
à travers une foule de r é c if s , arrivant p our l ’u n , loffant p ou r
l’autre; et malgré Thabilude de ceux qui nous conduisaient, à
passer p ar ces co u p u re s , nous ne pûmes é v ite r d’éehouer. Le
so ir , nous arrivâmes à b o rd après trois jours d’absence. ^
E n é v aluan t à sept mille ames la p op u la tion de cette île , ce
n’est pas se tromper en moins. L a race est un beau typ e de la jaune
ou p o lyn é s ien n e , sans cependant y ren con t re r , comme aux
S a n dw ic h , des hommes de plus de six pieds et gros en p rop o r tion
. On v o it parmi eux des physionomies très-agréables, à nez
effilé. L eu r s chev eux noirs seraient comme les nôtres, s i , par
le moy en de la ch a u x , ils ne les frisaient pas en buissons ou
en grosses m è ch e s , comme fo n t les P apous . D’autres les re lè vent
et les fixent sur la tête. Les chefs les p ortent unis et se les
co u p en t ras. Le s hommes, bien faits, on t en général le bas de la
jambe gros ; le u r tatoua ge en n o ir, qui n’a lieu qu’à la ceinture
et aux cu is se s , est uniforme chez tous. U n bien malheureux
usage est c e lu i de se co u p e r les deux petits doigts dans la première
p ha lan g e , lo rsqu’un de leurs proches parens est malade,
dans la croyan ce que ce sacrifice lu i rendra la saute. S u r dix
individus , sept au moins sont ainsi mutilés d’une ou des deux
mains. T o u s les chefs le sont nécessairement. On p ratique cette
ba rbare opération de force chez les jeunes en fan s , ca r nous en
avons vu de sept ans q u i étaient dans ce cas. C e t usage remplace
ic i ce lu i de se casser les dents ailleurs ; mais il ne dis