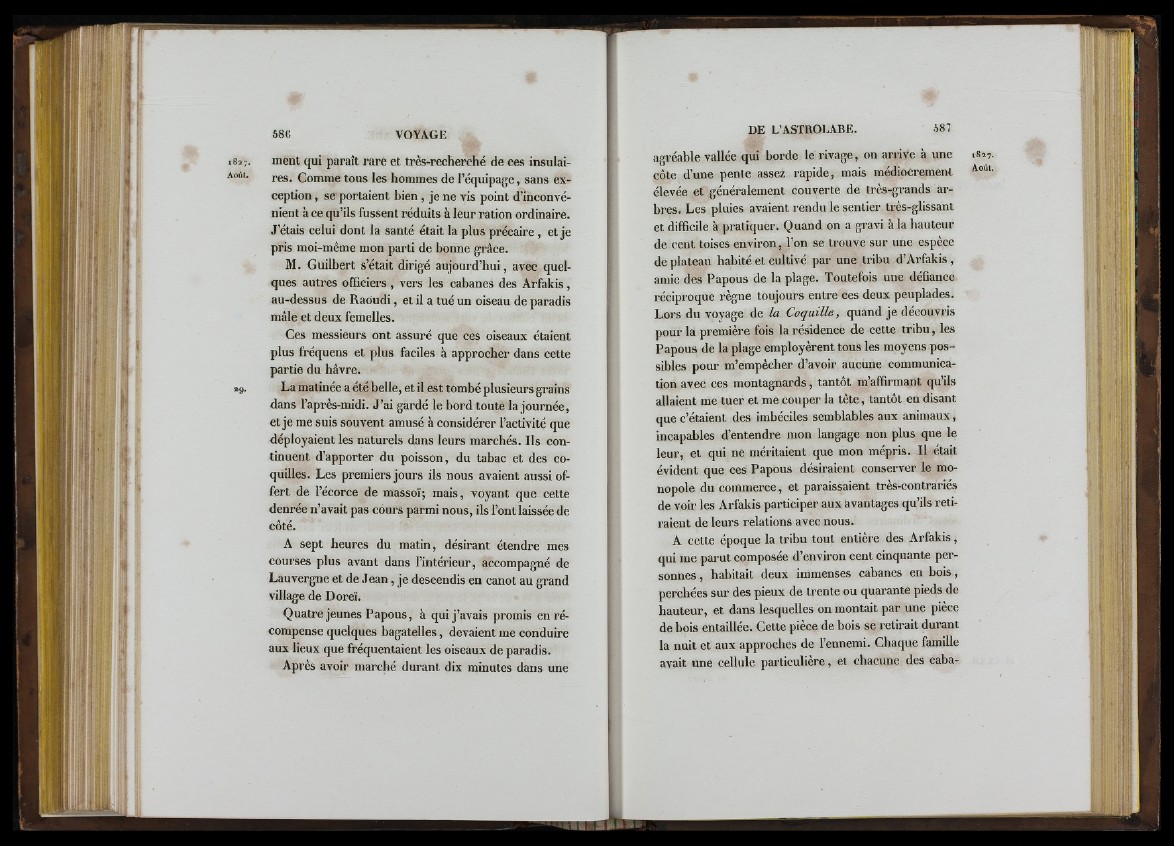
68G
1827.
Août.
ment qui paraît rare et très-recherché de ces insulaires.
Comme tous les hommes de l’équipage, sans exception
, se portaient bien , je ne vis point d’inconvénient
à ce qu’ils fussent réduits à leur ration ordinaire.
J’étais celui dont la santé était la plus précaire, et je
pris moi-même mon parti de bonne grâce.
M. Guilbert s’était dirigé aujourd’hui, avec quelques
autres officiers , vers les cabanes des Arfakis,
au-dessus de Raoudi, et il a tué un oiseau de paradis
mâle et deux femelles.
Ces messieurs ont assuré que ces oiseaux étaient
plus fréquens et plus faciles à approcher dans cette
partie du hâvre.
La matinée a été belle, et il est tombé plusieurs grains
dans l’après-midi. J’ai gardé le bord toute la journée,
et je me suis souvent amusé à considérer l’activité que
déployaient les naturels dans leurs marchés. Ils continuent
d’apporter du poisson, du tabac et des coquilles.
Les premiers jours ils nous avaient aussi offert
de l’écorce de massoï; mais, voyant que cette
denrée n’avait pas cours parmi nous, ils l’ont laissée de
côté.
A sept heures du matin, désirant étendre mes
courses plus avant dans l’intérieur, accompagné de
Lauvergne et de Jean, je descendis en canot au grand
village de Doreï.
Quatre jeunes Papous, à qui j ’avais promis en récompense
quelques bagatelles, devaient me conduire
aux lieux que fréquentaient les oiseaux de paradis.
Après avoir marché durant dix minutes dans une
agréable vallée qui borde le rivage, on arrive à une
côte d’une pente assez rapide, mais médiocrement
élevée et généralement couverte de très-grands arbres.
Les pluies avaient rendu le sentier très-glissant
et difficile à pratiquer. Quand on a gravi à la hauteur
de cent toises environ, l ’on se trouve sur une espèce
de plateau habité el cultivé par une tribu d’Arfakis,
amie des Papous de la plage. Toutefois une défiance
réciproque règne toujours entre ces deux peuplades.
Lors du voyage de la Coquille, quand je découvris
pour la première fois la résidence de cette tribu, les
Papous de la plage employèrent tous les moyens possibles
pour m’empêcher d’avoir aucune communication
avec ces montagnards, tantôt m’affirmant qu’ils
allaient me tuer et me couper la tête, tantôt en disant
que c’étaient des imbéciles semblables aux animaux,
incapables d’entendre mon langage non plus que le
leur, el qui ne méritaient que mon mépris. Il était
évident que ces Papous désiraient conserver le monopole
du commerce, et paraissaient très-contrariés
de voir les Arfakis participer aux avantages qu’ils retiraient
de leurs relations avec nous.
A cette époque la tribu tout entière des Arfakis,
qui me parut composée d’environ cent cinquante personnes
, habitait deux immenses cabanes en bois,
perchées sur des pieux de trente ou quarante pieds de
hauteur, et dans lesquelles on montait par une pièce
de bois entaillée. Cette pièce de bois se retirait durant
la nuit et aux approches de l’ennemi. Chaque famille
avait une cellule particulière, et chacune des caba-
1827.
Août.