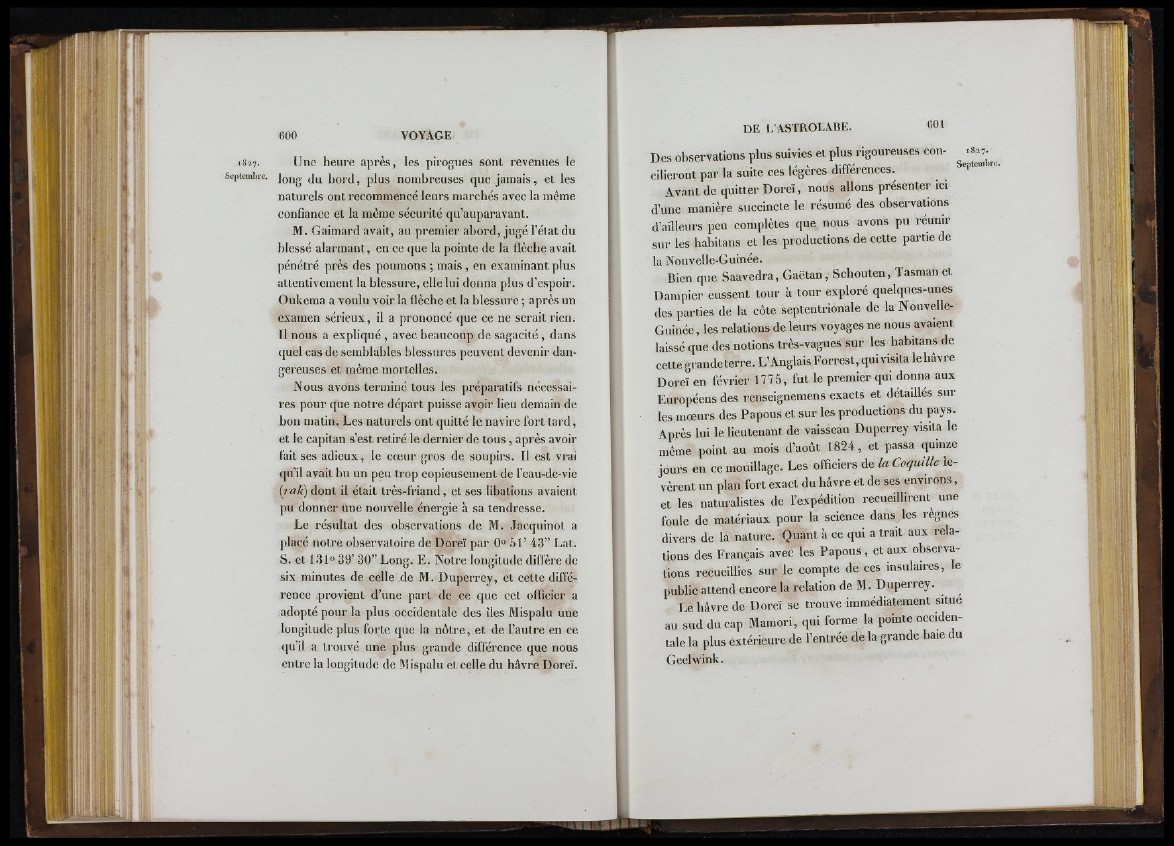
I S 2 7 .
S o p lc in lf rc .
Une heure après, les pirogues sonl revenues le
long du bord, plus nombreuses que jamais, el les
naturels ont recommencé leurs marchés avec la même
confiance et la même sécurité cju’auparavant.
M. Gaimard avait, au premier abord, jugé l’état du
blessé alarmant, en ce que la pointe de la flèche avait
pénétré près des poumons ; mais , en examinant plus
attentivement la blessure, elle lui donna plus d’espoir.
Oukema a voulu voir la flèche et la blessure ; après un
examen sérieux, il a prononcé que ce ne serait rien.
Il nous a expliqué , avec beaucoup de sagacité, dans
quel cas de semblables blessures peuvent devenir dangereuses
et même mortelles.
Nous avons terminé tous les préparatifs nécessaires
pour que notre départ puisse avoir lieu demain de
bon matin. Les naturels ont quitté le navire foj-t tard,
et le capitan s’est retiré le dernier de tous, après avoir
fait ses adieux, le coeur gros de soupirs. Il est vrai
qu’il avait bu un peu trop copieusement de l’eau-de-vie
(yak) dont il était très-friand, et ses libations avaient
pu donner une nouvelle énergie à sa tendresse.
Le résultat des observations de M. Jacquinot a
placé notre observatoire de Doreï par 0° 61’ 43” Lat.
S. et 131° 39’ 30” Long. E. Notre longitude diffère de
six minutes de celle de M. Duperrey, et cette différence
provient d’une part de ce que cet officier a
adopté pour la plus occidentale des îles Mispalu une
longitude plus forte que la nôtre, et de l’autre en ce
([u’il a trouvé une plus grande différence que nous
entre la longitude de Mispalu et celle du hâvre Doreï.
Des observations plus suivies el plus rigoureuses con-
cilleront par la suite ces légères différences.
Avant de quitter Doreï, nous allons présenter ici
d’une manière succincte le résumé des observaUons
d’ailleurs peu complètes que nous avons pu réunir
sur les habitans et les productions de cette partie de
la Nouvelle-Guinée.
Bien que Saavedra, Gaétan, Schouten, Tasman el
Dampier eussent tour à tour exploré quelques-unes
des parties de la côte septentrionale de la Nouvelle-
Guinée, les relations de leurs voyages ne nous avaient
laissé que des notions très-vagues sur les habitans de
cette grandeterre. L’Anglais Forrest, qui visita lehâvre
Doreï en février 1775, fut le premier qui donna aux
Européens des renseignemens exacts et détaillés sur
les moeurs des Papous et sur les productions du pays.
Après lui le lieutenant de vaisseau Duperrey visita le
même point au mois d’aoôt 1824, et passa quinze
jours en ce mouillage. Les officiers de la Coquille levèrent
un plan fort exact du hâvre et de ses environs,
et les naturalistes de l’expédition recueillirent^ une
foule de matériaux pour la science dans les régnés
divers de la nature. Quant à ce qui a trait aux relations
des Français avec les Papous , et aux observations
recueillies sur le compte de ces insulaires, le
public attend encore la relation de M. Duperrey.
Le hâvre de Doreï se trouve immédiatement situe
au sud du cap Mamori, qui forme la pointe occidentale
la plus extérieure de l’entrée de la grande baie du
Geelwink.