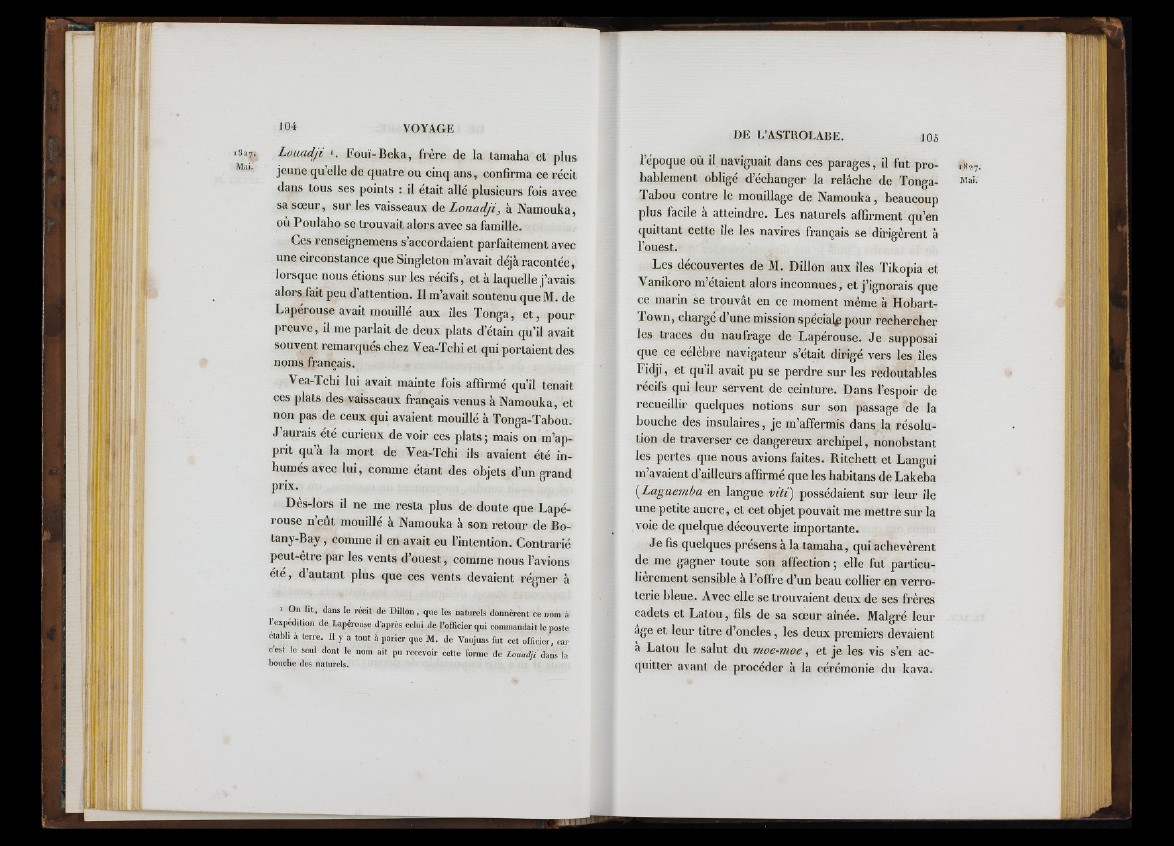
( '
i
1827.
Mai.
Louadji 1. Fouï-Beka, frère de la lamaha el plus
jeune quelle de quatre ou cinq ans, confirma ce récit
dans tous ses points : il était allé plusieurs fois avec
sa soeur, sur les vaisseaux de Louadji, à Namouka,
où Poulaho se trouvait alors avec sa famille.
Ces renseignemens s’accordaient parfaitement avec
une circonstance que Singleton m’avait déjà racontée,
lorsque nous étions sur les récifs, et à laquelle j’avais
alors fait peu d’attention. Il m’avait soutenu queM. de
Lapérouse avait mouillé aux iles Tonga, e t , pour
preuve, il me parlait de deux plats d’étain qu'il avait
souvent remarqués chez Vea-Tchi el qui portaient des
noms français.
Vea-Tchi lui avait mainte fois affirmé qu’il tenait
ces plats des vaisseaux français venus à Namouka, et
non pas de ceux qui avaient mouillé à Tonga-Tabou.
J ’aurais été curieux de voir ces plats; mais on m’apprit
q u a la mort de Vea-Tchi ils avaient été inhumés
avec lui, comme étant des objets d’un grand
prix.
Dès-lors il ne me resta plus de doute que Lapérouse
n’eût mouillé à Namouka à son retour de Bo-
tany-Bay, comme il en avait eu l’intention. Contrarié
peut-être par les vents d’ouest, comme nous l’avions
été, d’autant plus que ces vents devaient régner à
> Ou h t , dans le récit de D illo n , que les naturels donnèrent ce nom à
l’expédition de Lapérouse d’après celui de l’officier qui commandait le posie
établi à terre. Il y a tout ,à parier que M. de Vaujuas fut cet officier, car
c est le seul dont le nom ait pu recevoir celle forme de Louadji dans la
bouche des nahirels.
l’époque où il naviguait dans ces parages, il fut probablement
obligé d’échanger la relâche de Tonga-
Tabou contre le mouillage de Namouka, beaucoup
plus facile à atteindre. Les naturels affirment qu’en
quittant cette île les navires français se dirigèrent à
l’ouest.
Les découvertes de M. Dillon aux îles Tikopia et
Vanikoro m’étaient alors inconnues, et j ’ignorais que
ce marin se trouvât en ce moment même à Hobart-
Town, charge d’une mission spéciale pour rechercher
les traces du naufrage de Lapérouse. Je supposai
que ce célèbre navigateur s’était dirigé vers les îles
Fidji, et qu’il avait pu se perdre sur les redoutables
récifs qui leur servent de ceinture. Dans l’espoir de
recueillir quelques notions sur son passage de la
bouche des insulaires, je m’affermis dans la résolution
de traverser ce dangereux archipel, nonobstant
les pertes que nous avions faites. Ritchett et Langui
m’avaient d’ailleurs affirmé que les habitans de Lakeba
[Laguemba en langue viti) possédaient sur leur ile
une petite ancre, et cet objet pouvait me mettre sur la
voie de quelque découverte importante.
Je fis quelques présens à la tamaha, qui achevèrent
de me gagner toute son affection ; elle fut particulièrement
sensible à l ’offre d’un beau collier en verroterie
bleue. Avec elle se trouvaient deux de ses frères
cadets et Latou, fils de sa soeur aînée. Malgré leur
âge et leur titre d’oncles, les deux premiers devaient
a Latou le salut du moe-moe, et je les vis s’en ac-
(|nitter avant de procéder à la cérémonie du kava.
1827.
M a i.
? I
;