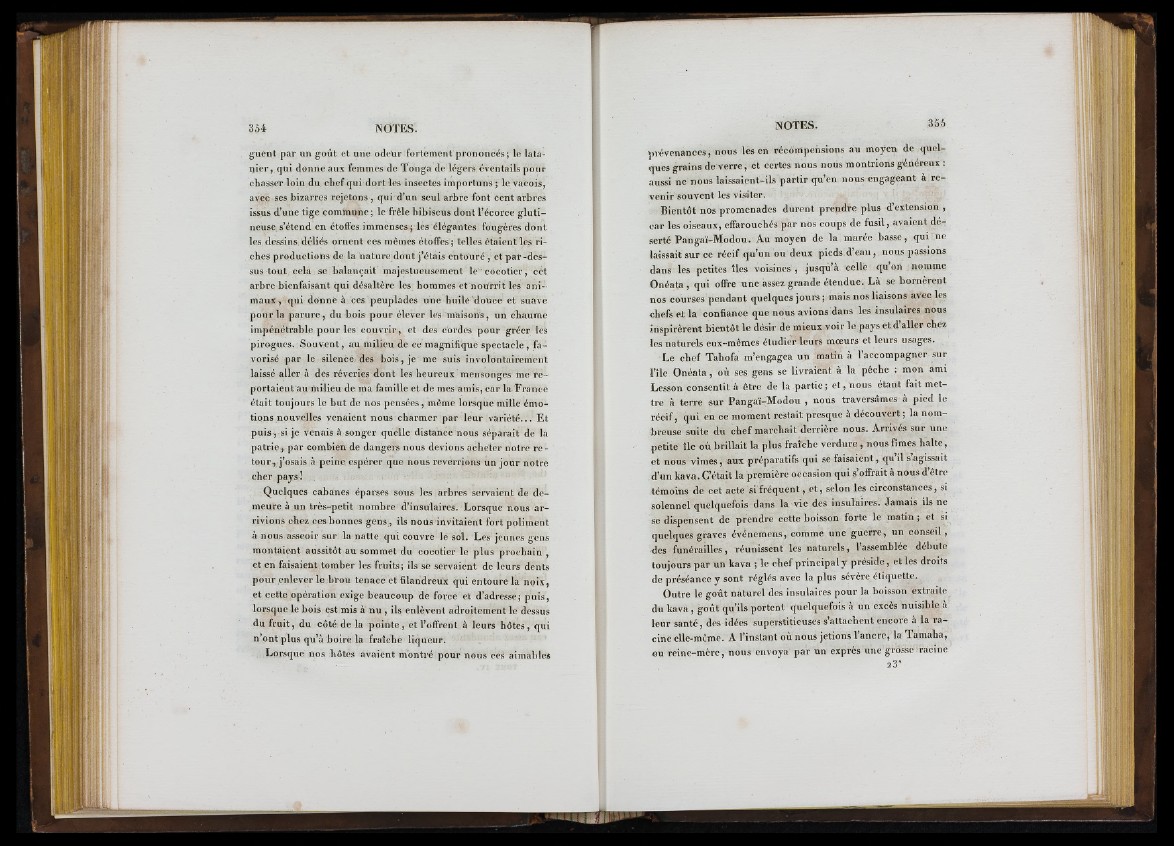
g'ucnt par un go û t et une odeur fortement prononcés ; le lala-
n ic r , qui donne au.t femmes de T o n g a de légers éventails pour
cliasscr lo in du ch e f qui dort les insectes importuns ; le vacois ,
avec ses bizarres rejetons , qui d’un seu l arbre font cent arbres
issus d’une tige commune; le frêle hibiscus d o n t l’ écorce g lu t i-
ncuse s’étend en étoffes immenses; les élégantes fougères dont
les dessins déliés ornent ces mêmes étoffes ; telles étaient les r iches
productions de la nature dont j ’étais entouré , et p a r -d e s sus
tout ce la sc b a lan çait majestueusement le c o c o t ie r , cet
arbre bienfaisant qui désaltère les hommes et n o u r r it les an im
a u x , qui donne à ces peuplades une huile douce et suave
p ou r la p a ru r e , du bois p o u r élever les maisons, un chaume
impénétrable p o u r les c o u v r ir , et des cordes pour gréer les
pirogues. S o u v e n t , au milieu de ce magnifique sp e c ta c le , fa vorisé
par le silence des b o is , je me suis involontairement
lai.ssé a lle r à des rêveries dont les heureux mensonges me r e portaient
au rtiilicu de ma famille et de mes amis, ca r la France
é tait toujours le bu t de nos p ensées , même lorsque mille émotions
nouvelles venaient nous charmer par leur v a r ié té ... E t
p u i s , si je venais à songer quelle distance nous séparait de la
p a t r ie , par combien de dangers nous devions acheter notre re -
to u r , j’osais à peine espérer que nous reverrions un jo u r notre
cher pays !
Quelques cabanes éparses sous les arbres servaient de demeure
à un très-petit nombre d’insulaires. Lo rsque nous a r rivions
chez ces bonnes g en s , ils nous inv ita ient fo rt poliment
à nous asseoir sur la natte qui Couvre le sol. Les jeunes gens
montaient aussitôt au sommet du cocotier le plus prochain ,
et en faisaient tomber les fruits; ils se servaient de leurs dents
p ou r enlever le brou tenace et filandreux qui entoure la n o ix ,
et cette opération exige beaucoup de fo rce et d’adresse; p u is ,
lorsque le bols est mis à nu , ils enlèvent adroitement le des.su.s
du f r u i t , du côté de la pointe , et l’offrent à leurs h ô te s , qui
n ’ont plus qu’à bo ire la fraîche liq ueur.
Lorsque nos hôtes avaient montré p our nous ces aimable*
p ré ven an ce s , nous les en récompensions au moyen de q u e lques
grains de v e r r e , et certes nous nous montrions généreux ;
aussi ne nous la is saient-ils p artir qu’en nous engag eant à re v
enir souvent les visiter.
Bien tô t nos promenades durent prendre plus d’extension ,
c a r les oiseaux, effarouchés par nos coups de fu s il, avaient déserté
P an g a ï-M o d o u . A u moyen de la marée bas.sc, qui ne
laissait sur ce r é c if qu’un ou deux pieds d’e a u , nous passions
dans les petites îles voisines , jusqu’à ce lle q u ’on nomme
Onéata , qui offre une assez grande étendue. L à se bo rnèrent
nos courses pendant quelques jours ; mais nos liaisons avec les
chefs et la confiance que nous avions dans les insulaires nous
inspirèrent bientôt le désir de mieux v o ir le pays et d’alle r chez
les naturels eux-mêmes étudier leurs moeurs et leurs usages.
L e ch e f T ah o fa m’engagea un matin à l ’accompa gner sur
i ’îlc O n é a ta , où ses gens se liv ra ien t à la pêche : mon ami
Lesson consentit à être de la partie ; e t , nous étant fait mettre
à terre sur P an g a ï-M o d o u , nous traversâmes à p ied le
r é c i f , qui en ce moment restait presque à découvert ; la nombreuse
suite du ch e f marchait derrière nous. A r r iv é s sur une
p etite île où b r illa it la p lus fraîche v e rd u r e , nous fîmes h a lte ,
et nous v îm e s , aux préparatifs qui se fa isa ien t, q u ’il s’agissait
d’un ka va . C’ était la première occasion qui s’ offrait à nous d’être
témoins de ce t acte si fré q u en t , e t , selon les circon s tan ces , si
solennel quelquefois dans la v ie des insula ires . Jamais ils ne
se dispensent de p rendre cette boisson forte le matin ; et si
quelques graves événemens, comme une gu e r re , un c o n s e il,
des fu n é ra ille s , réunissent les n a tu re ls , l ’assemblée débute
toujours p ar un ka va ; le ch e f p r in c ip a l y p ré s id e , et les droits
de préséance y sont réglés avec la plus sévère étiquette.
Outre le g o û t naturel des insulaires p our la boisson extraite
du kava , g o û t qu’ils portent quelquefois à un excès nuisible à
leu r santé, des idées superstitieuses s’attachent encore à la racin
e elle-même. A l ’instant oû nous jetions l ’an c re , la Tamaha,
OU re in e -m è re , nous envoya par un exprès une grosse racine
2 3’