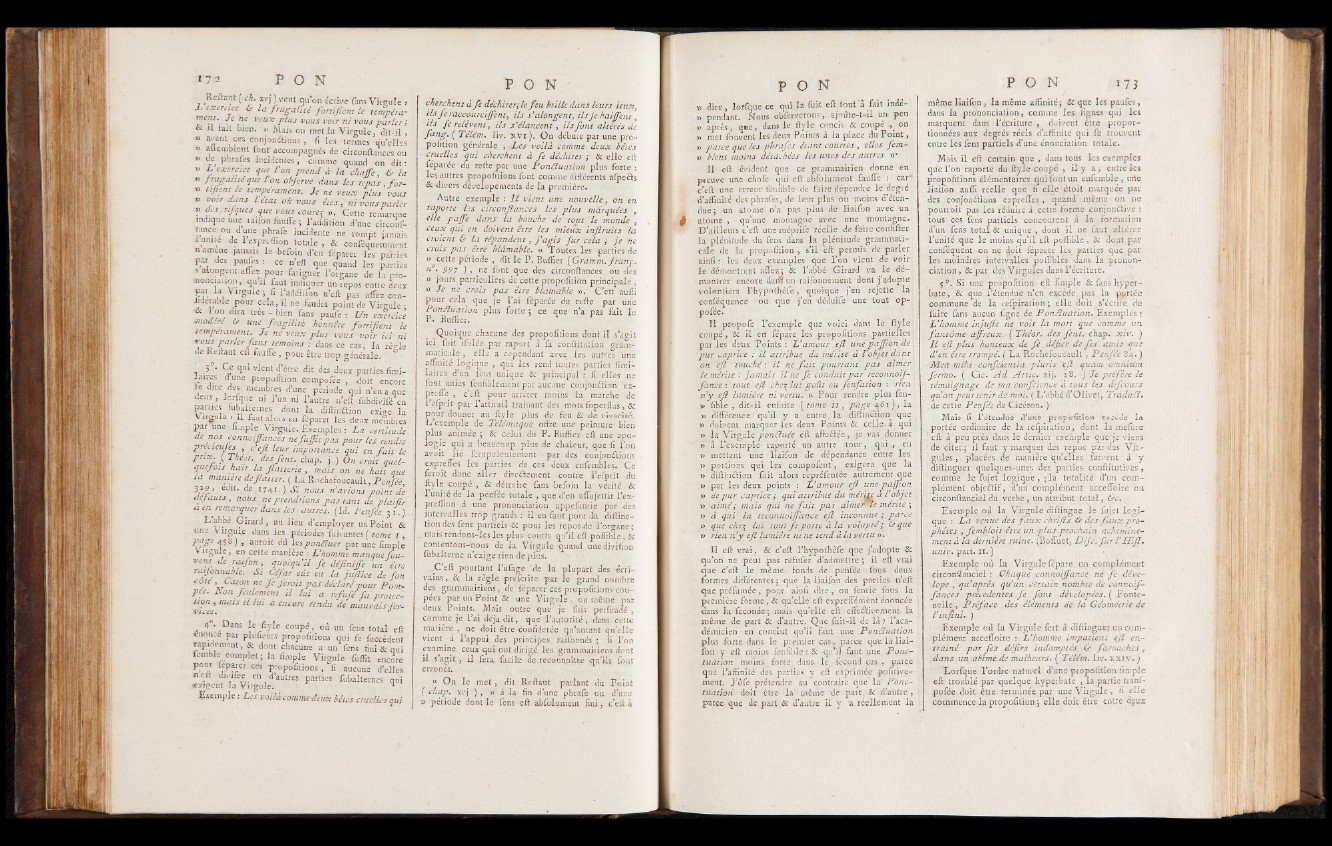
Rcftaiit ( ch. xvj ) veut c]u’on écrive fans Virgule ,
X exercice 6- ta frugalité fortifiait le tempéra-
f e n.e vo«x roi> ni irouj- parler;
cc i l fait bien, a Mais on met la Virgule, d it- il,
» avant ces conjonélions , fi les termes qu’ elles
» aiiemblent fonr accompagnés de circonftances ou
» de. phrafes incidentes, comme quand on dit:
» A exercice que Von prend à la cluitfe, & la
M frugalité que Ion ùbj'erve dans les répits , fo r -
» tijicnt le tempérament. Je ne veux plus vous
» voir dans l ’état où vous êtes. ni vous parler
? f^ .n jq u e s que vous coureK ». Cette remarque
indique une raifon fauffé ; l ’addition d’une circonf-
tance ou d une pluafe incidente ne rompt jamais
I unité de 1 exprefilon totale , & conféquemmenf
II amené jamais le befoin d’en féparer les parties
par des paiifes : ce n'eft que quand les parties
s atongent allez pour fatiguer l ’organe de la prononciation,
qui! faut indiquer un repos entre deux
ai VjrSule ’ é d i t io n n’eft pas affez con-
iiderable pour cela, il ne faudra point de Virgule ;
•& Ion dira très - bien fans paufe : Un exercice
modéré & une fragilité honnête fortifient le
tempérament Je ne veux plus vous voir ici ni
P aTlei fa n s témoins : dans ce cas la règle
de Reftaut ell fauffe, pour être trop générale.
. .3°- Ç f fful vient d’être dit des deux paftiesJîmi-
larres d une propoiîtion compofée , doit encore
le dire des membres d’une période qui'n’en a que
deux, iqrlque ni l ’un ni l ’autre n’eft fubdivifé en
parties fubalternes dont la . diftinflion exige la
Virgule r il faut alors en féparer les deux membres
par une iiaiple Virgule. Exemples : La certitude
de nos connoijfances ne fu ffitp a s pour les rendre
preciettjes c eft leur importance qui en fa i t le
p rix. ( Théor. des fent. cliap. j.) On croit quelquefois
haïr la flatterie , mais an ne hait que
la manière de flatter.\ La Rochefoucault, Penfée,
ôpp ’ edit. de ,7 4 1 .) nous n’avions point de
défauts, nous ne prendrions p as tant de plaifir
a.en remarquerions les autres. (Li. Venfée 3 i
L abbé Girard., au lieu d’employer un Point &
une Virgule dans les périodes fuivantes( tome I ,
Pff.ëe 45:8 ) auroit dû les ponctuer par une iimple
Viiguie, en cette manière : L ’homme manque fou-
vent de raifon, quoiqu’ i l f e définiffe un être
raifonnabfe. S i Céfar eût eu la jufiiee de fon
V e ' Càcon ne f e ferait p as déclaré pour Pompée.
Non feulement i l lui a refufé fa .p r o u e * ’■
non , mais i l lui a encore rendu de mauvais per-
vices, J
., 4°* Dans le ftyle coupé, où un feus total ef
«nonce par pk-fieurs propofitions qui fe fuccèden
rapidement, & dont chacune a un fens . fini & qu
femble complet; la fimple Virgule fuffit encort
pout déparer ces propofitions , fi aucune d’elle'
n e lt divifee en d’autres parties fubalternes qui
exigent la Virgule. , 1
Exemple : Les voilà comme deux têtes cruelles qui
cherchent à fe déchirer;le feu brille dans leurs leux,
ils fe raccourciffent, ils s ’alongent, ils fe baijfent,
ils fe relèvent, ils s'élancent, ils font altérés de
fa n e . ( Tétém. liv. x v i ). On débute par une proportion
générale , Les voilà comme deux bêtes
cruelles qui cherchent à f e déchirer ; & elle eft
fépaiée du relie par une Ponctuation plus forte :
les autres propofitions font comme différents afpeéls
& divers dèvelopements de la première.
Autre exemple : I l vient une nouvelle, on en
raporte les circonftances les plus marquées ,
elle pajfe dans la bouche de tout le monde ,
ceux qui en doivent être les mieux inftruits la
croient & la répandent, /a g is fu r cela ,• j e ne
crois pas être blâmable. « Toutes les parties de
’>ocette période , dit le P. Buffier (Gramm. franç.
n • 997 ) > ne font que des circonftances. ou des
» jours particuliers de cette propoiîtion principale ,
» Je ne crois pas être blâmable ». C’elt auflî
pour cela que je l ’ai féparée du relie par une
Ponctuation plus forte ; ce que n’a pas fait le
P. Buffier.
Quoique chacune des propofitions dont il s’agit
ici foit ifolée par raport à fa conftitui-ion grammaticale
, elle a cependant avec les autres 'une
affinité logique , qui les rend tontes parties fimi-
laires d un fens unique & principal : li elles ne
font unies fenfiblement par aucune conjônélion expie
fie , c’eft pour arrêter moins la marche de
1 elprit par l ’attirail traînant des mots fuperflus, &
pour donner au ftyle plus de feu & de vivacité.
L exemple de Télémaque offre une peinture bien
plus animée ; & celui du P. Buffier eft une apologie
qui a beaucoup plus de chaleur, que fi l ’on
avoit lie fcrupuleufement par des eonjonétions
exprefies les parties de ces deux enfembles. Ce
feroit donc aller, directement contre l’efprit du
ftyle coupé, & détruire, fans befoin la vérité &
l ’uni té de la penfée totale , que d’en afîujettir l ’ex-
preflion d une prononciation appefarçtie par des
intervalles trop grands : il en faut pour-la idiftinc-
tiondes fens partiels-& pour les repos de l ’organe;
- mais rendons-les les plus courts qu’il eft pofiible
contentons-nous de la Virgule quand unedivifion
fübalterne n’exige rien de plus.
-C eft pourtant l ’ùlàge 'de la plupart des écrivains
, & la règle preferite par le .grand nombre
des grammairiens, de féparer ces propofitions coupées
par un Point & une Virgule » ou même par
deux Points. Mais outre que je fuis perfuadé ,
comme je l ’ai déjà dit, que l ’autorité , dans cette
matière , ne doit être confiderée qu’autant qu’elle
vient d Pappui. des principes raifonnés ; li l ’on
examine ceux qui ont dirigé les ’grammairiens dont
il s'agit , il fera facile de reconn.oître qu’ils font
erronés.,
« On le met, dit Reftaut parlant du Point
( chap. xvj ) , » d la fin d’une phrafe ou d’une
»•période dont le fens eft abfolument fini., c’eil à
« dire , Ioffque ce qui la fui! eft fout à fait inûé-
» pendant. Nous obferverons, ajoûte-t-il un peu
» après , que , dans le ftyle concis & coupé , on
» met fouvent les deux Points d la place du Point,
» parce que les phrafes étant courtes, elles fem-
» blent moins détachées les unes des autres »•
Il eft 'évident que ce grammairien donne en
preuve une chofe qui eft abfolument fauffe : car*
c’eft une erreur fenfîble de faire dépendre le degré
d’affinité des phrafes, de leur plus où moins d’éten-,
| due; un atome n’a pas 'plus de- liaifon avec *un
È atome , qu’une montagne avec une montagne.
D ’ailleurs c’eft une méprife réelle de faire cbnnfter
la plénitude du fens dans la plénitude grammali-
tale de la propoiîtion, s’i l eft permis de parler
ainfi : les deux exemples que l ’on vient de voir
le démontrent affez; & l ’abbé Girard va le Remontrer
encore daill un raifonnement dont j’adopte
volontiers l ’hypothèfe, quoique j’en rejette la
conféqueneè ou que j ’en ‘déduifel une tout op-
pofée.
Il propofe l ’exemple que voici dans le ftyle
coupé, & il erf fépare les propofitions partielles
par les deux Points. : L ’amour. efi une pafjion de
pur caprice : i l attribue du mérite à T objet dont
on e jl touché : i l ne fa i t pourtant, p as aimer ■
le mérite : jamais i l ne fe conduit par reconnoif- .
. fairee. : tout ejl cherjlui goût ou fenfation : fren .
n y ejl lumière ni vertu. « Pour rendre plus fen-
» fible , dit-il enfuite •( tome i l , page 461 ) , la
» différence qu’il y a entre la‘ <diftinctipn que ,
» doivent marquer les, deux Points & , celle-à qui
» la Virgule ponctuée eft affeCtçe \ ,’je vas donner
^ » â l ’exemple ra,porté un autre tour, qui,, en
» mettant une liaifon de dépendance .entré les
» portions qui les compofent, exigera que la
» diftinëtion foit alors reprefentée autrement que
'» par les deux points : L ’amour ejl une paffion
» de pur caprice ,* qui attribue du mérue à J ’objet
» aimé ; mais qui ne fa i t pas aimerae mérite ;
» à qui la recomrpijfance ejl inconnue ; parce
» que chez lul tout fe porte à la volupté ; & que
» rien n’y e jl lumière ni ne tend à la vertu ».
I l eft vrai, & c’eft l ’hypothèle que j’adopte &
qu’on ne peut .pas refufer d’admettre ; il eft vrai
que c’eft le même fonds de penfqe fous deux
formes différentes ; que la liaifon des parties n’eft
que préfuinée, pour ainfi dire, ou fentie fous la
première forme, & qu’elle eft expréfîement énoncée
dans J.a -fécondé; -mais-qu’elle eft effeétivement- la
même de part & d’autre. Que fuit-il de là ? l ’académicien
en conclut qu’il faut une Ponctuation
plus forte dans le premier cas, parce que:la liaifon
y eft moins fenfible : & qu’il faut une Ponctuation
moins, forte ; dans . - le, fécond cas-;, parce
que l ’affinité des parties y eft exprimée pofitive-
ment. J’ôfe prétendre au contraire que Ta Ponctuation
doit être Ta même de part. & -d’autre ,
parce- que de part & d’autre il y a réellement la
même liaifqn , la même affinité; & que les paufes,
dans la prononciation, comme les lignes qui les
marquent dans l ’écriture , doivent etre proportionnées
aux degrés réels d’affinité qui fe trouvent
entre les fens partiels d’une énonciation totale.
Mais il eft certain que , dans tous les exemples
que l’on raporte du ftyle-coupé , il y a , entre les
propofitions élémentaires qui font un enfemble , une
liaifon auffi réelle que fi elle étoit marquée par
des conjonctions expreffes,. quand même on ne
pourroit pas les réduire à cette forme conjonctive :
tous ces fens partiels concourent à la formation
d’un fens total & .unique , dont il ne faut altérer
l ’unité que le moins qu’il eft pofiible, & dont par
conféquent on ne doit féparer les parties que par
les moindres intervalles pofiiblés dans la prononciation,
& par des Virgules dans l ’ écriture.
,j°. Si une propofition eft fimple & fans hyper-
bate, & que l ’étendue n’en excède pas la portée
commune de la refpiration ; elle doit s’écrire de
fuire fans aucun ligne de Ponctuation. Exemples :
L ’homme injujie ne voit la mort \que comme un
fantôme cùffioeux ( Théor. des fent. chap. x iv. )
I l ejl plus honteux de fe défier de fe s amis que
d’en être trompé. ( La Rochefoucault , Penfée 84.)
■ Meà- milhi c o n f ientia, plûris "ejl quàm dmnilim
fermo. ( Cic. A d Attic . xij. 28. ) Je préfère le
témoignage de ma confcience à tous Les difeours
quon peut tenir de moi. ( L ’abbé d’Olivet, Traducl•
de cette Penfée de Cicéron. )
Mais fi l ’étendue d?une prbpbfiîron excède la
portée, ordinaire de là refpiration , dont la mefure
‘ eft à peu près dans le dernier exemple que je viens
de citer,; il faut, y marquer des repos par des V it-
gules , placées , de manière qu’elles fervent • à y
diftinguer quelques-unes des parties conftitutives ,
comme le fujet logique , j_la totalité d’un complément
objeClif, d’un complément a'cceffoire ou
circonftanciel du verbe , un attribut total, &c.
Exemple .qu la Virgule diftingue le fujet lo g ique
: La venue des fa u x chrijls & des fa u x prophètes
, fembloit'être un p lus prochain acheminement
à la dernière ruine. (Bofluet, D ijc . fu r l ’H ijl,
univ. part. 11. )
Exemple où la Virgule fépare un complément
circonstanciel : Chaque connoijjance ne fe dève-
■ lope , qu’après qu’un certain nombre de cônnoif-
fances precedentes f e font dèvelopées. ( Fonte-
nelle, Préface des éléments de la Géométrie de
Vinfini. ,).
Exemple ou la Virgùle fert à diftinguer un complément
accefloire : L ’homme impatient ejl entraîné
par fe s défirs indomptés & farouches 7
dans un abime.de malheurs. ( Télém. liv. x x iv . )
Lorfque l ’ordre-naturel d’une propofition fimple
eft troublé par quelque hyperbate , la partie tranf-
pofée doit être terminée..par une V irgule, fi elle
commence la propofition ; elle doit être entre deux