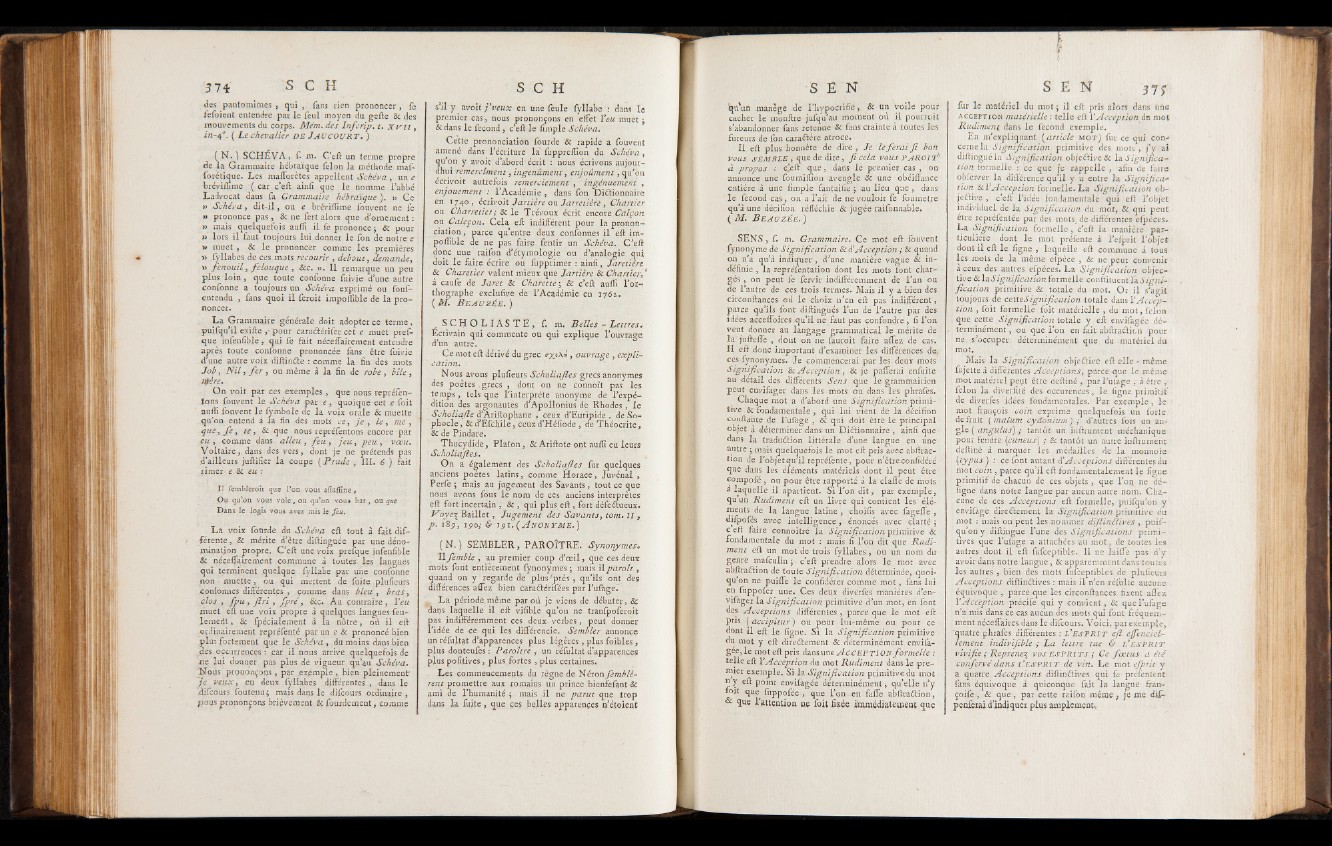
des pantomimes , qui , fans rien prononcer , fè
fefoient entendre par le fcul moyen du gefte & des
mouvements du corps. Mém. des Infcrip. t. X V H ,
in-ûf0. ( Le chevalier DE JA ü C O U R T . )
( N . ) S CH É V A , f. m. C ’eft un terme propre
de la Grammaire hébraïque félon la méthode maf-
forétique. Les mafforètes appellent Schéva, un e
feréviflïme (car c’eft ainfi que le nomme l ’abbé
Ladvocat dans fa Grammaire hébraïque ). » Ce
» Schéva, dit- il, ou e brévifiîme fouvent ne fe
» prononce pas , & ne fert alors que d’ornement :
» mais quelquefois auflï il fe prononce ; & pour
» lors i l faut toujours lui donner le fon de notre e
» muet , & le prononcer comme les premières
» fyllabes de ces mots recourir , debout, demande,
» f enouil, felouque , &c. ». Il remarque un peu
plus lo in , que toute confonne fuivie d’une autre
confonne a toujours un Schéva exprimé ou fouf-
encendu , fans quoi i l feroit impoflible de la prononcer.
La Grammaire générale doit adopter ce terme,
puifqu’il exifte pour caraftérifer cet e muet pref-
que infenfiblë, qui fe fait néceffairement entendre
après toute confonne prononcée fans être fuivie
d’une autre voix diftin&e : comme la fin des mots
Job, N i l , fe r , ou même à la fin de robe , bile ,
j$ère.
On voit par ces exemples , que nous repréfen-
tons fouvent le Schéva par e , quoique eet e foit
auflï fouvent le fymbole de la voix orale & muette
qu’on entend à la fin des mots ce, j e , l e , me ,
que, f e , te , & que nous repréfentons encore par
jeu , comme dans ■ alleu , feu , j e u , p e u v oe u .
Voltaire, dans des vers, dont je ne prétends pas
.d’ailleurs juûifier la coupe (Prude , III. 6 ) fait
rimer e & eu :
II femb leroît que l ’ on vous aflafïîne,
Q u qu’on vous v o l e . ou qu’ on v o u s b a t , o u que
Dans le lo g is vous avez mis le feu.
L a voix lourde du Schéva- eft tout à fait différente,
& mérite d’être diftinguée par une dénomination
propre. C ’eft une voix prefque infenfible
Sf. néceflairement commune à toutes les langues
qui terminent quelque . fyllabe par une confonne
non muette, ou qui mettent de fuite plufieurs
(Conformes différentes , çomme dans b leu , bras,
çlo$ , fp u , f i ri , fp r é , &c. Au contraire, Y eu
muet eft une voix propre à quelques langues feulement
, & fpécialement à la n.ôtre, où i l eft
ordinairement repréfenté par un e & prononcé bien
plus fortement que le Schéva , du moins dans bien
.des occurrences : car i l nous arrive quelquefois de
ne lui donner pas plus de vigueur qu’au Schéya.
Nous prononçons , par .exemple,. bien pleinement
j e v eux, en deux fyllabes différentes , dans le
rflfcours foutenu$ mais dans le difcours ordinaire ,
fions prononçons brièvement & lourdement, comme
s’i l y avoit / 'veux en une foule fyllabe : dans le
premier cas, nous prononçons en effet Veu muet ;
& dans le fécond, c’eft le fimple Schéva.
Cette prononciation fourde & rapide a fouvent
amené dans l ’écriture la fuppreflïon du Schéya,
qu on y avoit d’abord écrit : nous écrivons aujour-
dhui remercîment, ingenûment, enjoûment, qu’on
écrivoit autrefois remerciement , ingénuemeht ,
enjouement : l ’Académie , dans fon Dictionnaire
en 1740» écrivoit J art lire ou Jarretière , Chartier
ou Charretier ; & le Trévoux écrit encore Calçon
ou Caleçon. Cela eft indifférent pour, la prononciation
, parce qu’entre deux confonties i l eft im-
poflïble de ne pas faire fentir un Schéva. C ’eft:
donc une raifon d’étymologie ou d’analogie qui
doit le faire écrire ou fupprimer : ainfi, Jaretière
& Charetier valent mieux que Jartière & Chartier, *
à caufe de Jaret & Charetie ; & c’eft auflï l’or-,
thographe exclufive de l ’Académie en 176a.
( M. B e a u z é e . )
S C H O L I A S T E , f . ni. Belles - Lettres,
Ecrivain qui commente ou qui explique l ’ouvrage
d’un autre.
Ce mot eft dérivé du grec <r%oÀtl, ouvrage , expli-
H cation.
Nous avons plufieurs Scholiafles grecs anonymes
des poètes .grecs , dont on n.e connoît pas les
temps, tels que l ’interprète anonyme de l’expédition
des argonautes d’Apollonius de Rhodes, le
Scholiafie d’Ariftophane , ceux d’Euripide , de Sophocle
, & d’Efchjle, ceux d’Héfiode , de Théocrite,
& de Pindare.
Thucydide, Platon, & Ariftote ont auflï eu leurs
Scholiafles.
On a également des Scholiafles fur quelques
anciens poetes latins,- comme Horace, Juvénal ,
Perfe j mais au jugement des Savants, tout ce que
nous avons fous le nom de ces anciens interprètes
eft fort incertain , & , qui plus eft , fort défectueux»
Voye"{ B a ille t, Jugement des Savants, tom. i l ,
p • i8 > , ip o ,’ & j p j . ( A n o n y m e . )
( N. ) SEMBLER, PARO lTR E. Synonymes•
I l femble , au premier coup d’oe il, que ces deux
mots font entièrement fynonymes ; mais i lp a ro ît,
quand on y regarde de plus/près, qu’ils ont des
différences affez bien caraCtérifées par l ’ufager
g La période même par où je viens de débuter,
dans laquelle il eft vifible qu’on ne tranfpoferoit
pas indifféremment ces deux- verbes, peut donner
l ’idée de ce qui les différencie. Sembler annonce
un réfultat d’apparences plus légères , plus foibles,
plus donteufes : Paroître un réfultat d’apparences
plus pofîtives, plus fortes , plus certaines.
Les commencements du règne de Néron femblè-
rent promettre aux romains un prince bienfefant ÔC
ami de l ’humanité 5 mais i l ne parut que trop
dans la fuite, que çe$ belles apparençes n’éfoienfc
fcpi’un manège de l ’hypoèrifie > & un Vôile pour
cacher le monftre jufqu’au moment où il pourroit
s’abandonner fans retenue & fans crainte à toutes les
fureurs de fon caractère atroce.
Il eft plus honnête de dire, Je le ferai f i bon
vous semb le , que de dire, f i cela vous p a r o i r '
à propos : c^eft que, dans le premier cas , on
annonce une foumiflion aveugle & une obéiflance
entière a une fimple fantaifie j au lieu que, dans
le fécond cas, on a l ’air de ne vouloir fe foumetre
qu’à une décifion réfléchie & jugée raifonnable.
( M. B e a u z é e . )
SE N S , f. m. Grammaire. Ce mot eft fouvent
fynonyme de Signification &d’Acception ; & quand
on n’a qu’à indiquer , d’une manière vague & indéfinie
, la repréfentation dont les mots font chargés
, on peut fe fervir indifféremment de l ’un ou
de l ’autre de ces trois termes. Mais il y a bien des
circonftances où le choix n’en eft pas indifférent,
parce qu’ils font diftingués l’un de l ’autre par des
idées acceffoires qu’il ne faut pas confondre , fi l’on
veut donner au langage grammatical le mérite de
la juftefle , dont on ne fauroit faire affez de cas.
I l eft donc important d’examiner les différences de/
ces fynonymes. Je commencerai par les deux mots
Signification & A cception, & je pafferai enfuite
au détail des différents Sens que le grammairien
peut envifager dans les. mots ou dans les phrafes.
Chaque mot a d’abord une Signification primitive
& fondamentale , qui lui vient de la décifion
confiante de l ’ufage , & qui doit être le principal
objet à déterminer,dans un Dictionnaire, ainfi que
dans la traduction littérale d’une langue en une
autre /mais quelquefois le mot eft pris avec abftrac-
tion de l ’objet qu’il repréfente, pour n’être confidéré
que dans les éléments matériels dont il peut être
eompofé , ou pour être rapporté à la clàffe de mots
a laquelle il apartient. Si Ton dit, par exemple,
qu un Rudiment eft un livre qui contient les éléments
de la langue latine , choifis avec fageffe ,
difpofés avec intelligence, énoncés avec clarté j
c eft faire connoitre la Signification primitive &
fondamentale du mot : mais fi l ’on dit que Rudiment
eft un mot de trois fyllabes., ou un nom du
genre malculin * c’eft prendre alors le mot avec
abftraétion de toute Signification déterminée, quoi-
qu on ne puiffe le confidérer comme mot, fans lui
en fuppofer une. Ces deux diverfes manières d’en-
vifager la Signification primitive d’un mot, en font
des Acceptions différentes , parce que le mot eft
pris ( accipitur ) ou pour lui-même ou pour ce
dont il eft le figne. Si la Signification primitive
du mot y eft directement & déter'minément envifa-
gée,le mot eft pris dans m\t A c c e p t io n formelle :
telle eft VAcception du mot Rudiment dans le premier
exemple. Si la Signification primitive du mot
n y eft point envifagée déterrainément, qu’elle n’y
loit que^ fuppofée , que Ton en faffe abftraCtion,
& que l attention uç fuit fixée immédiatement que
fur le matériel du mot j il eft pris alors dans uns
acception matérielle : telle eft Y Acception du mot
Rudiment dans le fécond exemple.
En m’expliquant (article .mot) fur ce qui con^
cerne la Signification primitive des mots , j’y ai
diftinguéla Signification objective & la Signification
formelle : ce que je rappelle , afin de faire
obferver la différence qu’il y a entre la Significa-
tion & TAcception formelle. La Signification ob-
j’eftive , c’eft l’idée fondamentale qui eft l’objet
individuel de la Signification du mot, & qui peut
etre repréfentée par des mots, de différentes efpèces*,
La Signification formelle, c’eft la manière particuliere
dont le mot préfente à l’etprit l’objet
dont il eft le figne , laquelle eft commune à tous
les mots de la même etpèce , & ne peut convenir
à ceux des autres efpèces. La Signification objective
& Yà-Signification formelle conftituent l'a Signification
primitive & totale du mot. Or il s’agit
toujours de cett tSignification totale dans Y Acception
, foit formelle foit matérielle , du mot, félon
que cette Signification totale y eft envifagée dé-
terminément, ou que l’on en fait abftraCtion pour
ne. s’occuper déterminément que du matériel du
mót. Mais la Signification objeCtivé eft elle - même
fujette à différentes Acceptions, parce que le même
mot matériel peut être deftiné , par Tulage , à être ,
félon la diverfité des occurences, le figne primitif
de diverfes idées fondamentales. Par exemple , le
mot françois coin exprime quelquefois un forte
de fruit (malum cydonium ) ,• d’autres fois un angle
( angulus) ; tantôt un infiniment méchanique
pour fendre (citneus) ,• & tantôt un autre inftrument
deftiné à marquer les médailles de la monnoie
(typus) : ce font autant S Acceptions différentes du
mot coin , parce qu’il eft fondamentalement le figne
primitif de chacun de ces objets, que l’on ne dé-
ligne dans notre langue par aucun autre nom. Chacune
de ces Acceptions eft formelle, puifqu’on y
envifage directement la Signification primitive du
mot : mais on peut les nommer difiinfiivès , puifqu’on
y diftingue l’une des Significations primitives
que l’ufage a attachées au mot, de toutes les
autres dont il eft: fufceptible. 11 ne laifîè pas d’y
avoir dans notre langue, apparemment dans toutes
les autres , bien des mots fulceptibles de plufieurs
Acceptions diftinCtives : mais il n’en réfulte aucune
équivoque , parce que les circonftances fixent affez
Y Acception précife qui y convient, & quel’ufage
n’a mis dans ce cas aucun des mots qui font fréquemment
néceffai res dans le difcours. Voici, par exemple,
"quatre phrafes différentes : L?ESPRIT eft ejftnciel-
lement indivifible ; La lettre tue & l 3e s p r i t
vivifie ; Reprene\ vos ESP Rl T s ; Ce foe tus a été
confervé dans l’e sPRI T de vin. Le mot efprix y
a quatre Acceptions diftinCtives qui fe préfentent
fans équivoque à quiconque fait la langue fran-
çoife , & que, par cette raifon même ; je me dit-
penferai d’indiquer plus amplement*