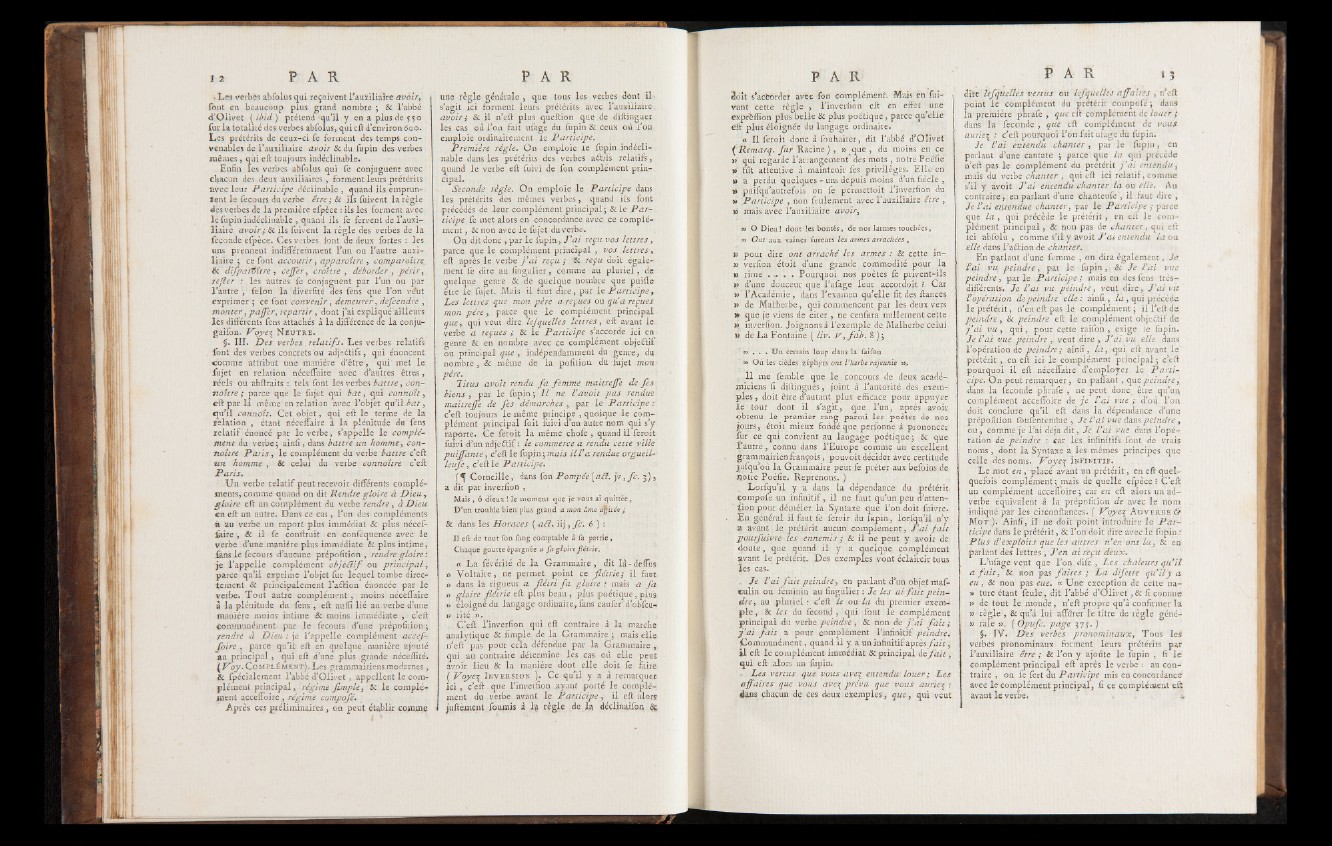
• Les verbês abfolùs qui reçoivent l’auxiliaire avoir, |
font en beaucoup plus grand nombre ; & l ’abbé
d’Olivet ( ib id ) prétend qu’il y en a plus de 550
fur la totalité des verbes abfoîus, qui eft d’environ 600.
ÎUes prétérits de ceux-ci fe forment des temps convenables
de l ’auxiliaire avoir & du lupin des verbes
mêmes , qui eft toujours indéclinable.
. Enfin les verbes abfolus qui fe conjuguent avec
chacun des deux auxiliaires , forment leurs prétérits
avec leur Participe déclinable , quand ils empruntent
le fecours du verbe être ; & ils fuivent la règle
des verbes de la première efpèce : ils les forment avec
le fupin indéclinable , quand iis fe fervent de l ’auxiliaire
avoir.; Sc ils fuivent la règle des verbes de la
fécondé efpèce. Ces verbes font de deux fortes : les
uns prennent indifféremment l’un ou l’autre auxiliaire
; ce font accourir, apparoître , comparaître.
& difpa ft>ître , cejjer, croître , déborder , périr,
refier : les autres fe conjuguent par l ’un ou par
l ’autre , félon la diverfité des fens que l ’on veut
exprimer ; ce font convenir , demeurer, defcendre ,
monter, paffer, repartir, dont j’ai expliqué ailleurs
les différents fens attachés à la différence de la conju- gaifon. Voye\ N eutre.
§. III. De s verbes, relatifs. Les verbes relatifs
font des verbes concrets ou adjeétifs, qui énoncent
comme attribut une manière d’être, qui met le
fujet en relation néceffaire avec d’autres êtres,
réels ou abftraits : tels font les verbes battre, connaître
,* parce que le fujet qui bat, qui connoît,
eft par la même en relation avec l ’objet qu’i l bat,
qu’i l connoît. Cet objet, qui eft le terme de la
relation , étant néceffaire à la plénitude da fens
relatif énoncé par le verbe, s’appelle le complément
du verbe; ainfî, dans battre un homme, connaître
P a r is , le complément du verbe battre c’ eft
un homme , & celui du verbe eonnoître c’eft
Pa r is.
Un verbe relatif peut recevoir différents compléments,
comme quand on dit Pendre gloire à D ie u ,
gloire eft un complément du verbe rendre , à D ieu
en eft un autre. Dans ce cas , l’un des compléments
à au verbe un raport plus immédiat Sc plus nécef-
fe-ire , & i l fe conftruit en conféquence avec le
verbe d’une manière plus immédiate & plus intime,
fens le fecours d’aucune prépofition, rendre gloire :
je l ’appelle complément objectif ou principal,
parce qu’il exprime l’objet for lequel tombe directement
& principalement Taéfîon énoncée par le
verbe. Tout autre complément, moins néceffaire
a la plénitude du fens , eft aufli lié au verbe d’une
manière moins intime & moins immédiate , c’eft
Communément par le feçours d’une prépofition ;
rendre à Dieu : je l’appelle complément accefl
foire , parce qu’il eft en quelque manière ajouté
au principal , qui eft d’une plus grande néoeffité.
LT^oy. Complément). Les grammairiens modernes ,
& fpécialement l ’abbé d’O liv e t , appellent le complément
principal,. régime Jimple, & le complément
acceffoire, régime compofé.
Après ces préliminaires, on peut établir comme
utle règle générale, que tous les verbes dont iL
s’agit ici forment leurs prétérits avec l’auxiliaire
avoir; & il n’eft plus queftion que de diftinguer
les cas où l’on fait ufage du fupin & ceux où l’on
emploie ordinairement le Participe.
Première règle. On emploie le fupin indécli- .
nable dans les prétérits des verbes aéhfs relatifs,
quand le verbe eft fuivi de fon complément principal.
Seconde règle. On emploie -le Participe dans
les prétérits des mêmes verbes, quand ils font
précédés de leur complément principal; & le P a r ticipe
fe met alors en concordance avec ce complément
, & non avec le fujet du verbe.
On dit donc , par le fupin, J ’ai regu vos lettres,
parce que le complément principal , vos lettres,
eft après le verbe j ’ai reçu ,* & reçu doit également
fe dire au fingulier, comme au pluriel, de
quelque genre & de quelque nombre que puifle
être le fujet. Mais il faut dire, par le Participe,
Les lettres que mon père a reçues ou q ua reçues
mon père, parce que le complément principal
que, qui veut dire lejquelles lettres-, eft avant le
verbe a reçues ,* & le Participe s’accorde ici en
genre & en nombre avec ce. complément objectif
ou principal que , indépendamment du genre, du
nombre, & même de la -pofîtion- du lia jet mon
père.
Titus avoit rendu f a femme maitrejfe de fe s
biens , par le fupin ; I l ne Vavoit p as rendue
maitrejfe de fe s démarches , par le Participe :
c’eft toujours le même principe , quoique le complément
principal foit fuivi d’un autre nom qui s’y
raporte. Ce feroit la même chofe , quand il feroit
fuivi d’un adjeétif : le commerce a rendu cette ville
puiffante, c’eft le fupin ; mais i l l ’a rendue orgueil-
leufe, c’ eft le Participe.
( ^ Corneille, dans fon Pompée (acl. j v , fc . 3-) 3
a dit par inverfîon ,
Mais , 6 dieux ! le moment que je vous ai quittée,
D ’ un trouble bien plus grand a mon. âme agitée ;
Sc dans lès Horaces [ act. iij , f c . £)•:-,
Il eft de tout fon fang comptable à fa patrie,
Chaque goutte épargnée a fa gloire flétrie.
« L a févèrité de la Grammaire, dit là-deffus
» Voltaire, ne permet point ce flétrie,* i l faut
» dans la ligueur a flétri fa gloire : mais a - f a
» gloire flétrie eft plus beau , plus poétique, plus
»' éloigné du langage ordinaire, fans caufer'd’obfou-
» rite ».
. C ’eft l ’inverfion qui eft contraire à la marche
analytique & fimple de la Grammaire ; mais elle
n’eft pas pour cela défendue par la Grammaire ,
qui au contraire détermine les cas oii elle peut
avoir lieu & la manière dont elle doit fe foire
( Vqye\ Inversion ). Ce qu’il y a l remarquer
ici , c’eft que l ’in ver fion .ayant porté le complément
du - verbe avant le Participe, il eft alors
I juftement fournis à Jg règle de la déclinaifon &
Üoît s*acfcordef avec fon complément. Mais en foi- .
vant cette règle , l ’inverfion eft en effet une
ëxprêfiïon plus belle & plus poétique, parce qu’elle
ëft plus éloignée du langage ordinaire.
« Il feroit donc a fouhaiter, dit l ’abbé d’Olivët \
(Remarq. fu r Racine), » q u e , du moins en ce
» qui regarde l ’arrangement dés mots , notre Poéfie
» fut attentive à maintenir fes privilèges. Elle en
» a perdu quelques - uns depuis moins d’un fiècle ,
» puifqu’autrefois on fe permettoit l’inveifion du
» Participe , non feulement avec l’auxiliaire être ,
» mais avec l ’auxiliaire avoir,
» O Dieu.! dont les bontés, de nos larmes touchées,
» Ont aux vaines fureurs les armes arrachées ,
» pour dire ont arraché les prmes : & cette in-
» verfion ëtoit d’une grande commodité pour la
» rime . - . . Pourquoi nos poètes fe privent-ils
» d’une douceur que l ’ufage leur accordoit ? Car
» l ’Académie , dans l ’examen qu’elle fit des ftances
» de Malherbe, qui commencent par les deux vers
» que je viens de citer , ne cenfora nullement cette
s» inverfîon. Joignons à l ’exemple de Malherbe celui
» de La Fontaine ( liv. v , fa b . 8 ) 5
» . . . Un certain loup dans la faifon
» Où les tièdes zéphyrs ont l ’herbe rajeunie ».
; 11 me femble que le concours de deux académiciens
fi diftingués, joint à l ’autorité des exemples
, doit être d’autant plus efficace pour appuyer
le tour dont il s’agit, que l ’un, après avoir
obtenu le premier rang parmi les poètes de nos
jours , étoit mieux fondé que perfonne à prononcer
fur ce qui convient au langage poétique; & que
l ’autre, connu dans l ’Europe comme un excellent
grammairien françois, pouvôit décider avec certitude
jufqu’où la Grammaire peut fe prêter aux befoins de
notre Poéfie. Reprenons. )
Lorfqu’i l y a dans la ‘dépendance du prétérit:
compofé un infinitif, i l ne faut qu’un peu d’attention
pour déméler la Syntaxe que l ’on doit foivre.
En; général i l faut fe feryir du lupin, lorfqu’i l n’y
a avant le prétérit aucun complément, J ’ai fa it
gourfuivreles ennemis ; & il ne peut y avoir de
doute, que quand i l y a quelque complément
avant le prétérit. Des exemples vont éclaircir tous
les cas.
r Je l ’ai fa i t peindre, en parlant d’un objet mafi-
iculin ou féminin au fingulier : Je les ai fa i t peindre,
au pluriel : c’eft le ou la du premier exemple
,' & les du fécond , qui font le complément
principal du verbe peindre , & non de j ’ ai fa i t ;
j ’ai fa i t a pour complément l’infinitif peindre.
^Communément, quand il y a un infinitif après/hif,
i l eft le complément immédiat & principal à e fa it ,
qui eft alors un fupin;
< Les vertus que vous aye% entendu' louer ; Les
affaires que vous ave^ prévu que vous auriez :
dans çhacun de ces deux, exemples , que, qui veut
dite lejquelles vertus ou lefquelle s affaires , n’eft
point le complément du prétérit compofé ; dans
la première phrafe , que eft complément de louer ;
dans la fécondé , que eft complément de vous
aurie\ : c’eft pourquoi l ’on foit ufage du fupin.
Je l ’ai entendu chanter, par le fupin, en
parlant d’une cantate ; parce que la qui précède
n’eft pas le complément du prétérit j ’ai entendu,
mais du verbe chanter , qui eft ici relatif, comme
s’il y avoit J ’ai entendu chanter la on elle. Au
contraire, en parlant d’une chanteufe , il fout dire ,
Je l ’ai entendue chanter, par le Participe ,* parce
que la , qui .précède le prétérit, en eft le complément
principal , & non pas de chanter, qui eft
ici abfolu , comme s’i l y avoit J ’ai entendu la ou
elle, dans l ’aétion de chanter.
En parlant d’une femme , on dira également, Je
l ’ai vu peindre, par le fupin, & Je l ’ai vue
peindre, par le Participe ; mais en des fens très--
différents. Je l ’ai vu peindre, veut dire , J ’ai vu
V opération de peindre elle : ainfi , la , qui précède
le prétérit, n’en eft pas le complément; i l l ’eftde
peindre , & peindre eft le complément objectif de
j ’ ai v u , qui, pour cette raifon , exige le fupin.
Je l ’ai vue peindre, veut dire, J ’ai vu elle dans
l ’opération de peindre ; ainfi , La, qui eft avant le
prétérit , en eff ici le complément principal ; c’eft
pourquoi il eft néceffaire d’employer le Pa r ticipe.
On peut remarquer, en paffant, qut peindre,
dans la fécondé phrafe , ne peut donc être qu’un
complément acceffoire de j e l ’ai vue ; d’où l ’on
doit conclure qu’il eft dans la dépendance d’une
prépofition foufentendue , Je l ’ai vue dans peindre ,
ou , comme je l ’ai déjà dit, Je l ’ai vue dans l ’opération
de peindre : car les infinitifs fout de Vrais
noms, dont la Syntaxe a les mêmes principes que
celle des noms.' Voye\ Infinitif.
L e mot en, placé avant un prétérit, en eft quelquefois
complément; mais de quelle efpèce? C ’eft
un complément acceffoire ; car en eft alors un adverbe
équivalent à la prépofition de avec le nom
indiqué p ar le s circonftances. ( J^qyej Adverbe &
Mo t ;). Ainfî, i l ne doit point introduire le P a r ticipe
dans le prétérit, & l’on doit dire avec le fupin :
Plus; d’exploits que les autres n’en ont lu , & en
parlant des lettres, J ’en ai reçu deux.
L ’ufoge veut que l ’on dife , Les chaleurs qü’ i l
a fa i t , Sc non pas fa ite s ; La difette qu’ i l y a
e u , & non pas eue. « Une exception de cette na-
» ture étant feule, dit l ’abbé d’Olivet , & fi connue
» de tout le monde, n’eft propre qu’à confirmer la
» règle , & qu’à lui affùrcr le titre de règle géné-
» raie ». ( Opufc. page 375. )
§. IV. De s verbes pronominaux, Tous les
verbes pronominaux forment leurs prétérits par
l ’auxiliaire être ; & l’on y ajoute le fupin , fi: le
complément principal eft après le verbe : au con-
' traire , on fe fort du Participe mis en concordance
avec le complément principal, fî ce complément efè
avant le verbe. » ^