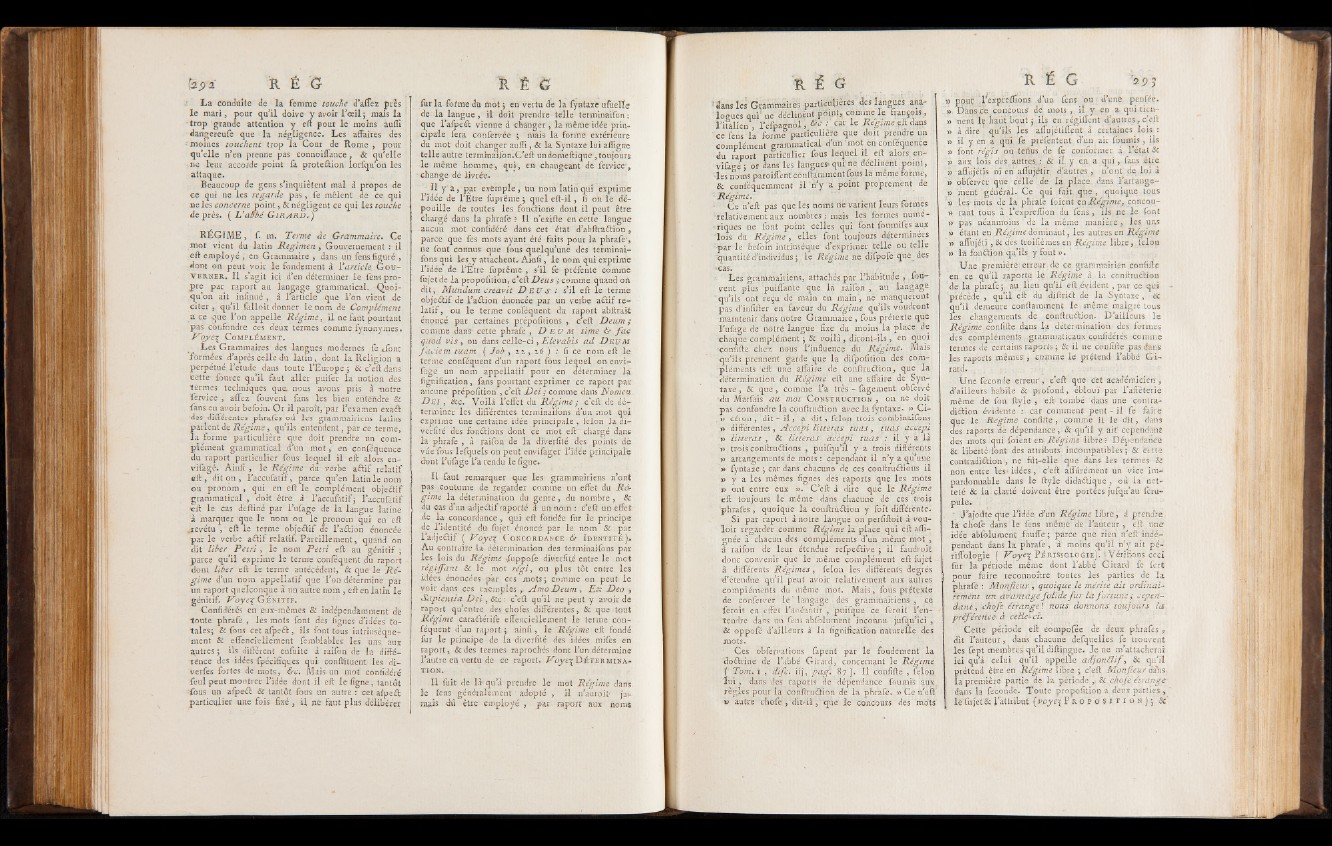
6 sri R Ê <3
L a conduite de la femme touche d'aiTez près
le mari, pour qu’i l doive y avoir l ’oeil ; mais la
trop grande attention y eft pour le moins àufli
dangereufe que la négligence. Les affaires des
- moines touchent trop la Cour de Rome , pour
qu’elle n’en prenne pas connoiffance, & qu’elle
• no leur accorde point fa protection lorfqu’on les
attaque.
Beaucoup de gens s’inquiètent mal a propos de
ce qui ne les regarde pas , fe mêlent de ce qui
ne les concerne point, & négligent ce qui les touche
de près.. ( L ’ alfbé GlRARD*)
R É G IM E , f. m. Terme àe Grammaire. Ce
mot vient du latin Regimen, Gouvernement :■ il
eft employ é , en Grammaire , dans un fens figuré y
dont on peut voir le fondement à Y article Gouverner.
I l s’agit ici d’en déterminer le fens propre
par raport au langage grammatical. Quoiqu’on
ait infînué , à 1 article que l ’on vient de
citer qu’il falloir donner le nom de Complément
a c e que'l’on appelle Régime, i l ne faut pourtant
pas confondre ces deux termes comme fynonymes.
P 'o y e ^ C omplémen t.
Les Grammaires des langues modernes fe ron t
formées d’après celle du latin, dont la Religion a
perpétué l ’étude dans toute l ’Europe ; & .c’eft dans
teette fôurce qu’il faut aller puifer la notion des
termes techniques que. nous avons pris à -notre
fervice , afTez fouvent fans les bien entendre &
fans en avoir beforn. Or il paroît, par l’examen exaét
des différentes phrafes où les grammairiens latins
parlent de Régime, qu’ils entendent, par ce. terme,
la forme particulière que doit prendre un complément
grammatical d un mot, en confequence
du raport particulier fous' lequel il eft alors en-
vilagé. Ainfi , le Régime du verbe aCtif relatif
eft, dit on , I’accufatif, parce qu’èn latin le nom
ou pronom , qui en eft le complément objeftif
grammatical , doit être a l ’accufatif; l ’accufatif
«ft le cas deftiné par l ’ufage de la langue latine
à marquer que le nom ou le pronom qui en eft
.revêtu , eft le terme objeétif de l’aétion énoncée
p a r le verbe aélif relatif. Pareillement, quand on
dit liber Pétri , , le nom Pétri eft- au génitif ;
parce qu’il exprime le terme conféquent du raport
dont liber eft le terme antécédent, & que l e Régime
d’un -nom appellatif q u e 'l’on détermine par
un raport quelconque à un autre nom , eft en latin le
génitif. Voye\ G énitif.
Confédérés en eux-mêmes & indépendamment dè
toute phrafo , les mots font des figues d’idées totales;
& fous cetafpeâ:, ils font tous intrinsèquement
& efTencîellement fembiables les uns aux
autres ; ils diffèrent enfuite à raifon de la différence
des idées fpécifiques qui conftituent les di-
verfes fortes de mots, &c. Mais un mot confédéré
feulpeut montrer l’idée dont il eft le ligne, tantôt
-fous un afpeét & tantôt fous un autre r cet afpeét
particulier une fois fixé , i l ne faut plus délibérer
R Ê Ù
fur la fofme du mot ; en vertu de la fyntaxe ufuellg
de la langue, il doit prendre telle terminaiforf :
que l’afpeél vienne à changer , la même idée principale
fera conformée ; niais- la forme extérieure
du mot doit changer auffi, & la Syntaxe lui allègue
telle autre terminaifon.C’eft undomeftique, toujours
le même homme, qui, en changeant de fervice*,
• change de livrée.
- I l y 'a , par exemple, un nom latin qui exprime
l ’idée de l’Etre füprême ; quel e ft-il, n oh le dépouille
de toutes les fonctions dont il peut être
chargé dans la phrafe ? Il n’exifte en cette langue
aucun mot confédéré dans cet état d’abftraCfcïon,
parce que fes mots ayant été faits pour la phrafe1,
ne font connus que fous quelqu’une des terminai-
fons qui les^y attachent. A infi, le nom qui exprime
l ’idée de l ’Etre fuprême , s’il fo préfenle comme
fu jet de la propofition, c’ eft Denis ; comme quand on
dit, Mundum creavit D ETJs : s’i l eft le terme
objectif de l ’aétion énoncée par un verbe aétif re*-
la tif, ou le terme conféquent du raport abftrak
énoncé par certaines prépofitions , c eft Deum ;
comme dans’ cette phrafe , D E U M time & fa c
quod v is , ou dans c e lle -c i, Elevafis ad D eu m
faciem tuam ( Job , z z ,.z 6 ) ; fi ce nom eft le
terme conféquent d’un raport fous lequel onenvb-
fage' un nom appellatif pour en déterminer la
lignification, fans pourtant exprimer ce raport par
aucune prépofition c’eft D e i / comme dans No me y..
D e i , &c. Voilà l ’effet du Régime ; c’eft de dé-r-
terniïner les différentes terminaifons d’un mot qui
exprime une certaine, idée principale, félon la di-
verfité des fonctions dont ce mot eft chargé dans
la phrafe , à raifon de la diverfîté des points dè
vue fous lefquels on peut envifagçr l ’idée principale
dont l ’ufage Ta rendu le figne.-
II faut remarquer que les grammairiens n’ont
pas coutume de regarder comme un effet du Ré gime
la détermination du genre, du nombre , &
du cas d’un adjeCtif raporté à un nom; : c’eft un effet
de la concordance y qui eft fondée fur le principe
de l ’identité du fujet. énoncé: par le nom & par
l ’adjeétif ( N o y e \ Concordance & Identité)*
Au contraire la détermination des terminaifons par
les-lois du Régime \foppofe divierfité entre le met
régijfant & le mot régi., ou plus tôt entre les
idées énoncées par ces mots; comme on peut le
voir dafts ces exemples-,, Amo Deum , E x Deo |
Sapientia D e l , &c : c’eft qu’il ne peut y av-oir de
raport qu’entre des chofos différentes, & que tout
Régime caraéléiifo effenciellement le terme conféquent
d’un raport ; ainfi, le Régime eft fondé
fur le principe de la diverfité des idées mifes en
raport,. & des termes raprochés dont l ’un,détermine
l ’autre en vertu de ce raport. Voye\ D étermination.
I l fuit de là< qu’a prendre le mot Régime dans-
le fens généralement adopté , il n’auroit ja~
mais àû être employé , par raport aux noms.
R É <3
■ ■ hoe les Gràmmaiitt .parU^i;è^s %s langues analogues
qui ne (Kclinèni point, comme le: fçançws,.
l ’italien , l’efpagnol, W -M k le Régime.
ce fens la forhie particulière que dort prendre un ’
complément grammatical d un mot en confoquençe
du raport particulier fous lequel i l eft alors; en^-
vifao-é; or dansées langue^quf ne déclinant point, :
•les noms paroiffent cônftamment fous la même forme, '
& conféquemment i l n y a point proprement de
Régime. " ' ■ r .
• Ce n’eft pas que les noms në varient leurs formes
'relativement aux nombres : mais les formés numériques
ne font point celles qui font foiimifos aux
-'lois du Régime , elles' font toujours -déterminées
•'-par le befoiii intrinsèque d’exprimer telle ou telle
'quantitéd’individus; le Régime, ne diïpofe que_des
«cas. ' ' v ,, \
■ Les grammairiens, attachés par l ’habitude , fofi-
yent plus puiflantè que la raifon . au langage
qu’ils ont reçu dé main en main', né manqueront
pas d’infifter en faveur du Régime qu’ils voudront
maintenir .’dans notre Grammaire , fous prétexte que
l ’ufage de nôtré langue, fixe du moins la place de
chaque complément ; & voilà diront-ils, en quoi
'•contifte chez nous l ’influeièce du Régime. Mais
qu’ils prentlertt garde que la difpofitiôn des compléments
eft une affaire de coiiftruéfion, que la
‘ détermination’ du Régime eft une affaire de Syntaxe,
& que, comme l ’a très - fagement obferve
.du Marfais au mot Construction , on ne doit
pas confondre la cônftruétipn avec la (yntaxe. » Ci-
.» céron, dit - i l , a dit , félon trois combinaifons
» différentes, Accepi littera s tua s , tuas àcpçpi
» litteras , & lit'teras accepi tuas : il y a là
» , trois coèiftiiéêlions , puifqu’i l y a trois différents
» arrangements de énols : çependaiit il n’y a qu’une
» fyntaxe ; car dans chacune de ces conftruâions il
» y a les mêmes figues des raports que les mots
» ont entre eux ». C ’eft a dire que le Régime
eft ' toujours le même dans chacune de ces trois
phrafes, quoique la conftrûélion y foît différente^
Si par raport à notre langue on perfiftoit à vouloir
regarder comme Régime la place qui eft a lignée
à chacun des compléments d’un même mot,
à raifon de leur étendue' refpeétive ; il faudroit
donc convenir que le même complément eft fujet
à différents Régimes, félon les différents degrés
d’étendue qu’il peut avoir relativemeièt aux autres
compléments du même mot. Mais , fous prétexte
de çônferver le langage des grammairiens -, ce
leroit en effet l’anéantir , puifque ce fer oit l ’entendre
dans un Cens abfolümen't inconnu- jufqu’ici ,
& oppofé d’ailleurs à la fignificâtion naturelle des
mots.
Ces obfervations lapent par lé fondement la
doéfrine de l’abbé Girard, concernant' le Régime
( Tpm. i ,'d ijc é iij, p a g ï 87 ). Il confiftë , lélon
lui , dans des rapotté' dè ' dépendance fournis aux,
règles pour la cônftruâion de la phrafo. » Ce n’eft'
» autre chofe , dit-il, 'que' le concours des mots
R ë G ’255
» pp,uç ,1 ’expfeffions d’un fens ou - d’une penféè.
» Dàns;..cte. .toncours de mots il y en a qui ticn-
» nent le îiaiit bout ; ils en régiffent d’autres, c eft
» a diré qu’ils les affujéliffent à certaines lois :
» il y. en a qui fo ptéfentent d’un air fournis , ils
» font- régis où terius. de fe conformer à l’état &
». aux fois’dés r,autres.,;' & il. y en a quifans être
». affujétis rri en affujétir, dfautres, n’ont de loi à
» obferver que celle de la place, dans l’arrange-
». ment général. Ce qui fait que , quoique tous
» lés mots de la phrafo foient en Régime, concou-
» rànt, tous à l’expreffion du fens, ils ne le font
»• pas néanmoins ’ de la même manière, les uns
» étant en Régime dominant, les autres en Régime
» affujéti ,& des troifièmçs.en Régime libre, lélon
» la fonction qu’ils y Font». '
Une preiniè/ç; erreur, de ce grammairien confilie
en ce qu’il raporte 1 e Régime à la conftructioa
de la phrafe; au. lieu qu’il eft,évident, par ce qui
précède , qu’il eft du diftrid de la Syntaxe , - ëc
qu’il demeure conflamment le . même malgré tous
les changements, .de conftruélion. D’ailleurs le
Régime confiftë dqns,la détermination des. .formes
des compléments grammaticaux eonfidérés comme
termes de certains raports ; & il ne confiftë .pa,s dans
les raports mêmes:, comme lé prétend l’abbé Girard.
, ;
Une fécondé erreur , c’eft que Cet académicien ,-
d’ailleurs habile & profond, ébloui par l’afféterie
même de fon ftyle , eft- tombé 'dans une contradiction
évidence : car comment peut - il fe faire
que le Régime confiftë, comme il le-'dit, dans
des raports dé dépendance, & qu’il y, ait' cependant
des 'mots qui foient en Régime libre ? Dépendance
& libeité.font des attributs incompatibles ; & cette
contradïétion ne fût-elle que dans les termes- &
non entre les» idées, c’eft affurément un vice impardonnable
dans le ltyle didactique , où la netteté
& la clarté doivent être portées ju{qu’au foru-
pule. .
- J ’ajoilte que l’idée d’un Régime libre, à prendre
la chofe daiis le fons même de l’auteur , eft une
idée abfolument faliffe ; parce que rien 11’eft indépendant
dans la phrafo, à; moins qu’il n’y ait pé-
riffologie ( Noye‘{ Pérïssologie):. | Vérifions ceci
fur la période même dont l’abbé Girard fe fort
pour faire reconnortre toutes les parties de la
phrafe : MojïJzeur, quoique le mérite ait ordinairement
un avantage fotïde fu r la fo r tun e c ep en dant
, chofe étrange !' nous donnons toujours la
préférence à. celle-ci.
Cette période eft eompofée de deux phrafes 9
dit l’aüteur, dans chacune defquelles fe trouvent
les fept membres qu’il diftingue. Je ne m’attacherai-
ici qu’à cefui qu’il appelle a djonclif, & qu’il
prétend être en Régime libre ;. c’eft, Mon fleur dans-,
la première partie .de la période y & chofe étrange
dans la fécondé. Toute propofition a deux parties ,
le fu jet & î’aifrjbut {voye\ Pr o p o s i t io n); &’