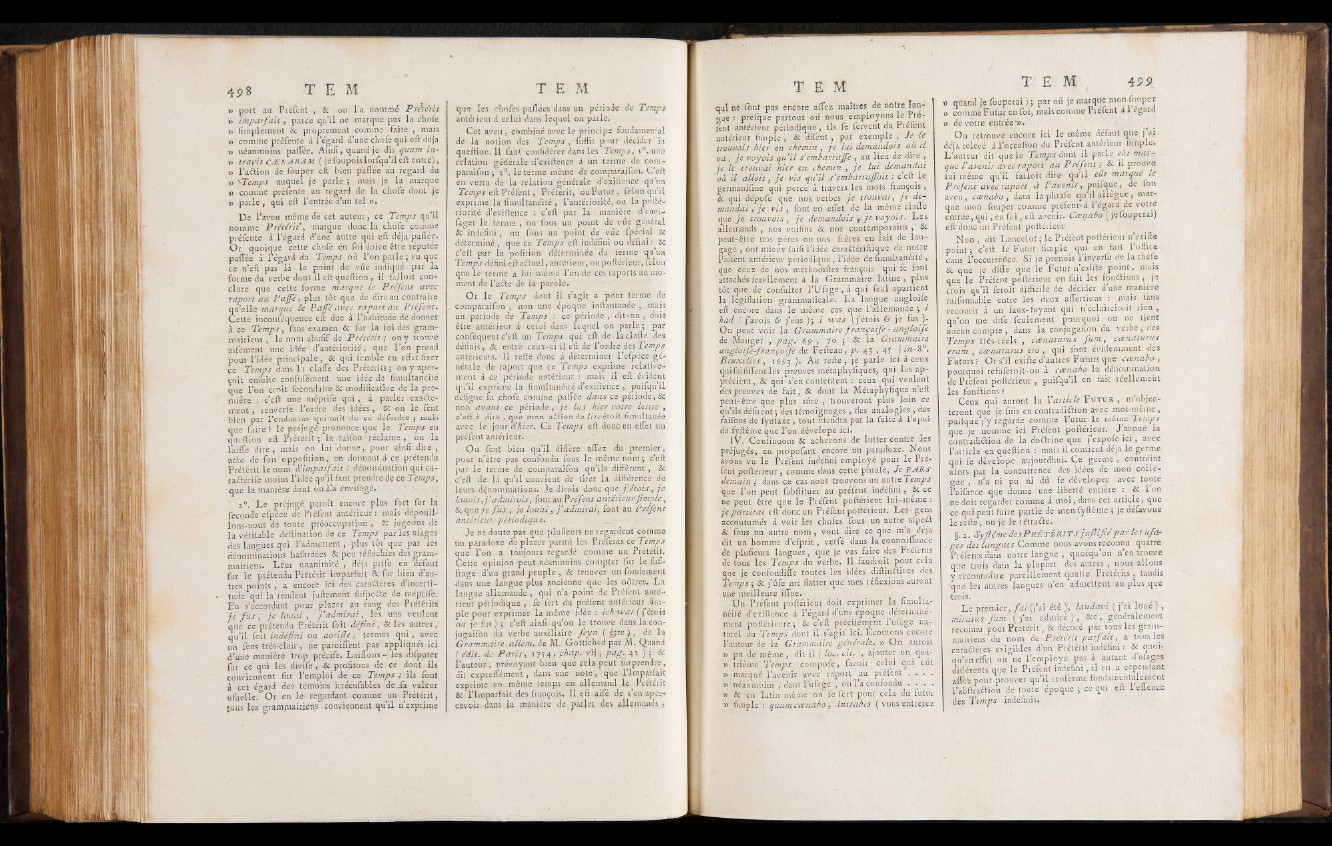
» port aa Préfent , & on T a nommé Prétérit
n imparfait, parce qu’il ne marque pas la choie
» Amplement & proprement comme faite , mais
» comme préfente à l ’égard d’une chofequi eft déjà
» néanmoins paflee. Ainfî, quand je dis quum in-
» travit C'ÆNABAM ( je foupois lorfqu’il eft entié),
» l ’adion de fouper eft bien paflee au regard du
» vTemps auquel je parle ; mais je la marque
» comme prélente au regard de la chofe dont je
» parle , qui eft l ’entrée d^un tel ».
De l’aveu même de cet auteur, ce Temps qu’il
nomme Prétérit , -marque donc la chofe comme
préfente à l’égard d’unè autre qui eft déjà paflee.
Or quoique cette chofe en foi doive être réputée
paffée a 1 egard du Temps où l’on parle ; vu que
ce n’eft pas là le point de vue indiqué par la
forme du verbe dont il eft queftion , il falloit con^
dure que cette forme marque le Préfent avec
raport au IJ a/Je, plus tôt que de dire au contraire
quelle marqué le Paffé avec raport au Préfent.
Cette inconléquence eft due à l ’habitude de.donner
à ce Temps, fans examen & fur la foi des gram.-
mairiens , le nom abùfîf de Prétérit; on y trouve
aifément une idée d’antériorité, que l ’on prend
pour l ’idée principale, & qui fembie en effet fixer
ce Temps dans la clafle des Prétérits; on y aperçoit
enfuite confufémènt -une idée de fimultanéité
que l ’on croit fecondaire & modificative de la première
: c’eft: une méprife qui , à parler^ exactement,
renverfe l’ordre des idées,~ & on le fent
bien par l ’embarras qui naît de ce défordre ; mais
que faire? le préjugé prononce que le Temps en
queftion eft Prétérit ; la raifon' réclame , on la
laifîe dire, mais on lui donne, pour ainfî dire ,
acte de fon oppofitio'n, en donnant à ce prétendu
Prétérit le nom d’imparfait : dénomination qui ca-
radérife moins l’idée qu’il faut prendre de ce Temps,
que la manière dont oii-l-a- ènvifage.
i° . Le préjugé paroît encore plus fort fur la
fécondé efpèce de Préfent antérieur : mais dépouillons
nous de toute préoccupation , & jugeo'ns de
la véritable deftinatïon de ce Temps^ par les ufages
des langues qui l’admettent ,-plus tôt que par les
dénominations hafardées &peu réfléchies de-s grammairiens.
Leur unanimité ,. déjà prife en ’défaut
fur le prétendu Prétérit imparfait & fur bien d’autres
points , a encore ici des caractères d’incertitude
qui la rendent juftement fufpede de méprife.
En s’accordant pour placer au rang des Prétérits
j e f u s , je louai , j ’admirai, les uns veulent
que ce prétendu Prétérit foit défini, & les autres,
qu’il foit indéfini ou aorifie ; termes qui , avec
nn fens très-clair, ne paroiflent pas appliquésrici
d’une manière trop précife. Laiflons les dilputer
fur ce qui les divife , & profitons de ce dont ils
conviennent fur l ’emploi de ce Temps ; ils font
à cet égard des témoins irrécufables de_fa valeur
ufuelle. Or en le regardant comme un Prétérit,
$gus les grammairiens conviennent qu’i l n’exprime
que les chofes paffées dans un période de Temps
antérieur d celui dans lequel on parle.
Cet.aveu, combiné avec le principe fondamental
de la notion des Temps , fuffit pour décider la
queftion.il faut confidérer dans les Temps, i° . une
relation générale d’exiftence d un terme de t.om-
paraifon; z°. le terme même de comparai fon.• C’eft
en vertu de la relation générale d’exiftence qu’un
Temps eft Préfent, Prétérit, ouFutur, félon qu’il
exprime la Simultanéité , l’antériorité, ou la pofté-
riorité d’exiftence : c’eft par la - manière d’envi-
fager le terme , ou fous un point de vue général
& indéfini , qu fous un point de vile fpécial &
déterminé , que ce Temps eft indéfini ou défini : &
c’eft par la pofition déterminée, du terme qu’un
Temps défini eft ad uel, antérieur, ou poftérieur, félon
que le terme a lui-même l ’un de ces raports au moment
de l’ade de la parole.
Or le Temps dont il s’agit a pour terme de
comparaifon , non une époque inftantanée , mais
un période de Temps : ce.période , dit-on , doit
être antérieur à celui dans lequel on parle ; par
conféquent c’eft un Temps qui eft de la clafle des
définis , & entre ceux-ci il eft de l’ordre des Temps
antérieurs. Il refte donc à déterminer l ’ efpèce générale
de raport que ce Temps exprime relativement
a ce période antérieur : mais il eft évident
qu’il exprime la fimultanéité d’exiftençe , puifqiftil
défigne fa ohofe c om m e paflee dans ce période, Sc
non avant c e période, jè lus hier votre lettre,,
c ’eft à dire , que mon adion de lire et oit fimultanée
avec le' jour d’hier. Ce Temps eft donç en effet un
préfent antérieur.
On fent bien qu’il diffère affez du premier,
pour n’être pas confondu fous le même nom ; c’eft
par le terme de comparaifon qu’ils different, &
c’eft de là qu’i l convient de tirer la différence de
leurs dénominations. Je dirois donc que j ’.étois, je
lo u o is ,f admirois, font au Préfent antérieur fimple,
& que je fu s , je louai , j ’admirai, font au Préfent
antérieure périodiqu e.
Je ne doute pas que plufieurs ne regardent comme
un paradoxe de placer parmi les-Préfents ce Temps
que l’on a toujours regardé comme un Prététit.
Cette opinion peut .néanmoins compter fur le fuf-
frave d’un grand peuple , & trouver un fondement
.dans une langue plus ancienne que les nôtres. L a
langue allemande, qui n’a point de Préfent antérieur
périodique ,- fe fert du préfent antérieur fimple
pour exprimer la même idée : ich war ( j’étois
ou je fus)'; c’eft ainfî quori le trouve danslacôn-
jugaifon du verbe auxiliaire feyn ( Jjre ) , de la
Grammaire^ailem. de M. Gottfched par M. Quand
( édit, de Paris , 1754, chape vi j , png. 41 ) &
l ’auteur , prévoyant bien que cela peut furprendre,
dit expreffément, dans une note, que l’imparfait
exprime, en même temps en allemand le Prétérit
& l ’Imparfait des françois. I l eft aifé de s’en apercevoir
dans la manière fte parler. çies allemands 3
T E M
quî ne font pas encore affez maîtres de notre langue
: prefque partout où nous employons le Pté-
lent antérieur périodique , ils fe fervent du Prefent
antérieur fimple, & difent , par exemple , Je le
trouvois hier en chemin, je lui demandais ou il
va , je voyois qu’i l s’embarrajfe , au lieu de dire ,
je le trouvai hier en chemin , je lui demandai,
oit il allait, je vis qicil s ’enibarrajfoit : c eft le
germanifme qui perce à travers les mots françois ,
& qui dépofe que nos verbes j e trouvai, j e demandai
, j e vis , font en effet de la même clafle
que je trouvois, je demandois f j e voyois. Les
allemands , nos voifîns & nos contemporains , &
peut-être nos pères ou nos frères en fait de langage
, ont mieux faifi l’idée caradériftiquè de notre
grêlent antérieur périodique, l’idée de fimultanéité,
que ceux de nos méthodiftes françois qui fe font
attachés fervilement à la Grammaire latine , plus
tôt que de confulter l ’Ufa g e ,à qui feul apartient
la légiflation grammaticale. La langue angloife
eft encore dans le' même cas que l ’allemande ; 1
had ;.( j’avois & j’eus : | i was (j’étois & je fus ).
On peut voir la Grammaire françoife:- angloife
de Mauger , pag, 69 , 70 ; & la Grammaire
angloife-françoife de Fefteau, p. -4 3 ,4 5 _( i?i-%°.
Bruxelles., 1693 ). Au refte , je parle ici à ceux
quifaifîffent les preuves mé-taphyfiques, qui les apprécient,
& qui s’en contentent : ceux qui veulent
des preuves de fait, & dont la Métaphyfique n eft
peut-être que plus sure , trouveront plus loin ce
qu’ils défirent ; des témoignages , des analogies^, des ,
raifons de fyntaxe , tout viendra par la fuite a l apui
du fÿftême que l ’on dèvelope ici.
IV. Continuons & achevons -de lutter contre les
préjugés, en propofant encore un paradoxe. Nous
avons vu le Préfent indéfini employé pour le Pre-
fént poftérieur, comme dans cette phrafe, Je PARS
demain ; dans ce cas nous trouvons un autre Temps
que l ’on peut fubftituer au préfent indéfini, & ce
ne peut être que le Préfent poftérieur lui-meme :
je partirai eft donc un Préfent poftérieur. Les-gens
accoutumés à voir les chofes fous un autre^ aipeéf
& fous un autre nom , vont dire ce que m à déjà
dit un homme d’efprit, verfé dans la connoiffance
de plufieurs langues, que je vas faire des Préfents
de tous les Temps du verbe. I l faudroit pour cela
que je confondiffe toutes les idées diftindtives des
'Bemps\ & j’ôfe me flatter que mes réflexions auront
une meilleure iffue.
Un Préfent poftérieur doit exprimer la fimultanéité
d’exiftence à l ’égard d’une époque determiné-
ment pdftérieure ; & c’eft precifement 1 ufage naturel
du Temps dont il s’agit ici. Ecoutons encore
l ’auteur de la Grammaire générale. » On auroit
» pu de. même, dit-il ( loc. cit. }, ajouter un qua*
» trième Temps compôfé, favoir celui qui eut
» marqué l ’avenir avec raport au prefent . . . .
» néanmoins , dans l ’ufage , on l ’a confondu . . . .
» & en latin même on fe fert pour cela du futur
» fimple : quuniccenabo,• intrabis (.vous entrerez
T É M 499.
ti quand je fouperai ) ; par où je marque mon fouper
» comme Futur en foi, mais comme Préfent à 1 egard
» de votre entrée*».
On retrouve encore ici le même défaut que j’ ai
déjà relevé à l ’occafion du Prefent antérieur fimple*
L ’auteur dit que le Temps dont il parle eut marqué
l’avenir avec raport au Préfent ; & il prouve
lui même qu’il faiioit dire- qu’il eût marqué le
Prejent avec raport à l’ avertir, puisque, de fon
aveu, ccenabo , dans la phràfe qu il allégué, marque
mon fouper comme préfent» à l ’egard de votre
entrée, qui, en fo i, eft avenir. Ccenabo ( je fouperai)
eft donc un Préfent poftérieur.
Non , dit Lancelot ; le Préfent poftérieur n’exifte
point ; c ’ e f t le Futur fimple qui en fait l ’office
dans l ’occurreùce. Si je prenois i inverfe de la thèfe
& que je dîffe- que le Futur n’exifte point, mais
que le Préfent poftérieur en fait les fonctions , je
crois qu’il feroit difficile de décider d une manière
raifonnable entre les deux affermions : mais fans
recourir à un faux-fuyant qui n éclair ciroit rien,
qu’on me dife feulement pourquoi on ne tient
aucun compte , dans la conjugaiibn du verbe, des
Temps très-réels , ccenaiurus fu t ji, ccenatürus
eram , ccenatürus ero , qui font évidemment des
Futurs ? Or s’il exifte d’autres Futurs que ccenabo ,
pourquoi refuferoit-on à ccenabo la^ dénomination
de Préfent poftérieur , puifqu il en fait réellement
les fondions ? . .
Ceux qui auront lu l ’article F utur , m objecteront
que je fuis en contradiction avec moi-meme ,
puifque j’y regarde comme Futur le meme Temps
que je nomme ici'Préfent poftérieur. J avoue la
contradiction de la doétrine que j expofe i c i , avec
l ’article en queftion : mais il co'nlient déjà le germe
qui fe dèvelope aujouxdhui. Ce germe , contraint
alors par la concurrence des idées de mon collè-
o-ue , n’a ni pu ni dû fe dèveloper avec toute
l ’aifance que donne une liberté entière : & l’on
_ne doit regarder comme à moi, dans cet article, que
ce qui peut faire partie de mon fyftême ; je défavoue
le refte, ou je le rétrade.
§.z. SyfiêmedesPRÉTÉRiTSjufiifiéparles ufa-
, ges des langues.Comme nous avons reconnu quatre
Préfents dans notre langue , quoiqu on n en trouve
que trois dans la plupart des autres , nous allons
y rèconnoître p a r e i l l e m e n t quatre Prétérits , tandis
que les autres langues n’en admettent auplus^ue
-trois.
Le premier, fu i (j’ai été ), laudavi ( j ai loué ) ,
miratus fum ( f a i a d m i r é 1 1 &c , g é n é r a l em e n t
reconnu pour Prétérit, & décoré par tous les grammairiens
du nom de Prétérit p a rfa it, a tous les
caradères exigibles d’ un Prétérit indéfini : & quoi-
qu’en effet on n e l ’employe pas a autant d’ufages
différents que le Préfent indéfini , il en a cependant
affeZ pour prouver qu’il renferme fondamentalement
l ’abftradion de toute époque ; ce qui eft 1 eflence
des Temps indéfinis.