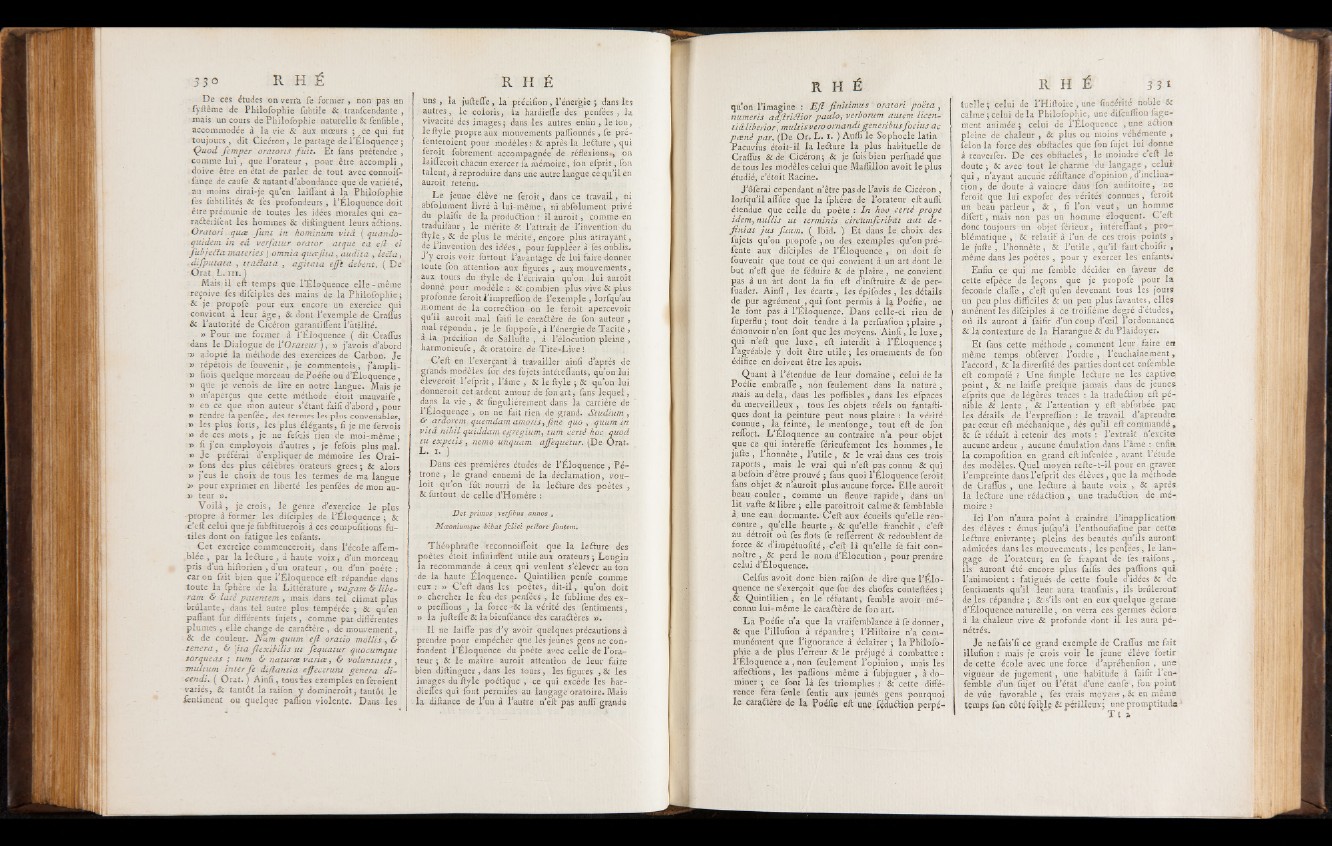
De ces études on verra fe former, non pas un
fyftême de Philofophie fubtile & tranfcendante ,
mais un cours de Philofophie naturelle & fenfible,
accommodée à la vie & aux moeurs ; ce qui fut
toujours , dit Cicéron, le partage de l’Éloquence ;
Quod fempër oratoris fu it . Et fans prétendre ,
comme lu i, que l’orateur , pour être accompli ,
doive être en état de parler de tout avec eonnoif-
fance de cauie & autant d’abondance que de variété,
au moins dirai-je qu’en laiffant à la Philofophie
fes lubtilités & fes profondeurs , l ’Éloquence doit
être prémunie de toutes les idées morales qui ca-
raétéiifent les hommes & distinguent leurs actions.
Oratari quee fun t in hominuni vitâ ( quando-
quidem in eâ verfatur orator atque eu eft ei
fubjecla materies j omnia qiiccfita, audita , le cl a ,
• difputata , traclata , agita ta ejft défont. (D e
Orat. L. n i. )
Mais il eft temps que l’Éloquence elle-même
reçoive fes difciples des mains de la Philofophie ;
& je propofe pour eux encore un exercice qui
convient a leur âge, 8c dont l’exemple de Craffus
& l’autorité de Cicéron garantirent l’utilité.
» Pour me former à l’Éloquence ( dit Craffus
dans le Dialogue de V Orateur), » j’avois d’abord
I» adopté la méthode des exercices de Carbon. Je
» répétois de fouvenir , je commentais, j’ampli-
» fiois quelque morceau de Poéfie ou d’Éloquence, j
» que je venois de lire en notre langue. Mais je
» m’aperçus que cette méthode étoit mauuaife,
» en ce que mon auteur s’étant faifî d’abord, pour
» rendre fapenfée, des termes les plus convenables,
» les plus forts, les plus élégants, fi je me fervois
» de ces mots , je ne fe fois rien de moi-même;
» fi j’en employois d’autres , je fefois plus mal.
» Je préférai d’expliquer de mémoire les Orai-
» fons des plus célèbres orateurs grecs ; & alors
» j’eus le choix de tous les termes de ma langue
y> pour exprimer en liberté » teur ». les penfées dé mon au-
Voilà , je crois, le genre d’exercice le plus
-propre à former les difciples de l’Éloquence ; &
-c’eft celui que je fubllituerois à ces compofitions futiles
dont on fatigue les enfants.
Cet exercice commenceroit, dans l ’école aflem-
.blée , par la lecture , à haute voix, d’un morceau
pris d’un hiftorien , d’un orateur , ou d’un poète :
car on fait bien que l ’Éloquence eft répandue dans -
toute la fphère de la Littérature , vagam & libe-
ram & latè patentent, mais dans tel climat plus ;
brûlante, dans tel autre plus tempérée ; & qu’en
paffant fur différents fujets, comme par différentes
plumes , elle change de caractère , de mouvement, & de couleur. Nam quum eft oratio mollis -, &
zenera, & \ita flex ib ilis ut fequatur quocumque
zorqueas ; tum & natures varies, & voluntates
multum inter f e diftantia effeceruru généra di-
cendi. ( Orat. ) Ainfi, tousies exemples en feroient
variés, & tantôt la raifon y domineroit, tantôt le
ièntiment ou quelque paffion violente. Dans les
uns , la jufteffe, la précifîon , l’énergie ; dans les
autres, le coloris, la hardieffe des penfées, la
vivacité des images ; dans les autres enfin , le ton,
le ftyle propre aux mouvements paffionnés , fe pré-
fenteroient pour modèles r & après la ledlure , qui
feroit fobrement accompagnée de réflexions*, on
laifferoit chacun exercer fà mémoire , fon efprit, fon
talent, à reproduire dans une autre langue ce qu’i l en
auroit retenu.
L e jeune élève ne feroit, dans ce travail, ni
abfolument livré à lui-même, ni abfolument privé
du plaifir de la produ&ion : il auroit, comme en
traduifanr , le mérite & l’attrait de l ’invention du
ftyle., & de plus le mérite, encore plus attrayant,
de 1 invention des idées , pour fuppléer à fes oublis.
J y crois voir furtout l ’avantage de lui faire donner
toute fon attention aux figures , aux mouvements,
aux tours du ftyle de l ’écrivain qu’on lui auroit
donné pour modèle: & combien plus vive & plus
profonde feroit i ’imprefïion de l ’exemple , lorfqu’au
moment de la correélion on le feroit apercevoir
qu il auroit mal faifi le caractère de fon auteur ,
mai répondu , je le fuppofe, à l ’énergie de Tacite ,
a la. précifîon de Sallufte , à l ’élocution pleine ,
harmonieufe, .& oratoire de Tite-Live !
C’éft en l ’exerçant à travailler ainfi d’après de
grands modèles fur des fujets intéreffants, qu’on lui
èleveroit ,1’efprit, l ’âme , & le ftyle ; & qu’on lui
. donnerait, cet.ardent amour de fon art j fans lequel,
dans la vie , & fingulièrement dans la carrière de
1 Éloquence , on ne fait rien de grand. Studium ,
& ardorem, quemdam amoris, fine quo , quum in
vitâ nihil quiddam egregium, tum certè hoc quod
tu expetis, nemo unquam ajfequetur. (De Orat.
L* £S:
Dans ces premières études’ de l ’Éloquence , Pétrone
, le grand ennemi de la déclamation , voûtait
qu’on fût nourri de la leéture des poètes ,
& furtout de celle d’Homère :
D e t primos verjibus annos ,
JMoeoniumque bibat felici peciore fontem.
Théophrafte 'reconnoiffoit que la leéture des
poètes étoit infininfènt utile aux orateurs ; Longin
la recommande à ceux qui veulent s’élever au ton
de la haute Éloquence. Quintilien penfe comme
eux : » C ’eft dans les poètes, dit-il, qu’on doit
» chercher le feu des penfées , le fublime des ex-
» preflions , la force la vérité des fentiments,
» la jufteffe & la bienféance d'es caractères ».
Il ne laiffe pas d’y avoir quelques précautions à
prendre pour empêcher que les jeunes gens ne confondent
l’Éloquence du poète avec celle de l ’orateur
; & le maître auroit attention de leur faire
bien diftinguer , dans les tours , les figures , & les
images du ftyle poétique , ce qui excède les har-
dieffes qui font permîtes au langage oratoire. Mais
la diftance de l ’un à l ’autre n’eft pas aufil grands
qu’on l ’imagine : E ft finitimus oratori p o e ta ,
numeris adftrittior pauloÿverbomm autem licen-
tiâliberior, multisvero ornandi generibus foetus ac
pesai par. (De Or. L . i. ) Auffi le Sophocle latin
Pacuvius étoit-il la le&ure la plus habituelle de
Craffus & de Cicéron; & je fuis bien perfuadé que
de tous les modèles-celui que Mafïïilon avoit le plus
étudié, c’était Racine.
J’ôferai cependant n’être pas de l ’avis de Cicéron ,
lorfqu’i l affure que la fphère de l’orateur eft auffi
étendue que celle du poète : In hoo certè prope
idem, nutlis ut terminis circlimfcribat aut de -
Jiniat ju s faim , ( Ibid. )r Et dans le. choix des
fujets qu’on propofe , ou des exemples qu’on préfente
aux difciples de l ’Éloquence , on doit fe
fouvenir que tout ce qui convient à un art dont le
but n’eft que de féduire & de plaire , ne convient
pas à un art dont la fin eft d’inftruire & de per-
fuader. Ainfi , les écarts , les épifodës , les détails
de pur agrément , qui font permis à I^l Poéfie, ne
le font pas à l ’Éloquence. Dans celle-ci rien de
fuperflu ; tout doit tendre à la perfuafion ; plaire-,
émouvoir n’en font que les moyens. Ainfi , le luxe,
qui n’eft que lu xe, eft interdit à l ’Éloquence ;
l ’agréable y doit être utile; les ornements de fon
édifice en doivent être les apuis.
Quant à l ’étendue de leur domaine , celui de la
Poéfie embraffe , non feulement dans la nature,
mais au delà, dans les poffibles , dans les efpaces
du merveilleux , tous les objets réels ou fantafti-
ques dont la peinture peut nous plaire : la vérité
connue, la feinte, le menfonge, tout eft de fon
reffort. L ’Éloquence au contraire n’a pour objet
que ce qui intéreffe férieufement les hommes, le
jufte , l ’honnête, l ’utile, & le vrai dans ces trois
raports, mais le vrai qui n’ eft pas connu & qui
a befoin d’être prouvé ; fans quoi l ’Éloquence feroit
fans objet & n’auroit plus aucune force. Elle auroit
beau couler , comme un fleuve rapide, dans un
lit vafte & libre ; elle paroitroit calme & femblable
a. une eau dormante. C’eft aux écueils qu’elle rencontre
, qu’elle heurte ,. & qu’elle franchit , c’eft
au détroit où fes flots fe refferrent & redoublent de
force & d’impétuofité, c’eft là qu’elle fe fait oon-
noitre , & perd le nom d’Élocution , pour prendre
celui d’Éloquence.
Celfus avoit donc bien raifoti de dire que l ’É loquence
ne s’exerçoit que fur des chôfes conteftées ;
.& Quintilien, en le réfutant, femble avoir méconnu
IuLmême le cara&ère de fon art.
L a Poéfie n’a que la vraifemblance à fe donner,
& que l ’illufion à répandre; l ’Hiftoire n’a communément
que l ’ignorance à éclairer ; la Philofo-
phie a de plus l ’erreur & 1e préjugé à combattre :
J/Éloquence a , non feulement l’opinion , mais les
affections, les paffions même à fubjuguer , à dominer
; ce font là fes triomphes : & cette différ
rence fera feule fentir aux jeunés gens pourquoi
le caraétere de la Poéfie eft une féduétion perpétuclle
; celui de l ’Hiftoire, une fincérilé noble &
calme;celui delà Philofophie, une dilcuftîon fage-
ment animée ; celui de l ’Éloquence , une aétioa
pleine de chaleur , & plus ou moins véhémente ,
félon la force des obftacles que fon fujet lui donne
à renverfer. De ces obftacles, le moindré c’eft le
doute ; & avec tout le charme du langage , celui
q u i, n’ayant aucune réfiftance d’opinion, d inclination
, de doute à vaincre dans fon auditoire, ne
feroit que lui expofer des vérités connues, feroit
un beau parleur , 8c , fi l’on veut, un homme
difert, mais non pas un homme éloquent. C ’eft
donc toujours un objet férieux, intérenant, problématique
, & relatif à l’un de ces trois points ,
le jufte , l ’honnête , & l ’utile , qu’il faut choifir ,
même dans les poètes , pour y exercer les enfants.
Enfin ce- qui me femble décider en faveur de
cette efpèce de leçons que je propofe pour la
fécondé claffe , c’eft qu’en devenant tous les jours
un peu plus difficiles & un peu plus favantes, elles
amènent les difciples à ce froifième degré d’études,
ou ils auront à faifîr d’un coup d’oeil l ’ordonnance
& la contexture de la Harangue & du Plaidoyer.
Et fans cette méthode , comment leur faire et*
même temps oblerver l’ordre , l ’enchaînement,
l’accord, & ladiverfité des parties dont cet enfemble
eft compofé ? Une fimple lecture ne les captive
point, & ne laiffe prefque jamais dans de jeunes
efprits que de légères traces : la traduction eft pénible
.& lente , & l ’attention y eft abforbée par
les détails de l ’expreffion : le travail d’aprendre
par coeur eft méchanique , dès qu’il eft commandé ,
& fe réduit à retenir des mots : l ’extrait n’excite
aucune ardeur , aucune émulation dans l’âme : enfin
la compofition en grand eft infenfée , avant l ’étude
des modèles. Quel moyen refte-t-il pour en graver
l ’empreinte dans l ’efprit des élèves , que la méthode
de Craffus , une leéture à haute voix , & après
la leéture une rédaction , une traduétion de mémoire
?
Ici l’on n’aura point à craindre l ’inapplication
des élèves : émus jufqu’à l ’enthoufiafme par cette
lecture enivrante; pleins des beautés qu’ils auront
admirées dans les mouvements, les penfées, le langage
de l ’orateur; en fe frapant de fes raifons
ils auront été encore plus faifis des paffions qui
l ’aniraoient : fatigués de cette foule d’idées & de
fentiments qu’i l leur aura tranfmis, ils brûleront
de les répandre ; & s’ils ont en eux quelque germe
d’É l oquence naturelle, on verra ces germes éclore
à la chaleur vive & profonde dont il les aura pénétrés.
Je ne fais'fî ce grand exemple de Craffus me fait
illufion : mais je crois voir le jeune élève fortir
de cette école avec une force d’apréhenfîon , une
vigueur de jugement, une habitude à faifîr l ’en-
femble d’un fujet ou l ’état d’une caufe , fon point
de vûe favorable , fes vrais moyens , & en même
temps fon côté taille & périlleux; une promptitude