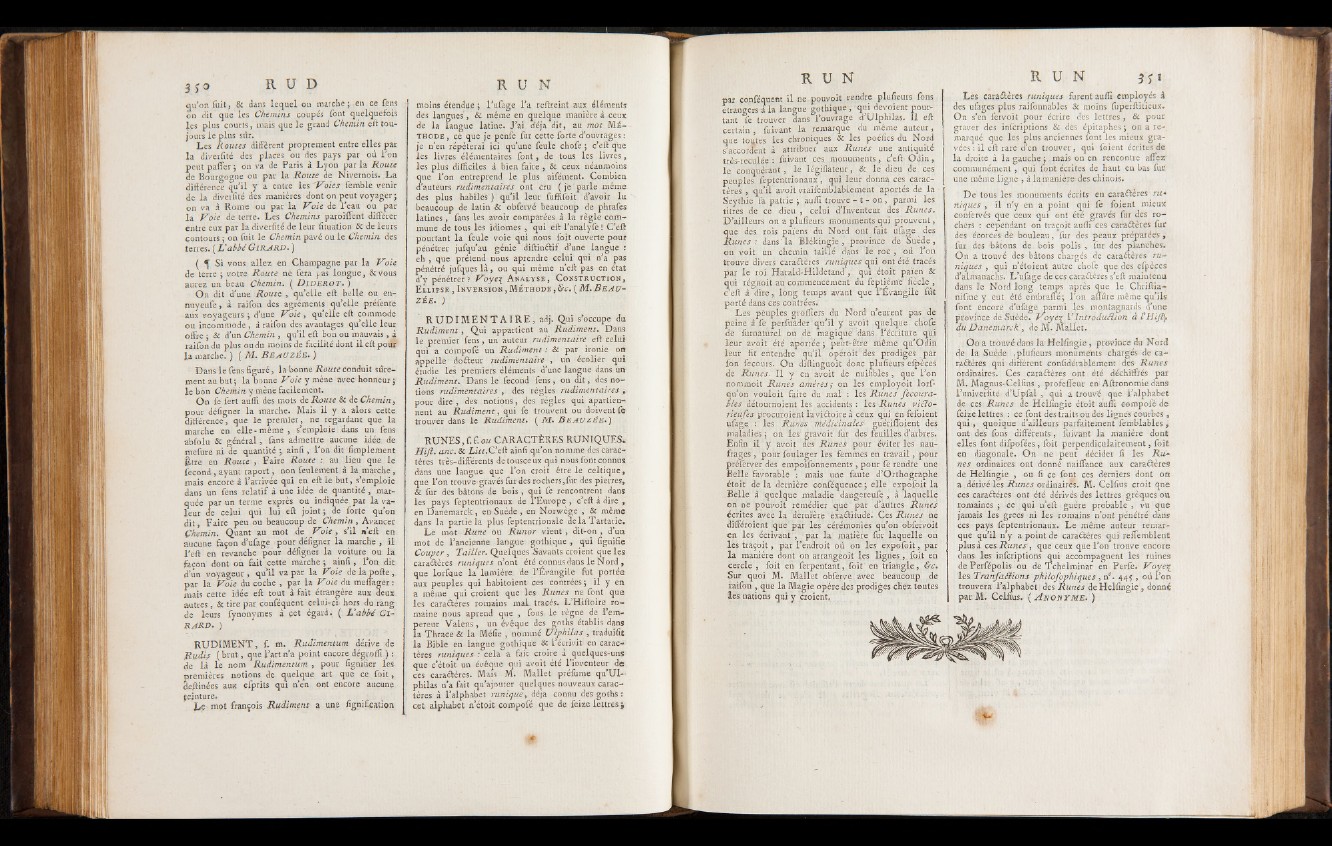
qu’on fuit, & dans lequel on marche ; en ce fens
on dit que les Chemins coupés font quelquefois
les plus courts, mais que le grand Chemin eft toujours
le plus sûr.
Les Routes diffèrent proprement entre elles par
la diverfité des places ou des pays par où l'on
peut paffer ; on va de Paris à Lyon par la Route
de Bourgogne ou par la Route de Nivemois. La
différence qu’i l y a entre les 'Vo ie s femble venir
de la diverfité des manières dont on peut voyager ;
on va a Rome ou par la Voie de l ’eau ou par
la Voie de terre. Les Chemins paroiffent différer
entre eux par la diverfité de leur fituation & de leurs
contours ; on fuit le Chemin pavé ou le Chemin, des
terres. ( JJabbé G i r a r d . )
( q Si vous allez en Champagne par la Voie
de terre ; votre Route ne fera pas longue, 8c vous
aurez un beau Chemin. ( D i d e r o t • )
On dit d’une Route , qu’elle eft belle ou en-
nuyeufe, à raifon des agréments quelle préfente
aux voyageurs ; d’une V o ie , qu’elle eft commode
ou incommode , à raifon des avantages qu’ elle leur
offre ; & d’un Chemin , qu’il eft bon ou mauvais , à
raifon du plus ou du moins de facilité dont i l eft pour
Ja marche. ) ( NL. B e a u z é e . )
Dans le fens figuré, la bonne Route conduit sûrement
au but-, la bonne Voie y mène avec honneur ;
le bon Chemin y mène facilement.
On fe fert auffi des mots de Route & de Chemin,
pour défigner la marche. Mais il y a alors, cette
différence, que le premier, ne regardant que. la
marche en elle-même x s’emploie dans un. fens
abfolu & général, fans admettre aucune idée de
mefure ni de quantité ; ainfî , l ’on die Amplement
Être en Route , Faire Route : au lieu que le
fécond , ayant raport, non feulement à la. marche,
mais encore à l’arrivée qui en eft le but, s’emploie
dans un fens relatif à une idée de quantité, marquée
par un terme exprès ou indiquée par la valeur
de celui qui lui eft joint; de forte qu’on
d it, Faire peu ou beaucoup de Chemin, Avancer
Chemin. Quant au mot de V o ie , s’il n’eft en
aucune façon d’ufage pour défigner la marche , il
l ’ eft en revanche pour défigner la voiture ou la
façon dont on fait cette marche; ainfi, l ’on dit
d’un voyageur, qu’il va par la Voie delapofte,.
par la Voie du coche , par la Voie du meffager :
mais cette idée eft tout à fait étrangère aux deux
autres, & tire par conféquent celuirci hors du rang
de leurs fynonymes à çet égards ( Uabbé C i-
R A R D . )
RU D IM EN T, f. m. Rudimentum dérive de
R ud if (brut, que l’artna point encore dégrofïi.) :
de là le nom Rudimentum , pour fignifier les
premières notions de quelque art que ce fo it,
destinées aux efprits qui n en ont encore aucune
peinture. . 1 -, Le mot françois Rudiment a une lignification
moins étendue ; l ’ ufage l ’a reftreint aux éléments
des langues, & même en quelque manière à .ceux
de la langue latine. J’ai déjà dit, au mot Méthode
, cè que je penfe fur cette forte d’ouvrages :
je n’en répéterai ici qu’une feule chofe ; c’eft que
les livres élémentaires font, de tous les livres,
les plus difficiles à bien faire , & ceux néanmoins
qne l’on entreprend le plus aifément. Combien
d’auteurs rudimentaires ont cru ( je parle même
des plus habiles ) qu’il leur fuffifoit d’avoir lu
beaucoup de latin & obfervé beaucoup de phrafes
latines , fans les avoir comparées à la règle commune
de tous les idiomes , qui eft l ’analyfe ! C’eft
pourtant la feule voie qui nous foit ouverte pour
pénétrer jufqu’au génie diftinétif d’une langue :
eh , que prétend nous aprendre celui qui n’a pas
pénétré jufques l à , ou qui même n’eft pas en état
d’y pénétrer? Voye\ Analyse, Construction,
Ellipse , Inversion , Méthode , &c, ( M. B e a u -
z é e . )
R U D IM E N T A I R E , adj. Qui s’occupe du
Rudiment, Qui appartient au Rudiment. Dans
le premier fens, un auteur rudimentaire eft celui
qui a compofë un Rudiment : & par^ ironie on
appelle doéteur rudimentaire , un écolier qui
étudie les premiers éléments d’une langue dans un
Rudiment. Dans le fécond fens, on dit, des notions
rudimentaires , des règles rudimentaires ,
pour dire , des notions, des règles qui apartien-
nent au Rudiment, qui fe trouvent ou doivent fc
trouver dans le Rudiment. ( M.. B e a u z é e .)
RUNES, f. f. ou CARACTÈRES RUNIQUES..
H iß . anc. & Litt.C’eft ainfi qu’on nomme des caractères
très-différents de tousceux qui nous font connus
dans une langue- que l’on croit être le celtique,
que l ’on trouve-gravés fur des rochers, fur des pierres,
& fur des bâtons de bois , qui fe rencontrent dans
les pays feptentrionaux- de l’Europe , c’eft à dire ,
en Danemarck, en Suède, en Norwège , & même
dans la partie la plus feptentrionaie delà Tartarie.
Le mot Rune ou Riinor vient , ditf-on , d’un
mot de l ’ancienne langue gothique , qui fignifie
Couper, Tailler. Quelques .Savants croient que les
caractères runiques n’ont été connus dans le Nord ,
que lorfque la lumière de l ’Évangile fut portée
aux peuples qui habitaient ces contrées; i l y en
a même qui croient que les- Runes ne font que
les caractères romains mal. tracés. L ’Hiftoire romaine
nous aprend que , fous- le règne de l ’empereur
Valens , un évêque des goths établis dans
la Thrace & la Méfie , nommé Zslphilas , traduifît
la Bible en langue gothique 8c l’écrivit en caractères
runiques : cela a fait croire à quelques-uns
que c’étoit un évêque qui avoit été l ’inventeur de
ces caractères. Mais M. Mallet préfume qu’U l -
philas n’a fait qu’ajouter quelques nouveaux caractères
à l’alphabet rûnique, déjà connu des goths :
cet alphabet n’étpit çompofé que de feize lettres ;
*
par copféquent il ne pouvoit rendre plufieurs fons
étrangers à la langue gothique, qui dévoient pourtant
fe trouver dans l ’ouvrage d’Ulphilas. Il eft
certain , fuivant la remarque du même auteur,
que toutes les chroniques & les poéfies du Nord
s’accordent à attribuer aux Runes une antiquité
très-recu,léç : fuivant ces., monuments , c’eft-Odin,
le conquérant, le légifiateur, & le dieu de ces
peuples feptentrionaux , qui leur donna cés caractères
qu’il avoit vraifemblablement àportés de la
Scythie fa patrie ; auffi trouve - t - on , parmi les
titres de ce dieu , celui d’inventeur des Runes.
D’ailleurs on a plufieurs monuments qui prouvent,
que des rois, païens du Nord ont fait ufage des
Runes : dans Ta Blékingie , .province de Suède ,
on voit un chemin taillé dans le roc , où l ’on
trouve divers caractères runiques qui ont été tracés
par le roi Harald-Hildetand , qui était païen &
qui régnoit au commencement du feptième' fièclé,
c ’eft à dire, long temps avant que l ’Évangile fût
porté dans ces contrées;.
Les peuples groffiers du Nord n’èurent pas de
peine à fe perfuader qu’ il y avoit quelque.' chofe
de furnàturel ou de magique ’dans. l’ écriture qui
leur avoit été aportée ; peut-être même qu’Odin
leur fit entendre qu’il opérôit' des prodiges pair
fon fecours. On diftinguoit donc plufieurs efpèces
de Runes. Il y en avoit de nuifibles, que l ’on
nommoit Runes amères j on les employoit lorf-
qu’on vouloit faire du mal : les Runes fecoura-
bles ' détournoient les accidents : les Runes vicîo-
rieufes proeuf oient la victoire à ceux qui en fefoient
ufage. : les Runes médicinales- guériffoient des
maladies ; on les gravoit fur des feuilles d’arbres.
Enfin i l y avoit des Runes pour éviter les naufrages
, pour foülager les femmes en travail, pour
préferver des empoifonnements , pour fe rendre une
Belle favorable : mais une faute d’Orthographe
étoit delà dernière conféquence; elle expofoit la
Belle à quelque maladie dangereufe , à laquelle
on ne pouvoit remédier que par d’autres Runes
écrites avec là dernière êxàétitùde. Ces Runes ne
différoient que par lès cérémonies qu’on obfervoit
en les écrivant , par la matièie fur laquelle on
les traçoit, par l ’endroit où on lès expofoit, par
la manière dont on arrangeoit les lignes., foi.t en
cercle , foit en ferpentant, foit en triangle, &c.
Sur quoi M. Mallet obfèrve. avec beaucoup de
iaifon , que la Magie opère des prodiges chez toutes
les nations qui y croient.
Les cara&ères runiques furent auffi employés a
des ufages plus raifonnables & moins fuperftilieux.
On s’en fervoit pour écrire des lettres , & pour
graver des inferiptions & des épitaphes; on a remarqué
que les plus anciennes font les mieux gravées
: il eft rare d’en trouver, qui foient écrites de
la droite à la gauche ; mais on en rencontre affez
communément , qui font écrites de haut en bas fur
une même ligne , à la manière des chinois.
De tous les monuments écrits en caraéléres ru-
niques , il n’y en a point qui fe foient mieux
confervés que ceux qui ont été gravés fur des rochers
: cependant on traçoit auffi ces caraétères fur
des écorces de bouleau, fur des peaux préparées,
fur des -bâtons de bois polis , fur des planches.
On a trouvé des bâtons chargés de caraétères ;•«-
niques , qui n’étoient autre chofe que. des efpèces
d’almanachs. L ’ufage de ces caraétères s’eft maintenu
dans le Nord long temps après que le Chriftia-
nïfme y eut été embrané; l ’on affûre même qu’ils
font encore d’ùfage parmi les montagnards d’une
ptovince de Suède. Voye\ Yïntrôduclion à Vidïjl\a
du Danemarck, de M. Mallet.
On a trouvé dans la Helfingie , province du Nord
de la Suède .plufieurs monuments chargés de caractères
qui diffèrent confidérablement des Runes
ordinaires. Ces caraétères ont été déchiffrés par
M. Magnus-Celfius , profeffeur en Aftronomie dans
l’univerfité d’Upfal , qui a trouvé que l’alphabet
de ces Runes de Helfingie étoit aufli eompofé de
feize lettres : ce font des traits ou des lignes courbes ,
q u i, quoique d’ailleurs parfaitement fèmblables ,
ont des fons différents, fuivant la manière dont
elles font difpofées, foit perpendiculairement, foit
en diagonale. On ne peut décider fi les Ru*
nés ordinaires ont donné naiffance aux caraétères
de Helfingie , ou fi ce font ces derniers dont on
a , dérivé les Runes ordinaires. M. Celfius croit qne
ces caraétères ont été dérivés des lettres grèquesou
romaines ; ce qui n’eft guère probable , vu que
jamais les grecs ni les romains n’ont pénétré dans
ces: pays feptentrionaux. Le même auteur remarque
qu’il n’y a-point de caraétères qui reffemblent
plus a ces R u n e s , que ceux que l’on trouve encore
dans, les inferiptions qui accompagnent les ruines
de Perfépolis ou de Tchelminar en Perfe. Voye%
les Tranjactions philofophiques, n°. 445 , où l ’on
trouvera l ’alphabet des Runes de H elfingie, donné
par M. Celfius. ( A n o n ym e . )