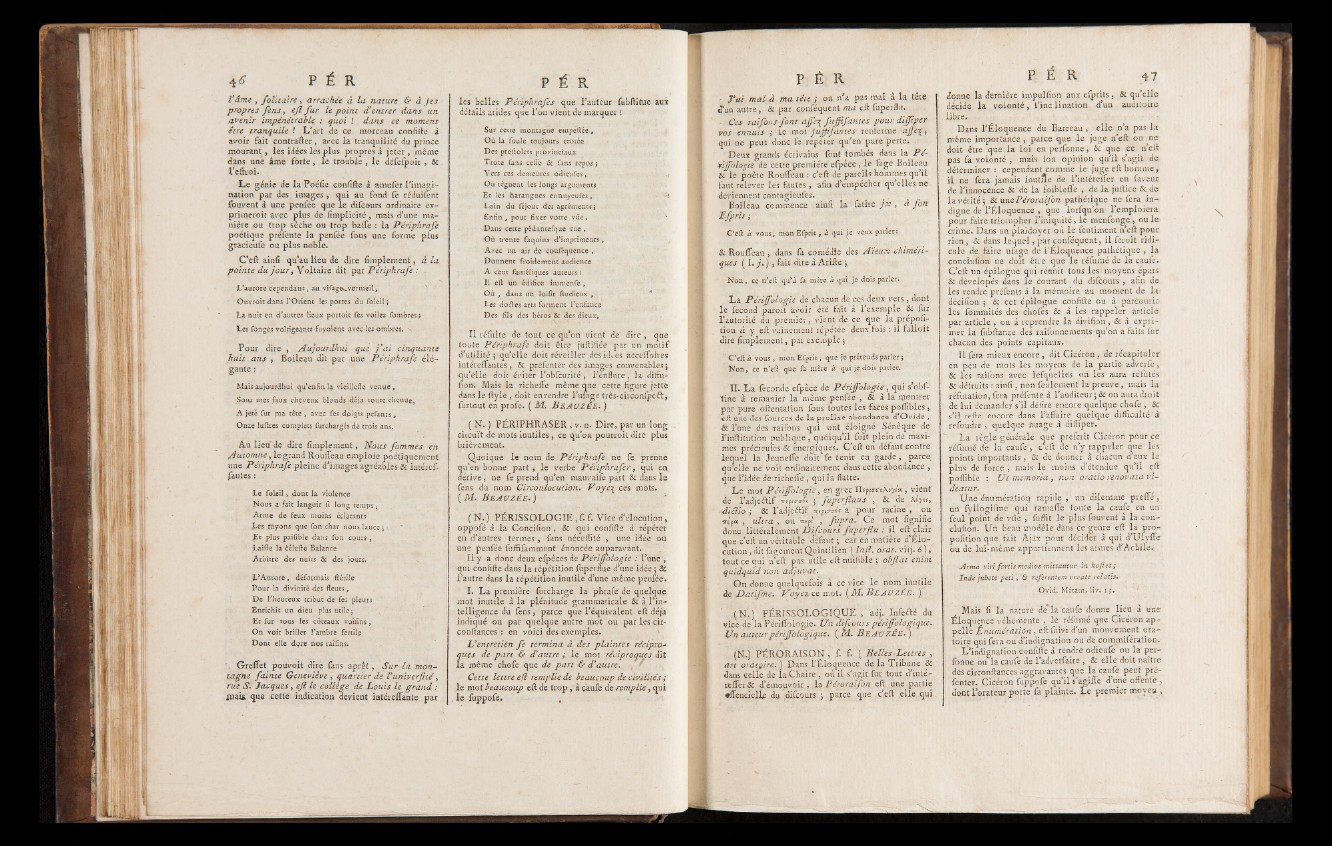
P É R
Pâme , fo lita ir e , artachée à la nature & d J es
propres f in s , e jl fu r le point d’entrer dans un
avenir impénétrable : quoi ! dans ce moment
être tranquile ! L ’art de ce morceau confifte à
avoir fait contrafter, avec la tranquilité du prince
mourant, les idées les plus propres a jeter , même
dans une âme fôrte, le trouble , le défefpoir, &
l ’effroi.
L e génie de la Poéfîe confifte à amufer l ’imagination
par des images , qui au fond fé réduilent
fouvent â une penfée que le difeours ordinaire ex-
primeroit avec plus de fimplicjté, mais d’une manière
ou trop sèche ou trop baffe : la Périphrafi
poétique preJfente la penfée fous une forme plus
gracieüfe ou plus noble.
C ’eft ainfi qu’au lieu de dire fimplement, à la
pointe du jo u r , Voltaire dit par Périphrafi :
L ’aurore cependant, auJvifage^vermeil,
■ Ouvroic dans l ’Orient les portes du foleil ;
La nuit en d’autres lieux portoic fes voiles fombres j
Les Congés voltigeants fuyoient avec les ombres. v-
Pour dire , Aujourdhui que j ’ai cinquante
huit ans > Boileau dit par une Périphrafi élégante
;
Mais aujourdhui qu’ enfin la vieilleiïe v enue,
]Sous mes faux cheveux blonds déjà toute chenue,
A jeté fur pia tête , avec fes doigts pefants,
Onze luftres complets furchargés de trois ans.
Au lieü~de dire fimplement, Nous fommes en
Automne, le gra.nd Roufleau emploie poétiquement
une Périphrafi pleine d’images agréables & iméref-
&utes:
Le fo le il, dont la violence
Nous a fait languir fi long temps,
Arme de feux moins éclatants
Les rayons que fon .char nous lance :
E t plus paifible dans fon cours , ;
Laide la èélefte Balance
Arbitre des nuits & des jours. -
L ? Aurore, déformais flérile
Pour la divinité des fleurs,
De l ’heureux tribut de fes pleurs
Enrichit un dieu plus utile:
Et fur tous les coteaux voiflns,
On voit briller l’ambre fertile
Dont elle dçre nos raifîns,
. Greffet pouvoit dire fans aprêt, S u r la 'montagne
fainte Geneviève , quartier de l’univerjîté,
rue S. Jacques, ejl le collège de Louis le grand :
jnai& que cette indication devient intéreffante par
P É R
les belles Périphrafis que l ’auteur fiabftitue aux
détails arides que l’on vient de marquer I
Sur cette montagne empeflee ,
Où la foule toujours crotée
Des preflolets provinciaux
Trote fans cefle & fans repos.}
Vers ces demeures oflieufes, ■
Où régnent les longs arguments.
Et les- harangues ennuyeufes, -
Loiir du féjour des agréments}
Enfin , pour fixer votre vue , '■
Dans cette péda,ntefque rue ,
Où trente faquins d’imprimeurs , ,
Avec un ajr de conféquence ,
Donnent froidement audience
A cent faméliques auteurs :
II eft un-édifice immenfe ,
Où , dans un ioifirjftudieux >
Les do étés arts forment l’enfance
Des fils des héros & des dieux,
Il réfulte de tout ce qu’on vient de dire , que
toute Périphrafi doit être jufti.fiée par un motif
d’utilité ; qu’elle doit réveiller des idees àccefloires
iutéreflantes, & préfenter des images convenables j
qu’elle doit éviter l’obfcurité , Eenflüre, la diffu-
fion. Mais la richefle même que cette figure jette
dans le fty le , doit en rendre l ’ulage très-circonfpeét,
furtout en profe. ( M. B e a u z é e . )
( N. ) PERÏPHRASER , v. q. Dire, par un long
circuit de mot« inutiles, ce qu’on pourroit dire plus
brièvement.
Quoique le nom de Périphrafi ne fe prenne
qu’en bonne p art, le verbe Pérïphrdfir,, qui en,
dérive, ne fe prend qu’en mauvaife part & dans le
fens du nom Circonlocution. Voye^ ces mots.
( M. B e a u z é e . )
(N. ) PÉRISSOLOGIE , f. f. Vice d’élocution,
oppofé â la Concifion , & qui confifte à répéter
en d’autres termes , fans néceflîté , une idée ou
une penfée fuffifamment énoncée auparavant.
Il y a donc deux efpèces de Périjfologie : l ’une ,
qui confifte dans la répétition fuperflue d’une idée ; &
l ’autre dans la répétition inutile d’une même penfée.
I. L a première furcharge la phrafe de quelque
mot inutile à la plénitude grammaticale & à l ’intelligence
du fens, parce que l ’équivalent eft déjà
indiqué ou par quelque autre mot ou par les çir-
conftances : en voici des exemples.
L ’entretien f i termina à des plaintes récipro**
ques de part & d?autre ; le mot réciproques dit
la même chofe que de part & d’autre. \l /
Cette lettre efl remplie de beaucoup de civilités ;
le moi beaucoup eft de trop, à ç'^ufe de remplie, qui
le fuppofe. ,
P É R
■ J*ai mal à ma tête j oo n’ a pas mal a la tete
iTun autre, & par conféquent ma eft fupeiflu.
• Ces raifons fon t affe\ fwffifantes pour dijjiper
vos ennuis ; le mot Juÿifartes renferme ajje^ qui ne peut donc fe répéter qu’en pure perte.
Deux grands écrivains font tombes dans la Pe-
rijfologie de cette première efpèce , le fage Boileau
& le poète Roufleau : c’eft de pareils hommes qu’il
faut, relever les fautes , afin d’empécher qu’elles ne
deviennent contagieùfes. 1 .
Boileau commence ainfi la fatire joc , a fon
Efprit ;
C ’eft a vousj mon Efpric, à qui je veux parler:
& Roufleau , dans fa comédie des A ïeu x chimériques
( I. j i ) , fait dire à Arifte j
N o n , ce n’eft qu’à fa mère a qui je dois.parler:
La Périjfologie de chacun de ces deux vers, dont
le fécond paroît avoir été fait à l ’exemple & fur
l ’autorité du premier, vient de ce que la prépofî-
tion à y eft vainement répétée deux fois : il failbit
dire fimplement, par exemple j
C'eft à vous i mon Efpric, que jê prétends parler}
No n , ce n’eft que fa mère à-qui je dois parlée.
II. La fécondé efpèce de P érijfologie, qui s obf-
line à remanier la même penfée , & à la ipontrer
par pure bftentation fo.us toutes les faces poflibles,
-eft une des fources de la prolixe abondance d Ovi'de,
& l ’une des raifons qui ont éloigné Séneque de
rinftitution publique , quoiqu?i 1 foit plein de maximes
précieufes & énergiques. C’eft un défaut .contre
lequel la Jeunefle doit fe tenir en garde, parce,
qu elle ne voit ordinairement dans cette abondance ,
que l ’idée de-richefle , qui la flatte.
Le mot Périjfologie y t n grec IÏ£p:«rcroAoy/cc, vient
de l ’adjectif irtp/oW* ; fuperfluus , & de Aoyor,
diclio i & radjeétif .mpvmi a pour racine, ou
Wp« , ultra , pu ~7r£pt , fupra. Ce mot fignifie
donc littéralement JDifcours fuperflu : il eft clair
que c’eft un véritable défaut ; car en matière d’Élo-
cution, dit fâgement Quintilien ( Infl. orat. viij. 6 ),
tout ce qui 'n’eft' pas utile eft nuifible j objlat enim
quidquid non adjitvat.
On donne quelquefois à ce vice le nom inutile
de D a t if me. ; l^oy e% ce mot. (Af. BEAUZÉE. )
(N .) PÉRISSOLOGIQUE , adj. Infeété du
vice de la Périffologie. Un difeours périffologique.
Un auteurpérijfologique. [ M. B e a u z é e . )
(N.) PÉRO R A ISON , f. £.'( Belles-Lettres ,
art oratoire. ) Dans rÉloqueqce de la Tribune &
dans celle de la Chaire , ou il s’agit fur tout d’inté-
refler & d’émouvoir , la Péforaifon eft une partie
«ffencielfe du difeours j parce que : c’eft elle qui
P- É R 47
donne la dernière impulfion aux elprits, & qu’elle
décide la volonté, l’inclination d’un auditoire
libre.
Dans l ’Éloquence du Barreau , elle n’a pas la
même importance, parce que le juge n’eft ou ne
doit être que la loi en perfonne, &. ^ue ce n’eft
pas fa volonté , mais fon opinion qu il s’agit de
déterminer : cependant comme le juge eft homme,
il ne fera jamais inutile de l ’intérefler en faveur
de l ’innocence & de la foibiefle , de la juftice & de
la vérité; & une Péroraifon pathétique ne fera indigne
de l ’Éloquence , que lorfquon l ’emploiera
pour faire triompher l ’iniquité, le menfonge, ouïe
crime. Dans un.plaidoyer où le fentiment n’eft pour
rien, & dans leque l, par conféquent, il feroit ridicule
de faire ufage de l’Éloquence pathétique , la
conclufion ne doit être que le réfumé de la caufe.
C ’eft tin épilogue qui réunit tous les moyens épars
& dèvelopés dans le courant du difeours , afin de
les fendre préfents à la mémoire au moment de la
décifion ; & cet épilogue confifte ou à parcourir
les fommités des chofes & à les rappeler article
par article , ou à reprendre la divifion, & à exprimer
la fubftance des raifonnements qu’on a faits tür
chacun des points capitaux.
Il fera mieux encore , dit Cicéron, de récapituler
en peu de mots les moyens de la partie adve.rfe,
& les raifons avec lefquelles on les aura réfutés
& détruits ■: ainfi, non feulement la preuve, mais la
réfutation, fera préfente à l ’auditeur ;& on aura droit
de lui demander s’il délire encore quelque chofe , &
s’il refte encore dans l ’affaire quelque difficulté à
refoudre , quelque nuage à difliper.
La règle générale que preferit Cicéron pour ce
réfumé de la caufe , c’eft de n’y rappeler que les
points importants , & de donner à chacun d’eux le
plus de force , mais le moins d’étendue qu’il eft
polfible : Ut memoria, non oraiio renovata vide'atur.
Une énumération rapide , un dilemme prefle,
un fyllogifme qui ramaffe toute la caufe en un
feul point de vue , fuflît le plus fouvent a la conclufion.
Un beau modèle dans ce genre eft la pro-
pofition que fait Ajax pour décider à qui d’Ulyfle
ou de lui-même appartiennent les armes d’Achile«,
Arma virifortis 'medies mittaniur in hoftes;
Inde jubete peti y & referentem ornate relati».
Ovid. Métam. liv. x j .
Mais fi la nature de* la caufe donne lieu à une
Éloquence véhémente , le réfumé que Cicéron appelle
Énumération, eft fuivi d’un mouvement oratoire
qui fera ou d’indignation ou de commifération.
L ’indignation confifte à rendre odieufe ou la perfonne
ou la caufe de l’adverfaire, & elle doit naître
des circonftances aggravantes que la caufe peut préfenter,
Cicéron fuppofe qu’il s’agiffe d’une offenle ,
dont l’orateur porte, fa plainte. Le premier moyeu ,