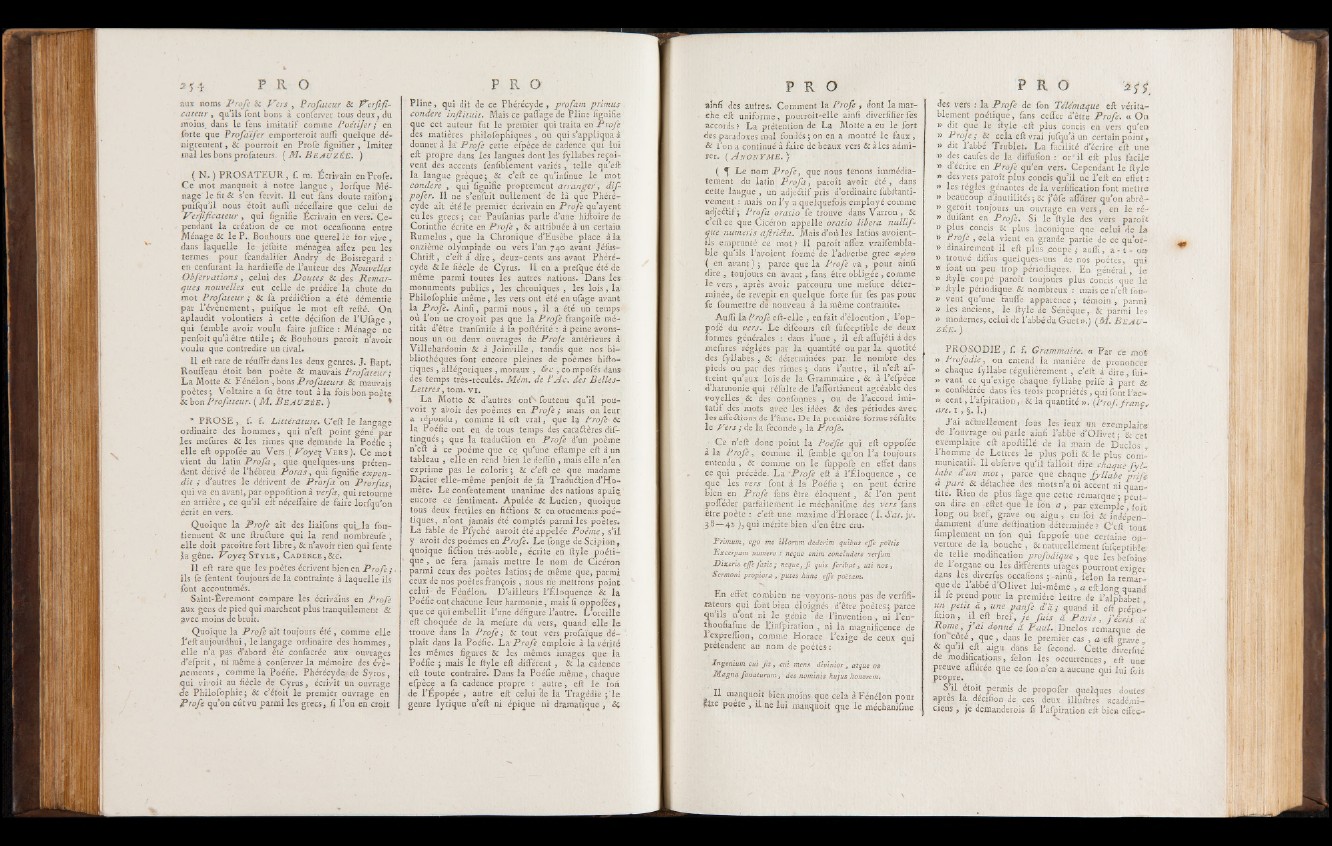
M l P R O
aux noms Profe 8c Vers , Profiteur 8c Verfifi-
£ a te tir , qu’ils font bons à conferver tous deux, du
moins, dans le le ns imitatif comme Poédjer ,* en
forte que Profaïfer emporteroit auffi quelque dénigrement
, & pourroit en Proie lignifier , Imiter
mal les bons profateurs. ( M. B e a ü z é e . )
( N , ) PR O SA T EU R , f. m. Écrivain en Profe.
C e mot manquoit à notre langue , lorfque Ménage
le fit, & s'en fervit. Il eut fans doute raifon ;
puilqu’il nous étoit aulïi néceflaire que celui de
Vérificateur , qui fignifie Écrivain en vers." Cependant
la création de ce mot occafîonna entre
Ménage & le P.. Bouhours une querel le for vive,
dans laquelle le jéfuite ménagea allez peu les
termes pour fcandalifer Andry de Boisregard : ~
en cenfurant la hardieffe de l'auteur des Nouvelles
Obfervadons, celui des Doutes & des Remarques
nouvelles eut celle de prédire' la chute du
mot Profateur ; & fa prédiétion a été démentie
par l'évènement, puifque le mot eft relié. On
aplaudit volontiers a cette décifîon de l ’Ufao-e ,
qui lemble avoir voulu faire juftice : Ménage ne
penfoit qu’à être utile ; & Bouhours paroit n avoir
voulu que contredire un rival.
11 eft rare de réüflh; dans les deux genres. J. Bapt.
RoulTeau étoit bon poète & mauvais Profateur;
L a Motte & Fénélon^bons Profateurs 8c mauvais
poètes ; Voltaire a fu être tout à la fois bon poète
8c bon Profateur. ( M. B e a u z è e . )
* PR O S E , f. f. Littérature. C’elt le langage
ordinaire des hommes, qui n’eft point géné par
les mefures & les rimes que demande la Poélie ;
elle eft oppofée _au Vers ( Vdye^ V ers), Ce mot
vient du latin Profa 9 que quelques-uns prétendent
dérivé de l ’hébreu P o ra s , qui fignifie expen- '
4 it ; d'autres le dérivent de Prorfa ou Prorfus,
qui va en avant, par oppofition à verfa, qui retourne
en arrière, ce qu’i l eft néceflaire de faire lorfqu'on
écrit en vers,
.Quoique la Profe ait des liaifons quLia fou-
tiennent & une ftructure qui la rend nombreufe ,
e lle doit paroître fort libre, & n’avoir rien qui fente
fa gêne. Voye\ Style , Cadence , &c.
I l eft rare que les poètes écrivent bien en Profe ; .
ils Ce fentent toujours de la contrainte à laquelle ils
font accoutumés.
Saint-Èvremont compare les écrivains en Profe
aux gens de pied qui marchent plus tranquilement &
avec moins de bruit.
Quoique la Profe ait toujours été , comme elle
l ’ eft aujourdhui, le langage ordinaire des hommes ,
elle n’a pas d’abord été confacrée aux ouvrages
d'efprit, ni même à conferver la mémoire des évènements
, comme la Poéfie. Phérécyde^de Syros ,
qui vivoit aü fiècle de Cyrus, écrivit un ouvrage
de Philofophie; & c’éjîoit le premier ouvrage en
Profe qu'on eût vu parmi les grecs, fi l'on en croit |
P R O
Pline, qui dit de ce Phérécyde , profam primus
condere inflituit. Mais ce paflage de Pline fignifie
que cet auteur fut le premier qui traita en Profe
des matières philofophiques , ou qui s'appliqua à
donner à là' Profe cette efpèce de cadence qui lui
eft propre dans les langues dont les fyllabes reçoivent
des accents fenfiblement variés , telle qu’eft
la langue grèque; & c’eft ce qu’infinue le mot
condere , qui fignifie proprement arranger, d i f
pofer. Il ne s'enfuit nullement de là que Phérécyde
ait été le premier écrivain en Profe qu’ayent
eu les grecs; car Paufanias parle d'une hiftoire de
Corinthe écrite en Profe , & attribuée à un certain
Rumelus , que la Chronique d’Eusèbe place à la
onzième olympiade ou vers l’an,740 avant Jéfus-
Chrift, c’eft à dire, deux-cents ans avant Phérécyde
& le fiècle de Cyrus. I l en a prefque été de
même parmi toutes les autres nations. Dans les
monuments publics, les chroniques , les lo is , la
Philofophie même, les vers ont été en ufage avant
la Profe. Ainfî, parmi nous , il a été un temps
ou l'on ne croyoit pas que la Profe françoife méritât
d'être tranfmife à la poftérité : à peine avons-
nous un ou deux ouvrages de Profe antérieurs à
Villehardouin ’& à Joinville , tandis que nos bibliothèques
font eiîcore pleines de poèmes hifto-
riques , allégoriques , moraux , &c 9 co mpofés dans
des temps très-reculés. Mém. de V Ac. des Belles-
Lettres , tom. vi.
L a Motte & d'autres- ont^ fôutenu qu’il pourvoit
y avoir des poèmes en Profe ,* mais on leur
a répondu, comme il eft vrai, que 1$ Profe' 8c
la Poéfie ont eu de tous temps des cara&ères distingués;
que la traduction en Profe d’un poème
n’eft à ce poème que ce qu’une eftampe eft à un
tableau , elle en rend bien le deffin , mais elle n'en
exprime pas le coloris ; & c'eft ce que madame
Dacier elle-même penfoit de fa Traduction d’Ho-
mere. Le confenteraent unanime des nations apilie1
encore ce fentiment. Apulée & Lucien, quoique
tous deux fertiles en fictions & en ornements poétiques,
n'ont jamais été comptés parmi les poètes.
La fable de Pfyché aaroit été appelée Poème, s’i l
y avoit des poèmes en Profe. Le fonge de Scipion ,
quoique fiction très-noble, écrite en ftyle poétique,
ne fera jamais mettre le nom de Cicéron
parmi ceux des poètes latins; de même que, parmi
ceux de nos poètes françois , nous ne mettrons point
celui de Fénélon, D’ailleurs l ’Éloquence & la
Poeûe ont chacune leur harmonie, mais fi oppofées R
que ce qui embellit l'une défigure l'autre. Loreille
eft choquée de la mefure du vers, quand elle le
trouve dans la Profe ; & tout vers profaïque déplaît
dans la Poéfie. La Pro/è emploie à la vérité
les mêmes figures & les mêmes images que la
Poéfie ; mais le ftyle eft différent , & la cadence
eft toute contraire. Dans la Poéfie même, chaque
efpèce a fa cadence propre : autre, eft le ton
de l ’Épopée , autre eft celui 3e la Tragédie ;'le
genre lyrique n’eft ni épique ni dramatique , êç
P R O
des vei's : la Profe de fon Télémaque eft véritablem
ent p o é tiq u e , fans ceflcr d’être Profe. « O n
» dit que le fty le -eft p lu s concis en vers qu’en
» Proje ; 8c cela eft vrai jufqu'à un certain p o in t,
» dit l’abbé T ru b let. L a facilité d'écrire eft une
-» des caufes de la diffufion : o r* il eft plus facile
» d’écrire en Profe qu’en vers. C ependant le fty le
» des vers paroît p lus concis qu’il ne l'e ft en effet :
» les règles gênantes de la verfification font m ettre
» beaucoup d’in utilités ; & j'ôfe aflurer q u ’on a b rè -
» g ero it toujours un ouvrage en v e rs, en le ré-
» duifant en Profe. Si le ftyle des vers p a ro ît
» plus concis & plus laconique que celui de la
» Profe y Gela vient en grande partie de ce q u 'o r-
» dinairem ent il eft plus jcoupc ; auffi, a - t - o n
» trouvé diffus quelques-uns de nos p o ètes, qu i
» font un peu trop périodiques. E n g é n é ra l, le
» fty le coupé p aro ît toujours p lu s concis que le
» ftyle périodique & nombreux : mais ce n’eft fou-
» vent q u ’une fauffe apparence ; tém oin , parm i
» les anciens, le ftyle de S énèque,. & parm i les
» m odernes, celui de l ’abbédu G u e t» .) (M. B e a u -
ZÉE.)
P R O
ainfi des autres. Comment la Profe , dont la marche
eft uniforme, pourroit-elle ainfi diverfifier fes
accords ? La prétention de La Motte a eu le fort
des paradoxes mal fondés ; on en a montré le faux,
8c l ’on a continué à faire de beaux vers &àles admirer.
( A n o n y m e . )
( ^ Le nom P ro fe , que nous tenons immédiatement
du latin P ro fa , paroît avoir été , dans
cette langue , un adjeétif pris d’ordinaire fubftanti-
vement : mais on l ’y a quelquefois employé comme
adjeélif; Profa oratio fe trouve dans Varron , &
c’eft ce que Cicéron appelle oratio libéra nullif-
que numeris afiricîa. Mais d’où les latins avoient-
ils emprunté ce mot? I l paroît affez vraifembla-
ble qu’ils l ’avoient formé de l’adverbe grec 'arporw
( en avant ) ; parce que la Profe va , pour ainfi
dire toujours en avant , fans être obligée , comme
le vers, après avoir parcoùru une mefure déterminée,
de revenir en quelque forte fur fes pas pour
fe foumettte de nouveau à la même contrainte.
Auffi la Pfofe eft-elle , en fait d’élocution, l ’op-
pofé du vers. Le difcours eft fufceptible de deux
formes générales : dans l ’une , il eft affujéti à des
mefures réglées par la quantité ou par'la quotité
des fyllabes , & déterminées par. le nombre des
pieds ou par des rimes; dans l’autre, il n’eft af-
tieint qu’aux lois de la Grammaire , 8c à l ’efpece
d’harmonie qui réfui te de l ’afTortiment agréable des
voyelles & des Conformes , ou' de l’accord imitatif
des mots avec les idées & des périodes avec
lesafFeiftions.de l ’âme. De la première forme réfulte
le Vers ; de la fécondé , la Profe.
■ Ce n’eft donc point la Poéfie qui eft oppofée
à la Profe, comme i l femble quon l ’a toujours
entendu, & comme on le fuppofe en effet dans
ce qui précède. La *Profe eft à l ’Éloquence , ce
que les vers font à la Poéfie ; on peut écrire
bien en Profe fans être éloquent, & l ’on peut
poffédej parfaitement le méchanifme des vers fans
être poète : c’eft une maxime d’Horace ( I. Sat. jv.
38— 41 ), qui mérite bien d’en être cru.
Primum, ego me illorum dederim quïbus ejfe po'ètis
Excerpam numéro : neque enim concludere verfum
JDïXfiris ejfe Jatis ; neque, f i quis fcribat, uti nos,
Scrmoni propiora , putes hune ejfe pottanu
En effet combien ne voyons-nous pas de verfîfi-
rateurs qui font bien éloignés d’être poètes'; parce
quils nont ni le génie de l ’invention , ni l ’en-
thoufiafme de l.infpiration , ni la magnificence de
l ’expreffion, comme Horace l ’exige de ceux qui
prétendent au nom de poètes:
Ingenium cui J ît , cui mens divinior, atque os
Magna fonaturum, des nominis hujus hohsrem.
I l manquoit bien moins que cela à Fénélon pour
Être poete , il né lui manquoit que le méchanifme
P R O S O D I E , fi f. Grammaire. « P a r ce m o t
» Profodie, on entend la m anière de. prononcer
» chaque fyllâbe régulièrem ent , c’eft à d ire , fui*
» v ant ce qu’exige chaque fy llabe prife à p a rt &
» confédérée dans fes trois p ro p rié té s, qui font l’ac*
» c e n t, l ’afp iratio n , 8c là quantité ». [Prof, franc*
art. 1 §. I.) ■ v J J ÿ
J ’ai aéluellem ent fous les ieux un exem plaire'
de l ’ouvrage où p arle ainfî l ’abbé d’O liv e t & cet
exem plaire eft ap o ftillé de la m ain de D uclos
l ’hom m e de L ettres le p lu s p o li & le p lus com m
unicatif. I l obferve qu’il fa llo it dire chaque fyV
labe d’un mot, parce que chaque fyllabe prife:
à part 8c détachée des m ots n’a ni accent ni quantité
. R ien de p lu s fage que cette rem arque ; p e u t-
on dire en effet que le Ion a , p a r e x em p le , fo it
lo n g ou bref, grave ou a ig u , en foi & indépendam
m ent d’une deftination déterm inée ? C ’eft to u t
Am plem ent un fon q ui fuppofe iine certaine ouverture
de la bouche , & naturellem ent fufceptible
de te lle modification profodique que les befoinÿ
de l ’organe ou les différents ufages p o urro nt exiger
dans les diverfes occafions ; -ainfi, félon la rem arque
de l ’abbé d’O liv e t lui-m êm e , a eft lo n g quand
il fe prend^pour la prem ière le ttre de l ’a lp h a b e t,
un petit a y une panfe d'à; quand il eft prépo~
fitm n , i l eft b ref, je fuis à Paris, j'écris d
I M f o i donné â Paul. D uclos rem arque de
fon^côté , que , dans le p rem ier cas , a eft grave y
& qu’il eft aigu dans le fécond. C e tte diverfité
de m odifications, félon les occurrences, eft une
preuve allurée que ce fon n’en a aucune qui lu i foit
p ro p re.
S il éto it perm is de p ro p ofèr quelques doutes
apres la decifion de ces deux illuftres académiciens
, je demanderôis fi l ’afpiration eft- bien effec—