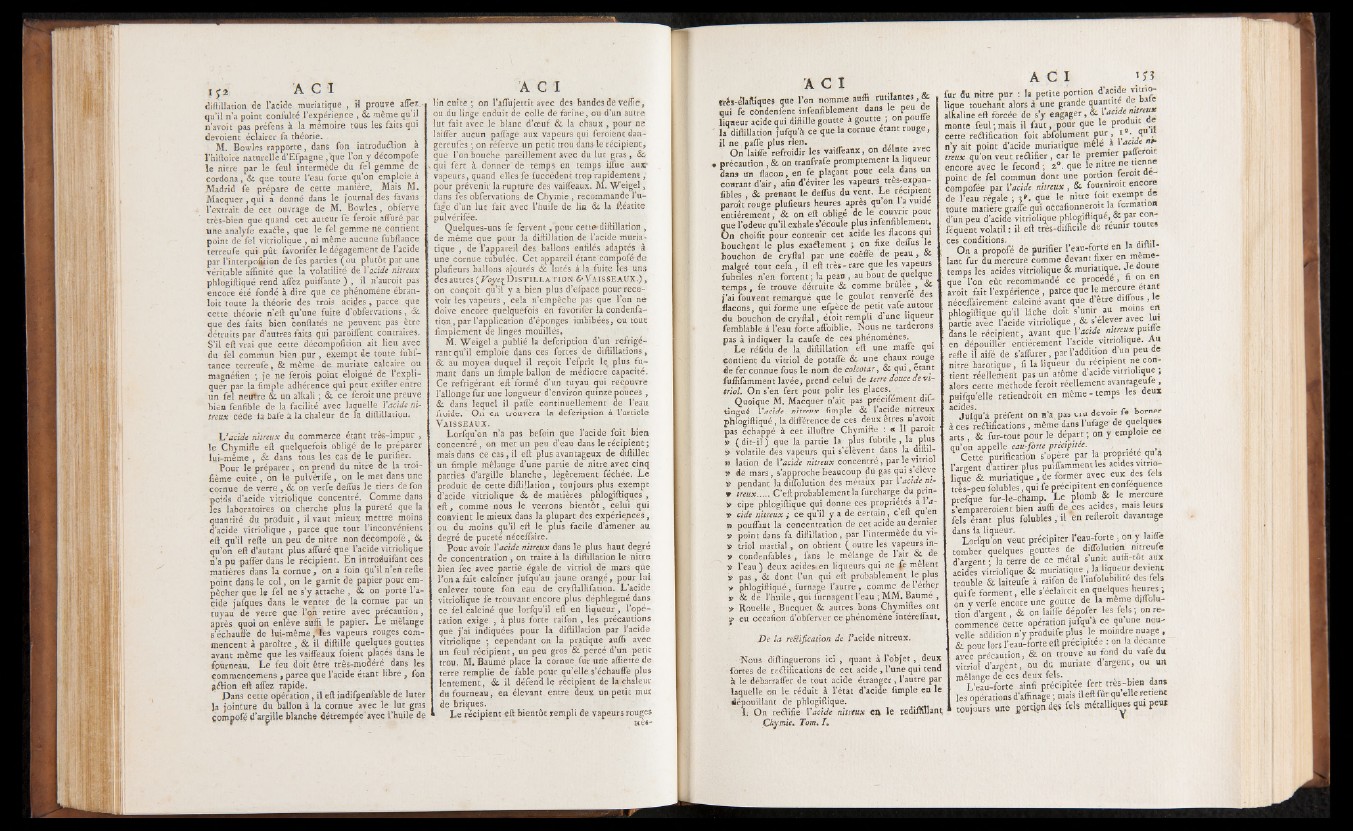
diftillation de l’acide muriatique , il prouve aflhz.
qu’il n’a point confulté l’expérience , & même qu’il
n’avoit pas préfens à la mémoire tous les faits qui
dévoient éclairer fa théorie. ^ ^
M. Bowles rapporte, dans fon introduction a
l’hiftoirë naturelle d’Efpagne ,*què l’on y décompofe
le nitre par le feul intermède du fel gemme de,
cordona, & que toute l’eau forte qu on emploie a
Madrid fe prépare de cette manière. Mais M.
Macquer, qui a donné dans le journal des favans
l ’extrait de cet ouvrage de M. Bowles, obferve
très-bien que quand cet auteur fe feroit alluré par
une analyfe exaéte, que le fel gemme ne contient
point de fel vitriolique , ni même aucune fubftance
terreufe qui pût favorifer le dégagement de 1 acide
par rinterpofîjtion de fes parties (ou plutôt par une
véritable affinité que la volatilité de 1 acide nitreux
phlogiftiqué rend allez puiffimte ) , il n’auroit pas
encore été fondé à dire que ce phénomène ébran-
loit toute la théorie des trois acides, parce , que
cette théorie n’eft qu’une fuite d’obfervations, de
que des faits bien conftatés ne peuvent pas être
détruits par d’autres faits qui paroilTent contraires.
S’il eft vrai que cette décompofition ait lieu avec
du fel commun bien .pur , exempt de toute fubftance
terreufe , & même de muriate calcaire ou
magnéfien ; je ne ferois point éloigné de l’expliquer
par la fimple adhérence qui peut exifter entre
un fel neUfre & un alkali ; & ce feroit une preuve
bien fenfible de la facilité avec laquelle Y acide nitreux
cède fa bafe à la chaleur de la diftillation,
Uacide nitreux du commerce étant très-impur ,
le Çhymifte eft quelquefois obligé de le préparer
lui-même , & dans tous les cas de le purifier.
Pour le préparer, on prend du nitre de la troi-
fième cuite , on le pulvérife , on le met dans une
cornue de verre , & on verfe deffus le tiers ce fon
poids d’acide vitriolique concentré. Comme dans
les laboratoires on cherche plus la purete que la
quantité du produit, il vaut mieux mettre moins
d’acide vitriolique , parce que tout l’inconvenient
eft qu’il refte un peu de nitre non décompofé , &.
qu’on eft d’autant plus affuré que l ’acide vitriolique
n’a pu paffer dans le récipient. En introduisant ces
matières dans la cornue , on a foin qu il n en refte
point dans le c o l, on le garnit de papier pour empêcher
que le fel ne s’y attache , 8c on porte l’acide
iüfques dans le ventre de la cornue par un
tuyau dé verre que l’on retire avec précaution,
après quoi on enlève aufti le papier. L e mélange
s’échauffe de lui-même ,^ïes vapeurs rouges commencent
à paroître, &. il diftille quelques gouttes
avant même que les vaiffeaux foient placés dans le
fpurneâu. Le feu doit être très-modéré dans les
commencemens , parce que l’acide étant libre , fon
{létion eft affez rapide.
Dans cette opération, il eft indifpenfable de luter
la jointure du ballon à la cornue avec le lut gras
çompofé d’argille bljuiche détrempée'avec l’huile de
lin cuite ; on l’affujettit avec des bandes de veffie,
ou .du linge enduit de colle de farine, ou d’un autre
lut fait avec le blanc d’oeuf & la chaux , pour ne
laiffer aucun paffage aux vapeurs qui feroient dan-
gereufes ; on réferve un petit trou dans-le récipient,
que l’on bouche pareillement avec du lut gras, &
qui fert à donner de temps en temps iffue aux“
vapeurs, quand elles fe {uccèdent trop rapidement,
pour prévenir la rupture des vaiffeaux. M. Weigel,
dans fes obfervations de Chymie , recommande l’u-
fage d’un lut fait avec l ’huile de lin &. la ftéatite
pulvérifée.
Quelques-uns fe fervent, pour cette diftillation ,
de même que pour la diftillation de l’acide muriatique
, de l’appareil des ballons enfilés adaptés à
une cornue tubulée. Cet appareil étant compofé de
plufieurs ballons ajoutés & lutés à la fuite les uns
des autres ( Voye{ Distillation & Vaisseaux.) ,
on conçoit qu’il y a bien plus d’efpace pour recevoir
les vapeurs , cela n’empêche pas que l’on né
doive encore quelquefois en favorifer la condenfa-
tion, par l’application d’éponges imbibées, ou tout
Simplement de linges mouillés,
M. Weigel a publié la defeription d’un réfrigérant
qu’il emploie dans ces fortes de diftillations,
& au moyen duquel il reçoit l’efprït lq plus fumant
dans un fimple ballon de médiocre capacité.
Ce réfrigérant eft formé d’un tuyau, qui recouvre
l’allonge fur une longueur d’environ quinze pouces ,
& dans lequel il paffe continuellement de l’eau
froide. On en trouvera la defeription à l’article
Vaisseaux.
Lorfqu’on n’a pas befoin que l’acide fait bien
concentré , on met un peu d’eau dans le récipient;
mais dans ce cas, il eft plus avantageux de diftiller
un fimple mélange d’une partie de nitre avec cinq
parties d’argille blanche, légèrement féchée. Le
produit de cette diftillation , toujours plus exempt
d’acide vitriolique & de matières phlogiftiques ,
e ft, comme nous le verrons bientôt, celui qui
convient le mieux dans la plupart des expériences,
ou du moins qu’il eft le plus facile d’amener au
degré de pureté néceffaire.
Pour avoir Yacide nitreux dans le plus haut degré
de concentration , on traite à la diftillation le nitre
! bien fec avec partie égale de vitriol de mars que
Ponafait calciner jufqu’au jaune orangé, pour lui
enlever toute fon eau de cryftallifatian. L ’acide
vitriolique fe trouvant encore plus déphlegmé dans
ce fel calciné que lorfqu’il eft en liqueur , l’opération
exige , à plus forte raifon , les précautions
que j’ai indiquées pour la diftillation par l’acide
vitriolique ; cependant on la pratique auffi avec
un feul récipient, un peu gros & percé d’un petit
trou. M, Baumé place la cornue fur une affiette de
terre remplie de fable pour quelle s’échauffe plus
lentement, & il défend le récipient de la chaleur
du fourneau, en élevant entre (jeux un petit muç
de briques.
■ Le récipient eft bientôt rempli de vapeurs rouges
ixè«-
ttés-élaftiques que l ’on -nomme auffi rutilantes, &
nui fe côndenfent infenfiblement dans le peu de
liqueur acide qui diftille goutte à goutte ; on poufle
' la diftillation jufqu’à ce que la cornue étant rouge,
il ne paffe plus rien. ' , ,, t
On laiffe refroidir les vaiffeanx, on delnte avec
. précaution , & on tranfvafe promptement la liqueur
dans un flacon, en fe plaçant pour cela dans un
courant d’air, afin d’éviter les vapeurs tres-expan
fibles , & prenant le deffus du vent. Le récipient
paraît rouge plufieurs heures après qu’on 1 a vuide
entièrement, & on eft obligé de le couvrir pour
que l’odeur qu’il exhale s’écoule plus infenublemenr. ;
On choilic pour contenir cet acide les flacons Çj11
bouchent le plus exactement ; on fixe deffus le
bouchon de cryftal par une coëffe de peau, oc >
malgré tout cela , il eft très-rare que les vapeurs
fubtiles n’en fortent; la peau , au bout de quelque (
temps, fe trouve détruite & comme brûlée , oc
j ’ai fourent remarqué que le goulot renverfé des
flacons, qui forme une efpèce de peut vafe autour
du bouchon de cryftal, étoit rempli d une liqueur
femblahle à l’eau forte affoiblie. Nous ne tarderons
pas à indiquer la caufe de ces phénomènes.
Le réfidu de la diftillation eft une malle qui
contient du vitriol de potaffe & une chaux rouge
de fer connue fous le nom de colcotar, & qui, étant
fuffifamment lavée, prend celui de terre douce de vitriol.
On s’en fert pour polir les glaces.
Quoique M. Macquer n’ait pas précisément distingué
Yacide nitreux fimple & 1 acide nitreux
phlogiftiqué , la différence de ces deux etres n avoit
pas échappé à cet illuftre Çhymifte : « Il paroit
y ( dit-il ) que la partie la plus fubtile , la plus
y volatile des vapeurs qui s’élèvent dans la diftil-
n lation de Y acide nitreux concentre, par le vitriol
y de mars, s’approche beaucoup pu gas qui s élève
y pendant la diffolution des métaux par 1 acide niw
treux.....C ’eft probablement la Surcharge du prmy
cipe phlogiftiqué qui donne ces propriétés à 1 a-
9 eide nitreux ; ce qu’il y a de certain, c eft qu en
» pouffant la concentration de cet acide au dernier
y point dans fa diftillation, par l ’intermede du yi-
v triol martial, on obtient f outre les vapeurs in-
y condenfables', fans le mélange de l’air &, de
v l’eau) deux acides»en liqueurs qui ne fe melent
y pas , & dont l’un qui eft probablement le plus
y phlogiftiqué, fumage l’autre , comme de 1 éther
y & de l’huile, qui furnagent l’eau ; MM. Baumé ,
y Rouelle, Bucquet & autres bons Chymiftes ont
y eu occasion d’obferver ce phénomène intéreffaat.
,De la rétification de /’acide nitreux.
Nous diftinguerons ici , quant à l’ob jet, deux
fortes de rectifications de cet acide, l’une qui tend
à le débarraffer de tout acide étranger, l ’autre par
laquelle on le réduit à l’état d’acide fimple en le
dépouillant de phlogiftiqué.
L On reétifie Y acide nitreux ea le rediftîîlant
Çhymie. Tom, /,
fur du nitre pur : U petite portion
lique touchant alors à une grande quantité de
alkaline eft forcée de s’y engager, & 1 acldtf lt[ ?
monte feul;mais il faut, pour que le produit^Qe
cette rectification foit abfolument p u r , | • <1 .
n’y ait point d’acide muriatique mele a 1 ac e n*
treux qu’on veut reCtifier , car le premier pa e 01
encore avec le fécond; a°. que le nitre ne tienn^
point de fel commun dont une portion îeroit e
compofée par Y acide nitreux , & fourniroit en^0.
de l’eau régale ; 3*. que le nitre (oit exempt d
toute matière graffe qui occafionneroit la formation
d’ûn peu d’acide vitriolique phlogiftiqué, & par con
fcquent volaçil : il eft très-difficile de reunir tou
ces conditions. . , x;a:î
On a propofé de purifier l ’eau-forte en la outillant
fur du mercure comme devant fixer enTmfm®
temps les acides vitriolique & muriatique. Je o
que l’on eût recommandé ce procédé, n on ^
avoit fait l’expérience , parce que le mercure e
néceffairement calciné avant que d etre dillous , ie
phlogiftiqué qu’il lâche doit s’unir au moins en
partie avec l’acide vitriolique , & s eleyer avec
dans le récipient, avant que Y acide n^relf x PU1
en dépouiller entièrement l ’acide vitriolique. AU
refte il aifé de s’affurer, par l’addition dun peu de
nitre barotique, fi la liqueur du récipient ne contient
réellement pas un atome d acide vitrio îqu ,
alors cette méthode feroit réellement avantageuie^
puifqu’elle retiendroit en même - temps les deux
aC Jufqu a préfent on a’a. pas cru devoir fe borner
à ces reaifications , même dans l’ufage de quelque«
arts , & fur-tout pour le départ ; on y emploie ce
qu’on appelle eau-forte précipitée. 3 ^ r r t .
Cette purification s’opère par la propriété qu 9,
l’argent d’attirer plus puiffammentles acides vitno-
lique & muriatique , de former avec eux des fels
très-peu folubles, qui fe précipitent en confequence
prefque fur-le-champ. Le plomb & le mercure
s'empareraient bien auffi dexes acides , mais leurs
fels étant plus folubles, il en refteroit davantage
dans la liqueur. - ,
Lorfqu’on veut précipiter 1 eau-forte I on y laifla
tomber quelques gouttes de diffolution nitreufe
d’argent ; la terre de ce métal s unit auffi-tôt aux
acides vitriolique & muriatique , la liqueur devient
trouble & laiteufe à raifon de 1 infolubilitc des fels
quife forment, elle s’éclaircit en quelques hem;es ;
Su y verfe encore une goutte de la meme d,ffolu-
tion d’argent, & on laiffe dépofer les fels; on recommence
cette opération jufqu a ce qu une nouvelle
addition n’y produife plus le moindre nuage ,
&, pour lors l’eau-forte eft précipitée : on la decante
avec précaution, & on trouve au fond du vafedu
vitriol d’argent, ou du muriate d’argent, ou un
mélange de ces deux fels. ,
L ’eau-forte ainfi précipitée fert très-bien dans
les opérations d’affinage; mais il eft fur qu elle retient
toujours une ^ortipn (tes tels métalliques qui peux