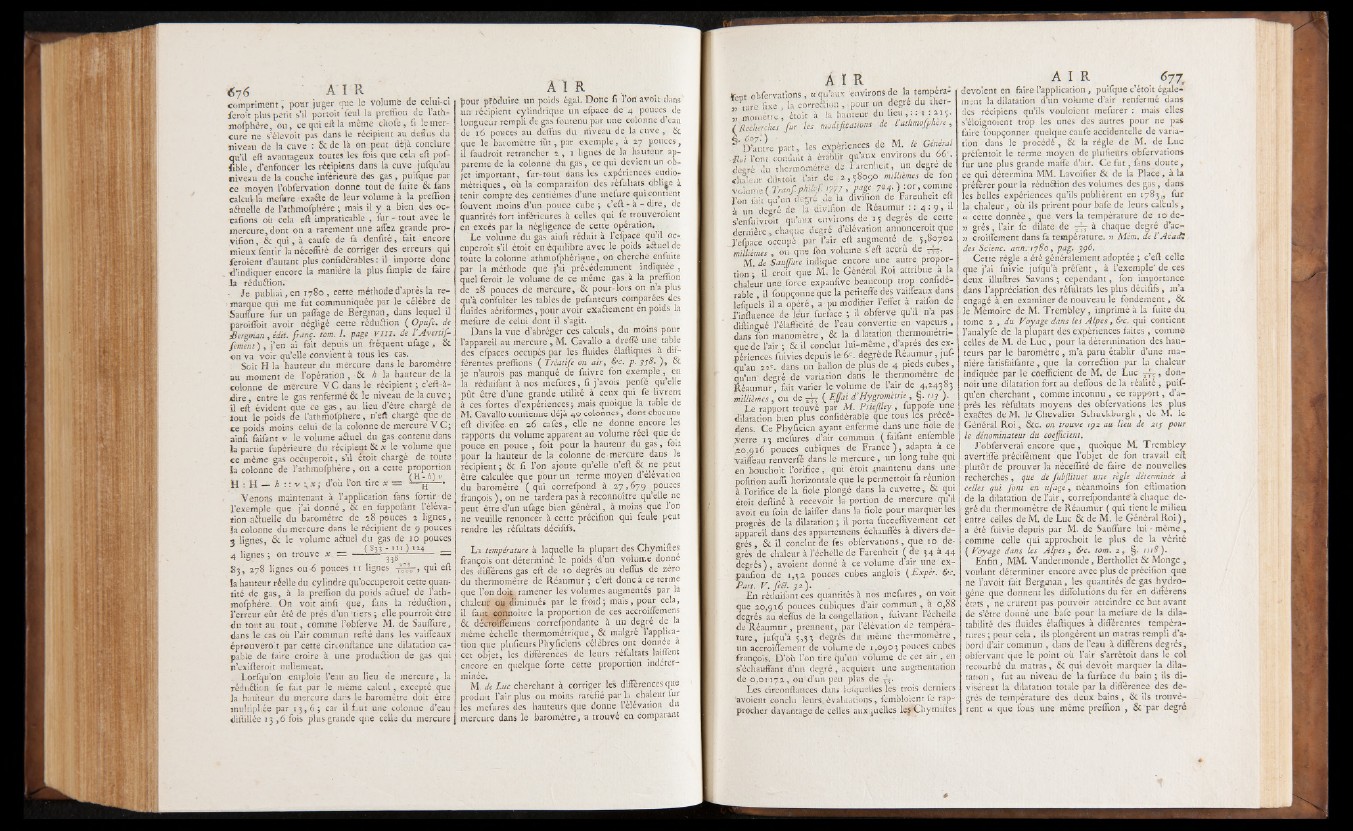
<6y6 A I R
compriment i pour , juger que le volum'e de celui-ci
feroit plus petit s’il portoit feul la preffion de l’ath-
mofphère, ou , ce qui eft la meme chofe , fi le mercure
ne s’élevoit pas dans le récipient au defiùs du
niveau de la cuve : 8c de là on .peut déjà conclure
qu’il eft avantageux tou tes les fois que cela eft pof-
fible, d’enfoncer les réeipiens dans la cuve jufqu’au
niveau de la couche inférieure des gas, puifque par
ce moyen l’obfervation donne tout de fuite 8c fans
calculla mef«re exaCte de leur volume à la preflion
aCtueîle de l’athmofphère ; mais il y a bien des oc-»-
caftons où cela eft impraticable , fur - tout avec le
mercure, dont on a rarement une affez grande pro-
vifton, & qui, à caufe de fa denftté, fait encore
mieux fentir la néceffité de corriger des erreurs qui
ieroient d’autant plus conftdérables : il importe donc
d ’indiquer encore la manière la plus fimple de faire
la réduction.
- Je publiai , en 1780 , cette méthode d’apres la remarque
qui me fut communiquée par le célébré de
Sauffure fur un paffage de Bergman, dans lequel il
paroiffoit avoir négligé cette rédu&ion ( Opufc. de
•Bergman , édit, franc, tom. 1. page V I II. de L Avertif—
fement) , j’en ai fait depuis un fréquent ufage, 8c
on va voir qu’elle convient a tous les cas. 8
Soit H la hauteur du mercure dans le baromètre
au moment de l’opération , & h la hauteur de la
colonne de mercure V C dans le récipient ; c’eft-à-
d ire, entre le gas renfermé & le niveau de la cuve ;
il eft évident que ce gas , au. lieu d’être chargé de
tout le poids de l’athmofphère, n’eft chargé que de
ce poids moins celui de la colonne de mercure V C ;
ainfi faifant v le volume aétuel du gas contenu dans
la partie fupérieure du récipient 8ç x le volume que
ce même gas occuperoit, s’il etoit chargé de toute
la colonne de l’athmofphère, on a cette proportion
» - 1, • (H-A) v
H : H — h :: v \ x ; dou Ion tire x = — H -■ »
Venons maintenant à l’applicatidn fans fortir de
l ’exemple que j’ai donné, & en fuppofant l’élévation
a&uelle du baromètre de 28 pouces 2 lignes,
la colonne du mercure dans le récipient de 9 pouces
a lignes, 8c le volume a&uel du gas de 10 pouces
° _ (833 - III ) 124 __
4 lignes ; on trouve x .■ = ------------------------ —
83, 2.78 lignes ou-6 pouces 11 lignes ,g07o80--> qui eft
la hauteur réelle du cylindre qu occuperoit cette quantité
de gas, à la preffion du poids actuel de l’ath-
mofphère. On voit ainfi que, fans la réduction,
l’erreur eût été de près d’un 'tiers ; elle pourroit être
du tout au tout, comme l’obferve M. de Sauffure,
dans le cas où l’air commun refté dans les vaiffeaux
éprouveront par cette circonitance une dilatation capable
de faire croire à une production de gas qui
n’exifteroit nullement.
Lorfqu’on emploie l’eau au lieu de mercure, la
réduction fe fait par le même calcul, excepté, que
la hauteur du mercure dans le baromètre doit être
multipliée par 1 3 , 6 ; car il faut une colonne d’eau
diftillée 13,6 fois plus grande que celle du mercure
A ï R
pour pPôduire un poids égal. Donc ft l’ôri avoit dans'
un récipient cylindrique un efpace de"4 pouces de
longueur rempli de gas foutenu par une colonne d’eau
de 16 pouces au- delTus du niveau ae la cuve , 8c
ue le baromètre fut, par exemple, à 27 pouces,
faudroit retrancher 2 , 1 lignes de la hauteur apparente
de la colonne du gas, ce qui devient un objet
important, fur-tout dans les expériences eudior
métriques, où la comparaifon des réfultats oblige à
tenir compte des centièmes d’une mefure qui contient
fouvent moins d’un pouce cube ; c’eft - à - dire , de
quantités fort inférieures à celles qui fe trouveroient
en excès par la négligence de cette operation.
Le volume du gas ainfi réduit à l’efpace qu’il occuperoit
s’il étoit en équilibre avec le poids aétuel de
toute la colonne athmofphérique, on cherche enfuite
par la méthode que j’ai précédemment indiquée ,
quel feroit le volume de ce même gas à la preffion
de 28 pouces de mercure, & pour-lors on n’a plus
qu’à confulter les tables de pefanteurs comparées des
fluides aériformes, pour avoir exactement en poids la
mefure de celui dont il s’agit.
Dans la vue d’abréger ces calculs, du moins pour
l’appareil au mercure , M. Cavallo a dreffé une table
des efpaces occupés par les fluides élaftiques à différentes
preffions ( Tréatîfe on air, &c. p. 358. ) , 8c
je n’aurois pas manqué de fuivre fon exemple , en
la réduifant à nos mefures, ft j’avois penfé qu’elle
pût être d’une grande, utilité à ceux qui fe livrent
à ces fortes d’expériences ; mais quoique la table de
M. Cavallo contienne déjà 40 colonnes, dont chacune
eft divifée. en 26 cafés, elle ne donne encore les
rapports du volume apparent au volume réel que de
pouce en pouce , foit pour la hauteur du gas,'foit
pour la hauteur de la colonne de. mercure dans le
récipient; 8c ft l’on ajoute qu’elle n’eft & ne peut
être calculée que pour un terme moyen d’elevatiOn
du baromètre ( qui correfpond à 2 7 ,6 79 pouces
françois ) , on ne tardera pas à reconnoître qu’elle ne
peut être d’un ufage bien général, a moins que 1 on
ne veuille renoncer à cette précifion qui feule peut
rendre les réfultats décififs.
La température à laquelle la plupart des Chymiftes
françois ont déterminé le poids d’un volume donne
des différens gas eft de 10 degrés au defliis de zéro
du thermomètre de Réaumur ; c’eft donc à ce terme
que l’on dqUL ramener les volumes augmentés par la
chaleuf ojf diminués' par le froid ; mais , pour cela,
il faut,* ccjnnoître la proportion de ces accroiffemens
& déctomeraens correfpondante à un degré de la
même échelle thermométrique, & malgré l’application
que plufieurs Phyficiens célèbres ont donnée a
cet objet, les différences de leurs réfultats laiffent
encore en quelque forte cette proportion indéterminée.
M. de Luc cherchant à corriger les différences que
produit l’air plus ou moins raréfié par la chaleur fur
les mefures des hauteurs que donne l’élévation du
mercure dans le baromètre, a trouvé en comparant
A I R
ïent obfervations, « qu’aux environs de la tempéra-
„ turc fixe , la correflion, pour un degré du iher-
„ roomètre, étoit à la hauteur du lieu , : : i : 1 1 ;.
{ 'Recherches fur les modifications de l athmofphere ,
^ D’autre part, les expériences de M. le General
.Roi l’ont conduit à établit cp’an* environs du 66 .
degré du thermomètre de Farenheit, un degre de
chaleur diktoit l’air de 2,58090 millièmes de Ion
volume ( frarfptiibfi r/77 , P“g‘ 7° f ) :or>
l’on fait qu’un degré de la divifion de Farenheit eft
à un degré de la divifion de Réaumur :: 4 : 9 ,
s’enfuivroit qu’aux environs de .15 degrés de cette
dernière , chaque degré d’élévation annonceroit que
J’efpace occupé par l’air eft augmenté de 5,80702
millièmes , ’ou que fon volume s’eft accru de ^
M. de Sauffure indique encore une autre proportion
; il croit que M. le Général Roi attribue a la
chaleur une force expanfive beaucoup trop confide-
rable , il foupçonneqüe la petiteffe des vaiffeaux dans
l.efquels il a opéré, a pu modifier l’effet à raifon de
l ’influence de leur fur face ; il obferve qu’il n’a pas
diftingué l’élafiicité. de l’eau convertie en vapeurs,
dans fon manomètre, & la d.latation thermometri-
qu.e de l’air ; & il conclut lui-même, d’après des expériences
fuivies depuis le 6e. degré de Réaumur, jufqu’au
22e. dans un ballon de plus de 4 pieds cubes,
qu’un' degré de variation dans le thermomètre de
Réaumur, fait varier le volume de l’air de 4,24383
millièmes , ou de ^ ( Ejfai d’Hygrométrie, §. 113 ).
Le rapport trouvé par M. Prieflley, fuppofe une
dilatation bien plus confidérable que tous les précédons.
Ce Phyficien ayant enfermé dans une fiole de
jOerre 13 mefures d’air commun ( faifant enfemble
20,916 pouces cubiques de France), adapta à ce
Vaiffeau renverfé dans le mercure , un long tube qui
en bouchoit l’orifice, qui étoit ^naintenu dans une
pofition auffi horizontale que le permettoit fa reunion
à l’orifice de la fiole plonge dans la cuvette, 8c qui
étoit deftiné à recevoir la portion de mercure qu’il
avoit eu foin de laiffer dans la fiole pour marquer les
progrès de la dilatation ; il porta fucceffivement cet
appareil dans des appartemens échauffés à divers degrés,
& il conclut de fes obfervations, que 10 degrés
de chaleur à l’échelle de Farenheit (d e 34 à 44
degrés) , avoient donné à ce volume dair une ex-
panfion de 1,32 pouces cubes anglois ( Exper. &c.
part. V. feEt. 32 ).
En réduifant ces quantités à nos mefures, on voit
que 20,916 pouces cubiques d’air commun, à 0,88
degrés ad deffus de la congeilation , fuivant l’échelle
de Réaumur, prennent, par l’élévation de température,
jufqu’à 5,33 degrés du même thermomètre,
un accroiffeinent de volume de 1,0903 pouces cubes
françois. D’où l’on tire qu’un volume de cet air , en
s’échauffant d’un degré , acquiert une augmentation
de 0,0 r i 72 , ou d’un peu plus de ^5.
Les circonftances dans lesquelles les trois derniers
'avoient .conclu leurs, évaluations, fembloient. fe rap-
A I R ^77^
dévoient en foire l’application, puifque c’étoit égale*
ment la dilatation d’un volume d’air renfermé dans
des réeipiens qu’ils vouloient mefurer : mais elles
s’éloignoient trop les unes des autres pour ne pas
foire foupçonner quelque caufe accidentelle de variation
dans le procédé, & la règle de M. de Luc
préfentoit le terme moyen de plufieurs obfervations
fur une plus grande maffe d’air. Ce fut, fans doute,
ce qui détermina MM. Lavoifier 8c de la Place, à la
préférer pour la réduâion des volumes des gas , dans
les belles expériences qu’ils publièrent en 17831, fur
la chaleur, où ils prirent pour bafe de leurs cal’culs ,
a cétte donnée, que vers la température de 10 de-
11 grés, l’air fe dilate de ^ à chaque degré d’ac-
» croiffement dans fa température. » Mém. de l ’Acadi
des Scienc. ann.-iy8o , pag. 396.
Cette règle a été généralement adoptée ; c’eft celle
que j’ai fuivie jufqu’à préfent, à l’exemple' de ces
deux illuftres Savans ; cependant, fon importance
dans l’appréciation des réfultats les plus décififs, m’a
engagé à en examiner de nouveau le fondement, &
le Mémoire de M. Trembley, imprimé à la fuite du.
' tome 2 y du. Voyage dans les A lpes, &c. qui contient
l’analyfe de la plupart des expériences faites , comme
celles de M. de Luc , pour la détermination des hauteurs
par le baromètre, m’a paru établir d’une manière
fatisfoifante, que la correction par la chaleur
indiquée par le coefficient de M. de Luc ^ , don-
noit une dilatation fort au deffous de la réalité , puif-
I qu’en cherchant, comme inconnu , ce rapport, d’après
les réfultats moyens des obfervations les plus
exactes de M. le Chevalier Schuckburgh , de M. le
Général R o i, &c. on trouve 192 au lieu de 213 pour
le dénominateur du coefficient.
J’obferverai encore que, quoique M, Trembley
avertifle précifément que l’objet de fon travail eft
plutôt de prouver la néceffité de foire de nouvelles
recherches, que de fubflituer une règle déterminée à
celles qui font en ufage, néanmoins fon eftimation
de la dilatation de l’air, correfpondante* à chaque degré
du thermomètre de Réaumur ( qui tient le milieu
entre celles de M. de Luc & de M. le Général Roi ) ,
a été fuivie depuis par M. de Sauffure lui - même ,
comme celle qui approchoit le plus de la vérité
( Voyage dans les Alpes, &c. tom. 2, §. m8 ).
Enfin, MM. Vandermonde, Berthollet & Monge ,
voulant déterminer encore avec plus de précifion que
ne l’avoit fait Bergman, les quantités de gas hydrogène
que donnent les diffolurions du fer en différens
états , ne crurent pas pouvoir atteindre ce but avant
de s’être donné une bafe pour la mefure de la dilatabilité
des fluides élaftiques à différentes températures
; pour cela, ils plongèrent un matras rempli d’abord
d’air commun , dans de l’eau à différens degrés,
obfervant que le point où l’air s’arrêtoit dans le col
recourbé du matras, & qui devoit marquer la dilatation
, fut au niveau de la furfoce du bain ; ils divisèrent
la dilatation totale par la différence des degrés
de température des deux bains, 8c ils trouvèrent
« que fous une même preffion , 8c par degré