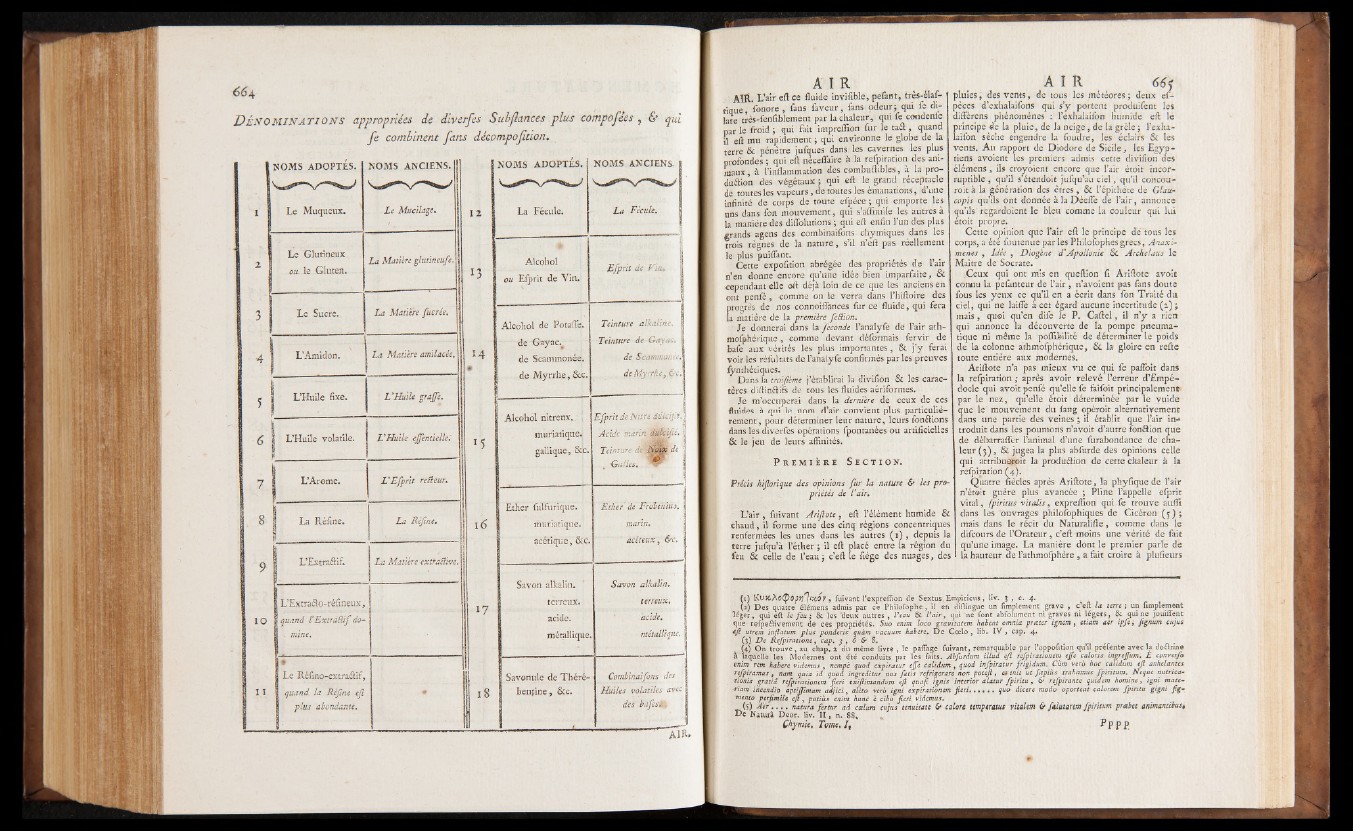
t\ 6 \
D é n o m i n a t i o n s appropriées de diverfes Subßatices plus compofées ? & qui
Je combinent fans décompoftion.
n o m s a d o p t é s .
Le Muqueux.
NOMS ANCIENS.
Le Mucilage• 1 2
NOMS ADOPTÉS.
La Fécule.
NOMS ANCIENS. J
La Fécule. 8
2
Le Glutineux
ou. le Gluten. .
La Matière glutineufe.
1 3
Alcohol
ou Efprit de Vin.
. ■ w m 1 Efprit de Vin• |
1
3 Le Sucre. La Matière fucrée.
Alcohol de Potaffe. Teinture alkaline, 1
•4 L’Amidon. La Matière amilacée. 1 4
de Gayac.#
de Scammonée.
Teinture de Gayac. |
de ScammonéeA
de Myrrhe} &c.
L’Huile fixe. VHuile grajfe.
î
! Efprit de Nitre dulcifié
Acide marin ftttlciju. jj
Teinture de- Noix de |
6 L’Huile volatile.
1
L ’Huile ejfentielle. muriatique.-
gallique, &c.
7
1
| L’Arôme. VEfprit reSleur.
. -Galles.
! s La Réfine.
]
La Réfine.
! 1 ^
Ether fulfurique.
muriatique,
acétique , &c.
Ether de Frobehius. j
marin.
1 | L’Extraâif. J La Matière extfaélive.
8 9 !
Savon alkalin.
terreux*
acide,
métallique
I 10
| L’Extraéfo-réfineux,
| quand l’Extrà&if do-
1 . mjne.
1 7
terreux,
acide. |
métallique. 1
1 Le Réfinô-extra&if, il Savonule de Théré- Combinaifons des
S 11 1 quand, la Réfine efi
I plus abondante.
18 benfine, &c. Huiles volatiles avec \
des hafesHk
A I R A îR. L’air eft ce fluide inviflble, pelant, très-elaf-
tique, fonore , fans faveur, fans odeur; qui fe dilate
très-fenfiblement par la chaleur, qui fe condenfe
par le froid ; qui fait impreflion fur le ta<ft , quand
il eft mu rapidement ; qui environne le globe de la
terre 8c pénètre jufques dans les cavernes les plus
profondes ; qui eft néceflaire à la refpiration des animaux,
à l’inflammation des combuftibles, à la production
des végétaux ; qui eft le grand réceptacle
de toutes les vapeurs, de toutes les émanations, d’une
infinité de corps de toute efpèce ; qui emporte les
uns dans fon mouvement, qui s’aflimiïe les autres à
la manière des diflolutions ; qui eft enfin l’un des plus
grands agens des combinaifons chymiques dans les
trois règnes de la nature, s’il n’eft pas réellement
le plus puiflant.
Cette expofition abrégée des propriétés de l’air
n’en donne encore qu’une idée bien imparfaite, &
cependant elle oft déjà loin de ce que les anciens en
ont penfé, comme on le verra dans l’hiftoire des
progrès, de nos connoiflances fur ce fluide, qui fera
la matière de la première feStion.
Je donnerai dans la fécondé Panalyfe de l’air ath-
mofphérique, comme devant déformais fervir de
bafe aux vérités les plus importantes, & j’y ferai
voir les réfultats de l’analyfe confirmés par les preuves
fynthétiques.
Dans la troifième j’établirai la divifiôn & les caractères
diftin&ifs de tous les fluides aériformes.
Je m’occuperai dans la dernière de ceux de ces
fluides à qui le nom d’air convient plus particulièrement,
pour déterminer leur nature, leurs fondions
dans les diverfes opérations fpontanées ou artificielles
& le jeu de leurs affinités.
P r e m i è r e S e c t i o n .
Précis hifiorique des opinions fur la nature & les propriétés
de T air.
L’a ir , fuivant Ariflote, eft l’élément humide &
chaud, il forme une des cinq régions concentriques
renfermées les unes dans les autres ( i ) , depuis la
terre jufqu’à l’éther ; il eft placé entre la région du
feu & celle de l’eau ; c’eft le fiège des nuages, des
A I R 661
pluies j des vents, de tous les météores ; deux ef-
pèces d’exhalaifons qui s’y portent produifent les
diflerens phénomènes : l’exhalaifon humide eft lé
principe de la pluie, de la neige, de la grêle ; l’exha-
laifon sèche engendre la foudre, les éclairs & les
vents. Au rapport de Diodore de Sicile, les Egyptiens
avoient les premiers admis cette divifion des
élémens, ils croyoient encore que l’air étoit incorruptible
, qu’il s’éteiidoit jufqu’au c iel, qu’il concourût
à la génération des êtres, & l’épithète de Glau-
copis qu’ils ont donnée à la Déefle de l’a ir, annonce
qu’ils regardoient le bleu comme la couleur qui lui
étoit propre.
Cette opinion que l’air eft le principe dé tous les
corps, a été foutenue par les Philofophes grecs, Anaxi-
menes , Idée , Diogène d’A polio nie 8c Archelaus le
Maître de Socrate.
.Ceux qui ont mis en queftion fi Ariftote avoit
connu la pefimteur de l’air , n’avoient pas fans doute
fous les yeux ee qu’il en a écrit dans fon Traité du
ciel, qui ne laifle à cet égard aucune incertitude (2.) ;
mais, quoi qu’en dife le P. Caftel, il n’y a rien
qui annonce la découverte de la pompe pneumatique
ni même la poffibilité de déterminer le poids
de la colonne athmofphérique, 8c la gloire en refte
toute entière aux modernes.
Ariftote n’a pas mieux vu ce qui fo pafloit dans
la refpiration ; après avoir relevé l’erreur d’Empé-
docle qui avoit penfé qu’elle fe faifoit principalement
par le nez, qu’elle étoit déterminée par le vuide
que le mouvement du fang opéroit alternativement
dans une partie des veines ; il établit que l?air introduit
dans les poumons n’a voit d’autre fonâion que
de débarrafler l’animal d’une furabondance de chaleur
(3 ), & jugea la plus abfurde des opinions celle
qui attribuor-oit la production de cette chaleur à la
refjriration (4).
Quatre fiècles après Ariftote, la phyfique de l’air
n’étoit guère plus avancée ; Pline l’appelle efprit
vital, fpiritus vitalis, expreflion qui fe trouve auflï
dans les ouvrages philosophiques de Cicéron (5) ;
mais dans le récit du Naturalifte, comme dans le
difeours de l’Orateur, c’eft moins une vérité de fait
qu’une image. La manière dont le premier parle de
la hauteur de l’athmofphère, a fait croire à plufteurs * 2 3 4
(1} K V iCÀ o (p op il<)ix,OV , fuivant l’expreflion de Sextus, Empiricus, liv. 3 , c. 4.
(2) Des quatre élémens admis par ce Philofophe, il eîï diftingue un {implement grave , c’eft la terre ; un {implement
léger, qui eft le f e u ; & les ’deux autres , l ’ eau & l ’ a ir , qui ne font abfolument ni graves ni légers, & qui ne jouiffent
que- refpeftivement de ces propriétés. Suo enim loco gravitatem habent omnia prater ignem, etiam aër ipfe ; fignum cujus
eft utrem infiatum plu s ponderis quàm vacuum habere. De Ccelo, lib. IV , cap. 4.
(3) - D e Refpiratione, cap. 3 , 6 & 8.
(4) On trouve, au chap. 2 du même livre , le paffage fuivant, remarquable par l’oppolition qu’il prefente avec la do&rine
à laquelle les Modernes ont été conduits par les faits. Abfurdum illu d eft refpirationem cjfe caloris ingreffum. E converfo
enim rem habere videmus , nempe quo à expiratur ejje ca lid um , quod infpiratur firigidum. Cum vero hoc calidum eft anhelantes
refpiramus, nam quia id quod ingreditur nos fa t is refrigerare non p o te ft, evenit ut fa p iu s trahamus fpiritum. Neque nutrica-
iio n is gratia refpirationem fieri exiftimandum eft quafi ignis interior alatur fp ir itu , & refpirante quidem homine , igni materiam
incendio aptijjimam a i j i c i , alito vero igni expirationem fieri............quo dicere modo oporteat calorem fp iritu gigni f ig -
mento perfimile e f t , potiùs enim hunt è cibo fieri videmus.
(s) A ë r . . . . natura fertur ad calum Cujus tenuitate & colore t imp crams vitalem & fiilutarem fpiritum prabet animanùbus,
Naturâ Deor. liv. I I , n. 88, *
Çhymie, Tome, /, P P p p