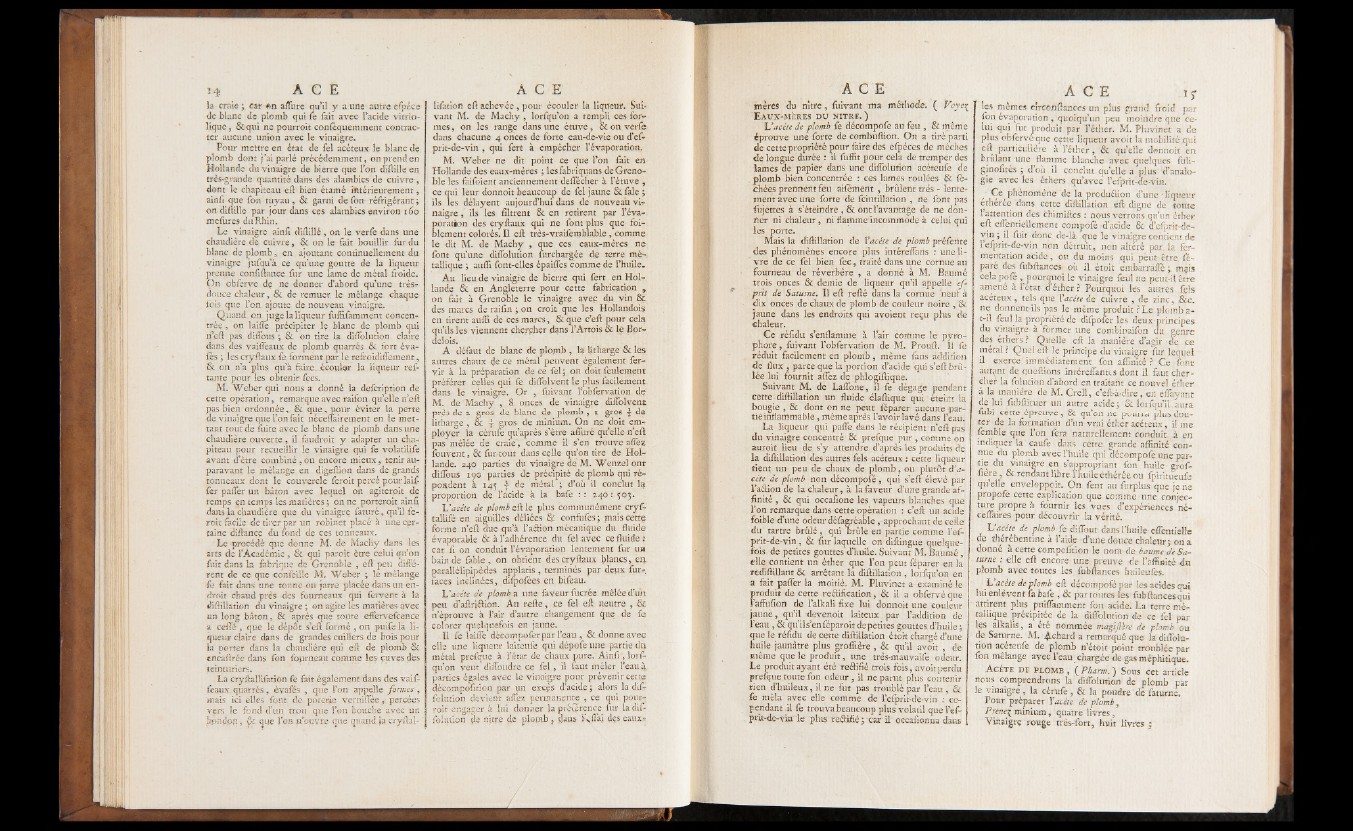
A C E
la craie; car «n affine qu’il y aune autreéfpèce
de blanc de plomb qui fe fait avec l’acide vitrio-
îique, & qui ne pourroit conféquemment contracter
aucune union avec le vinaigre.
Pour mettre en état de fel acéteux le blanc de
plomb dont j ’ai parlé précédemment, on prend en
Hollande du vinaigre de bierre que l’on diftille en
trèS'grande quantité dans des alambics de cuivre,
dont le chapiteau eft bien étamé intérieurement,
ainfi que fon tuyau, & garni de fon réfrigérant ;
on- (Mille par jour dans ces alambics environ 169
mefures du Rhin.
Le vinaigre ainfi difiillé, on le verfe dans une
chaudière de cuivre, & on le fait bouillir fur du
blanc de plomb, en ajoutant continuellement du
vinaigre jufqu’à ce qu’une goutte de la liqueur
prenne confiftance fur une lame de métal froide.
On obferve dç ne donner d’abord qu’une trèsr
douce chaleur, & de remuer le mélange chaque
ibis que l’on ajoute de nouveau vinaigre,
Quand on juge la liqueur fuffifamment concenr
tré e , on laiffe précipiter le blanc de plomb qui
ri’eft pas diflbus 5 & on tire la diflolution claire
dans des vaifleaux de plomb quarrés & fort éva-
fés ; les cryfiaux fe forment par le refroidiITement,
& on n’a plus qu’à faire, écouler la liqueur ref-
tante pour les obtenir fecs.
M. Weber qui nous a donné la defeription de
cette opération, remarque avec raifon qu’elle n’eft
pas bien ordonnée, & que, pour éviter la perte
de vinaigre que l’on fait nécefiairement en le mettant
tout de fuite avec le blanc de plomb dans une
chaudière ouverte, iLfaudroit y adapter un chapiteau
pour recueillir le vinaigre qui fe volatilife
avant d’être combiné, ou encore mieux, tenir auparavant
le mélange en digeftion dans de grands
tonneaux dont le couvercle feroit percé pour laif-
fer paflèr un bâton avec lequel on agiterpit de
temps en temps les matières ; on ne porteroit ainfi
dans la chaudière que du vinaigre faturé., qu’il feroit
facile de tirer par un robinet placé' à une cgiv
taine diftance du tond de ces tonneaux.
Le procédé que donne M. de Machy dans les
arts de l’Académie, & qui paroît être celui qu’on
fuit dans la fabrique de Grenoble , ëft peu différent
de ce que confeilie M. Weber •; le mélange
fe fait dans une tonne ou jarre placée dans un endroit
chaud près des fourneaux qui fervent à la
diftillation du vinaigre ; on agite les matières- avec
un long bâton, & après que toute effervefcence
a ceffé', que le dépôt s’eft formé , on puife la liqueur
claire dans de grandes cuillers de bois pour
la porter dans la chaudière qui efi de plomb &
cncafirée dans fon fourneau comme les çuves des
teinturiers.
La cryfiallifation fe fait également dans des vaif-
feaux quarrés, éyafés , que l’on appelle formes,
mais ici elles font de poterie verniffée, percées
vers le fond d’un trou que l’on bouche avec un
jbozidpri, & que l’on n’ouvre que quand ja cryftal-
A C E
lifation eft achevée, pour écouler là liqueur. Suivant
M. de M a ch y , lorfqu’on a rempli ces formes,
on les range dans une étuve, & on,verfe
dans chacune 4 onces de forte eau-de-vie ou d’ef-
prit-de-vin , qui fert à empêcher l’évaporation,
M. Weber ne dit point ce que l’on fait en
Hollande des eaux-mères ; les fabriquans de Greno->
ble les faifoient anciennement deffécher à l’étuve ,
ce qui lèur donnoit beaucoup de fel jaune & fale ;
ils les délayent aujourd’hui dans de nouveau vi?
naigre, ils les filtrent & en retirent par l’évaporation
des cryftaux qui ne font plus que foi-
blement colorés. Il eft très-vraifemblable, comme
le dit M. de Machy , que ces eaux-mères ne
font qu’une diflolution lurchargée de terre métallique
; aufli font-elles épaifles comme de l’huile.
Au lieu de vinaigre de bierre qui fert en . Hollande
& en Angleterre pour cette fabrication ,
on fait à Grenoble le vinaigre avec dp vin &
des marcs de raifin ;_on croit que les Hollandois
en tirent aufli de ces marcs, &que c’eft pour cela
qu’ils les viennent chercher dans l’Artois & le Bor-
delois.
A défaut de blanc de plomb , la lîtharge & les
autres chaux (Je ce métal peuvent également fer-
vir à la préparation de ce fel ; on doit feulement
préférer celles qui fe diflolvent le plus facilement
dans le vinaigre. Ôr , fuivant l’obfervation de
M. de'Machy , 8 onces de vinaigre diflolvent
près de 2 gros de blanc de plomb , 1 gros | de
litharge , & j gros de minium. On ne doit employer
la cérufe qu’après s’être affure qu’elle n’eft
pas mêlée de craié^ comme il s’en trouve affez
fouvent, & fur-tout dans celle quon tire de Hollande.
240 parties du vinaigre de M. Wenzel ont
diffous 190 parties de précipité de plomb qui répondent
à 145 j de métal ; d’où il conclut la
proportion de l’acide à la bafe : : 240: 503.
L ’acéte de plomb eft le plus communément cryf-
tallifé en aiguilles déliées & confufes ; mais cette
forme n’eft due qu’à l’aéfion mécanique du fluide
évaporable & à l’adhérence du fel avec ce fluide ?
car fi on conduit l’évaporation lentement fur un
bain de fable, on obtient des cryftaux b la n c s e n
parallélipipèdes applatis , terminés par deux fur?,
faces inclinées , difpofées en bifeau.
Vdcéte de plomba une faveur fiicrée mêlée d’un
peu d’aftri&ion. Au refte, .ce fel eft neutre , &
n’éprouve à l’air d’autre changement fjue de fe
colorer quelquefois en jaune.
Il fe laiffe décompofer par l’eau , & donne avec
elle une liqueur laiteufe qui dépofe une partie dti
métal prefque à l’état de chaux pure. A in fi, lorfqu’on
veut diffoudre ce fe l, il faut mêler l’eau à.
parties égales avec le vinaigre pour prévenir cette
décomposition par un excès d’acide ; alors la dif-
folntion devient allez permanente , ce qui pour-,
roit engager à lui donner la préférence fur la dif-
fohmon .de nitre de plomb ? $ans Kÿffaj des eaux-
A C E
mères du nitre, fuivant ma méthode. ( Voye% Eaux-mères du nitre.)
L ’acéte de plomb fe décompofe au feu , & même
éprouve une forte de combuftion. On a tiré parti
de cette propriété pour faire des efpèces de mèches
de longue durée : il fuffit pour cela de tremper des
lames de papier dans une diflolution acéteufe de
plomb bien concentrée : ces lames roulées & fé-
chées prennent feu aifêment , brûlent très - lentement
avec une forte de fcintillation , rte font pas
fujettes à s’éteindre , & ont l’avantage de ne donner
ni chaleur, ni flamme-incommode à celui qui
les porte.
Mais la diftillation de tacite de plomb préfente
des phénomènes encore plus intéreffans : une livre
de ce fel bien fec, traité dans une cornue au
fourneau de réverbère , a donné à M. Baumé
trois onces & demie de liqueur qu’il appelle e f
prit de Saturne. Il eft refté dans la cornue neuf à
dix onces de chaux de plomb de couleur noire , &
jaune dans les endroits qui avoient reçu plus de
chaleur.
Ge réfldu s’enflamme à l’air comme le pyro-
phore, fuivant l’obfervation de M. Prouft. Il fe
réduit facilement en plomb, même fans addition
de flux , parce que la portion d’acide qui s’eft brûlée
lui fournit affez de phlogiftiqne.
Suivant M. de Laffone, il-fe dégage pendant
cette diftillation un fluide élaftique qui éteint la
bougie , & dont on ne peut féparer aucune partie
inflammable , même après l’avoir lavé dans l’eau.
La liqueur qui paffe dans le récipient- n’eft pas
du vinaigre concentré & prefque pur , comme on
auroit lieu de s’y attendre d’après les produits de
la diftillation des autres fels acéteux : cette liqueur
tient un peu de chaux de plomb, ou plutôt à’a-
céte de plomb non décompofe , qui s’eft élevé par
l ’aétion de la chaleur, à la faveur d’une grande affinité
, & qui occafione les vapeurs blanches que
l’on remarque dans cette opération : c’eft un acide
foible d’une odeur défagréable , approchant de celle
du tartre brûlé, qui brûle en partie comme l’e-fi
prit-de-vin, & fur laquelle on diftingue quelquefois
de petites gouttes d’huile. Suivant M. Baumé,
elle contient un éther que l’on peut féparer en la
rediftillant & arrêtant la diftillation , lorfqu’on en
a fait paffer la moitié. M. Pluvinet a examiné le
produit de cette re&ification, & il a obfervé que
l’affufion de l’alkali fixe lui donnoit une couleur
jaune, qu’il devenoit laiteux par l’addition de
l’eau , & qu’il s’en féparoit de petites gouttes, d’huile ;
que le réfidu de cette diftillation étoit chargé d’une
huile jaunâtre plus grofïière, & qu’il avoit , de
même que le produit, une trés-mauvaife odeur.
Le produit ayant été re&ifié trois fois, avoit perdu
prefque toute fon odeur, il ne parut plus contenir
rien d’huileux, il ne fut pas troublé par l’eau , &
fe mêla avec elle comme de l’efpiit-dte-viri ; cependant,
il fe trouva beaucoup plus volatil que Tef-
prit-de-vin le plus re&ifié ; c a r il occàfionna dans
A C E
les mêmes cîrconftances un plus grand froid par
fon évaporation , quoiqu’un peu moindre que celui
qui fut produit par l’éther. M. Pluvinet a de
plus obferve que cette liqueur avoit la mobilité .qui
eft: particulière à l’éther, & qu’elle donnoit en
brûlant une flamme blanche avec quelques fuli-
ginofites ; d’où il conclut qu’elle a plus d’analogie
avec les éthers qu’avec l’efprit-de-vin.
Ce phénomène de la produéfion d’une 'liqueur
éthérée dans cette diftillation eft digne de toute
l’attention des chimiftes : nous verrons qu’un éther
eft effentiellement compofé d’acide & d’efprit-de-
vin ; il fuit donc de-là que le vinaigre contient de
1 efprit-de-vin non détruit, non altéré par. la fermentation
acide, ou du moins qui peut être, fié-
paré des fubftances où il étoit embarrâffé ; mais
cela pofé ,. pourquoi le vinaigre feul ne peut-il être
amené' à l’état-' d’éther ? Pourquoi les autres fels
aceteux, tels que Yacéte de cuivre , de zinc, &c.
ne donnent-ils pas le même produit ? Le plomba-
t-il feul la propriété de difpofer les deux principes
du vinaigre à former une combinaifon du genre
des éthers ? Quelle eft la manière d’agir • de ce
métal ? Quel eft le principe du vinaigre fur lequel
il exerce immédiatement fon affinité ? Ce font
autant de queftions intéreffantts dont il faut chercher
la folution d’abord en traitant ce nouvel éther
à la manière de M. Crell, c’eft-à<lire, eri èflayant
de lui fubftituer un autre acide; & lorfqu’i l .aura
fubi cette épreuve, & qu’on ne pourra plus douter
de la formation d’un vrai éther aeéteux, il me
fêmble que l’on fera naturellement conduit à en
indiquer la çaufe dans cette grande affinité connue
du plomb avec l’huile qui décompofe une partie
du vinaigre en s’appropriant fon huile grof-
fière, & rendant libre rhuileéthérée ou fpiritueufe
qu’elle enveloppoit. On fent au furplus que je ne
propofe cette explication que comme une conjecture
propre à fournir les vues d’expériences né-
cèffaires pour découvrir la vérité.
Vacéte de plomb fe diffout dans l’huile effentlelîe
de thérébentine à l’aide d’une douce chaleur; 011 a
donné à cette compofition le nom de baume de Saturne
: elle eft encore une preuve de l’affinité du
plomb avec toutes les fubftances huileufes.
Vacéte de plomb eft décompofe par les acides qui
lui enlèvent fa bafe , êc par toutes les fubftances qui
attirent plus puiffamment fon acide. La terre métallique
précipitée de la diflolution de ce fiel par
les alkalis, a été nommée magijîère de plomb on
de Saturne. M. ^chard a remarqué que la- diffolu-
tion aceteufe de plomb n’étoit point troublée par
fon mélange avec l’eau chargée de gas méphitique.
Acete DE PLOMB , ( Pharm. ) Sous cet article
nous comprendrons la diflolution de plomb par
le vinaigre, la cérufe, & la poudre ’ de faturne.
Pour préparer Yacéte de plomb,
Prene£ minium , quatre livres,
Vinaigre rouge très-fort, huit livres ;