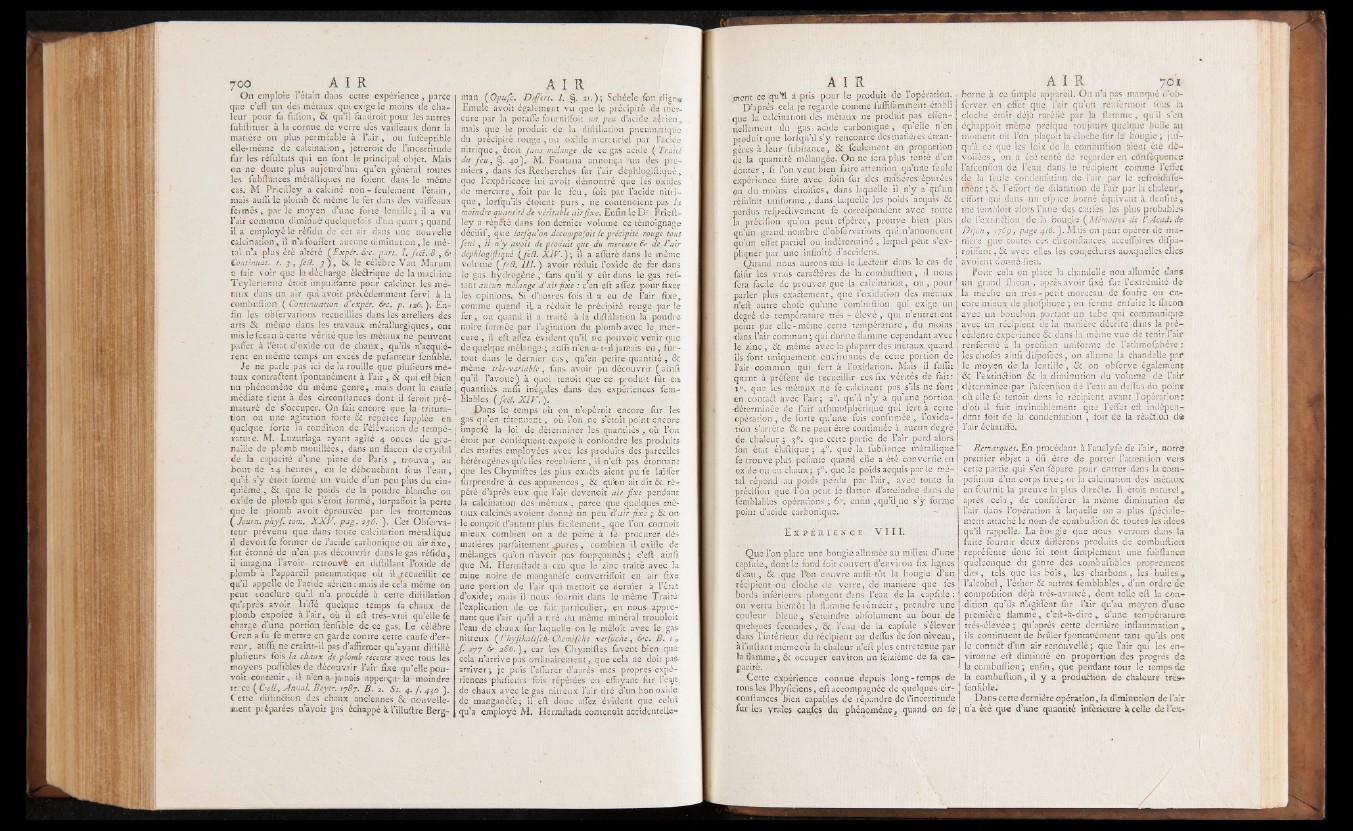
700 AI R On emploie l’étain dans cette expérience, parce
que c’eft un des métaux qui exige le moins de chaleur
pour fa fufton, & qu’il, fauclroit pour les autres
fubftituer à la cornue de verre dès vaifleaux dont la
matière ou plus perméable à l’air , ou fufceptible
elle-même de calcination, jetteroit de l’incertitude
fur les réfultats qui en font le principal objet. Mais
on ne doute plus aujourd’hui qu’ên général toutes
les fubftances métalliques ne foient dans le même
cas. M. Prieftley a calciné non - feulement l’étain,
mais aufli le plomb & même le fer dans des vaifleaux
fermés, par le moyen d’une .forte lentille; il a vu
l’air commun diminué quelquefois d’un quart ; quand
il a employé le réfidu de cet air dans une nouvelle
calcination, il n’afouffert aucune diminution , le métal
n’a plus été altéré (Expér. de. part. I. fe£l. 8 } &
Continuât, t. 3-, feél. 3 ) , & le célèbre Van Maruin
a fait voir que la décharge éleftriqùe de la machine
Teylerienne étoit impuiftànte pour calciner les métaux
dans un air qui a voit précédemment fervi à la
combuftion ( Continuation d’expér. &c. p. 126. ), Enfin
les observations recueillies dans les atteliers des
arts & même dans les travaux métallurgiques, ont
mis lefceau à cette vérité que les métaux ne peuvent
paffer à l’état d’pxide ou de chaux, qu’ils n’acquièrent
en même temps un excès de pefanteur fenfible.
Je ne parle.pas ici de la rouille que plusieurs métaux
contraélent fpontanément à l’air , & qui eft bien
un phénomène du même genre, „mais dont la caufe
médiate tient à des circonftances dont il feroit prématuré
de s’occuper. On fait encore que la trituration
ou une agitation forte .& répétée fupplée en
quelque forte la condition de l’élevât ion de température.
M. Luzuriaga ayant agité 4 onces de grenaille
de plomb mouillées, dans un flacon de cryflal
de la capacité d’une pinte de Paris , trouva , au
bout de 24 heures, en le débouchant fous l’eau,
qu’il s’y étoit formé un vuide d’un peu plus du cinquième
j & que le poids de la poudre blanche ou
oxide de plomb qui s’ét'oit formée furpafîbit la perte
que le plomb avoit éprouvée par les frottemens
( Journ. phyfi tom. XXV. pag. 256. ). Cet O b fer valeur
prévenu que dans toute calcination métallique
il devoit fe former de l’acide'carbonique ou air fixe,
fut étonné de n’en pas découvrir dans le gas réfidu-,
il imagina l’avoir- retrouvé en diflillant l’oxide de
plomb à l’appareil pneumatique oh il .recueillit ce
qu’il appelle de l’acide aérien : mais de cela même on
peut conclure qu’il n’a procédé à cette diftillation
qu’sprès avoir . laide quelque temps fa chaux, dé
plomb expofée à l’air, oyt il eft très-vrai qu’elle fe
charge d’une portion fenfible de ce gas. Le célèbre
Gren a fu fe mettre en garde contre cette caufe d’erreur,
aufli ne cratnt-il pas d’affirmer qu’ayant diftillé
plu fleurs fois la chaux de plomb récente avec tous les
moyens poffihles de découvrir l’air fixe qu’elle pouvoir
contenir , il n’ena-jamais apperçu- la moindre
trace ( Crell, Annal. Beytr. yj8y. B. 2.' St. 4. f . 430 ).
Cette diftin&ion des chaux anciennes & nouvellement
préparées n’âvoit pas échappé à l’illuftre Berg-
A I R
fiian ( Gpufc, Differt. 1. §. 21.); Schéeîe /pn Idigne
Emule avoit également vu que le précipité de mercure
par la potafle fourniifoit un.peu d’acide aerien,
mais que le produit de la difiillation pneumatique
du précipité rouge , ou oxide mercuriel par l’acide
nitrique, étoit fans mélange de ce gas acide ( Tracté
du feu , §. 40). M. Fontana annonça un des premiers
, dans fes Recherches fur l’air déphlogiftiqùé
que l’expérience lui avoit démontré que les oxides
de mercure, foit par le feu, foit par l’acide nitrique,
lorfqu’ils étoient purs, ne contenoient pas la
moindre quantité de véritable air fixe. Enfin le D r. Prieft-
ley a répété dans fon dernier volume ce témoignage
décifif, que lorfquon dècompofoit le précipité rouge tout
fe u l, il n'y avoit de produit que du mercure- & de l'air
déphlogifliqué (fett. XIV. ) ; il a afluré dans le même
volume ( fieél. 111. ) avoir réduit l’oxide de fer dans
le gas hydrogène, fans qu’il y eût dans le gas refilant
aucun mélange d'air fixe : c’en eft a fiez pour fixer
les opinions.. Si d’autres fois il a eu de l’air fixe,,
comme quand il, a réduit le précipité rouge par le
fe r , ou quand il a traité à la diftillation. la poudre
noire formée par l’agitation du plomb avec le mercure
, il efi aflez évident qu’il ne. pouvoit venir que
de quelque mélange ; aufli n’en a-t-il jamais, eu , fur-
tout dans le dernier cas, qu’en petite quantité , &.
même très-variable , fans avoir pu décou vrir ( a in fl
, qu’il l’avoue) à quoi 'tenoit que ce produit fût en
quantités aufli inégales dans des expériences fem-
• blables ( feél. X IV . ) , f
Dans le temps ou on n’opéroit encore fur les
gas qu’en tâtonnant, oh l’on ne s’étok point encore
j impofé la loi de déterminer les quantités ^ou l’on
j étoit par conféqiient expofé à confondre les produits-
dés ma fies employées avec les produits des parcelles
. hétérogènes qu’elles, receloient, il n’eft pas étonnant
I que les Chymiftes.lés plus exa&s aient pu. fe laifler
j furprendre à ces apparences , & qu’on ait dit & ré-
; pété d’après eux que l’air devenoit air fixe pendant
i la calcination des métaux , parce que quelques mé*
! taux calcinés avoient donné un peu cTair fixe 3. & on>
le conçoit d’autant plus facilement, que l’on connoît
mieux combien on a de peine à fe procurer dés
matières parfaitement .Bpar.es , combien iL exifle de.
mélanges qu’on n’avoît pas foupçonnés ; c’eft ainfi
I que M. Hermftadt a . cru que le zinc traité avec la.
mine noire de manganèfe convertiflbit en air fixe
une portion de l’air qui mettoit ce dernier à l’état,
d’oxide; mais il nous fournit dans le même Trainé
l’explication de: ce fait particulier,- en nous apprenant
que l’air qu’il a tiré du même minéral troublok
l’eau de chaux fur laquelle on le mêloît avec le gas
nitreux ( P hyfiika lifch- Ch cm fc h e verfuche , &c. B. /. ,
f 277 & 286. ) , car les Chymiftes fàvent bien que
cela n’arrive pas, ordinairement ^ que cela ne doit.pas
arriver; je puis Fa durer d’après mes propres expé-
■ riences plufleurs fois répétées en eflayant fur l’ea^it
■ de chaux avec le gas nitreux l’air tiré d’un bon oxide
de manganèfe; il eft donc aflez évident que celui
, qu’a employé M, Hermftadt contenait accidentelle-
A I R
jnent ce qu'il à pris pour le produit de l’opération,.
D ’après cela je regarde comme fuffifamtnent établi
que f|-calcination des métaux ne produit pas efîen-
tieHemeut du gas acide carbonique, qu’elle n’èn
produit que lorlqu’il s’y rencontre desmatières étrangères
à.leur fubftan.ee,, & feulement en proportion
de la quantité mélangée. On ne fera plus tenté d’en
douter , fl Fon veut bien faire attention qu’une feule
expérience faite avec foin fur des matières'épurées
ou du moins choifies, dans laquelle il. n’y a qu'un
réfultat uniforme , dans. laquelle les poids acquis &
perdus refpe&ivement fe correfpondent avec toute
la précifion qu’on peut efpérer , prouve bien plus I
qu’un grand nombre d’obfervations qui, n’annoncent |
qu’un effet partiel ou indéterminé, lequel peut s’expliquer
par une infinité d’accidens. j
Quand nous aurons mis le Leéteur dans le cas de !
faiflr lés vrais cara&ères de la, combuftion , il nous
fera facile de prouver que la calcination, o u , pour j
parler plus exa&ement, que l’oxidation des, métaux
n’eft autre chofe qu’une combuftion qui exige un j
degré de température très - élevé , qui n’enrretient ;
point par elle-même cette température, du moins r
dans l’air commun; qui donne flamme cependant avec j
le zinc , & même avec la plupart des métaux quand I
ils font uniquement environnés de cette portion de
l’air commun qui fert à Foxidation. Mais il fuffit j
quant à préfent de recueillir- ces fix vérités dé fait : !
i° . que les métaux ne fe calcinent pas s’ils ne font
en contacf avec l’air; -2.0. qu’il n’y a qu’une portion
-déterminée de l’air, athmofphérique qui fert à cette
opération , de forte qu’une fois confumée, l’oxida-
tion s’arrête & ne peut être continuée à aucun degré
de chaleur ; 30.' que cette partie de l’air perd alors j
fon état élaftique ; 40. que la fubftance métallique 1
fe trouve plus-pefante quand elle a été convertie en 1
oxide ou en chaux ; 5 0. que lç poids acquis par le métal
répond au poids perdu par l’air, avec toute la
précifion que Fpn peut fe flatter d’atteindre dans de
femblables opérations; 6°. enfin , qu’ilne s’y forme,
point d’acide carbonique.
E x p é r i e n c e V I I I .
Que Fon place une bougie allumée au milieu d’une
capfule, dont le fond foit couvert d’environ fix lignes
d’eau, & que l\)n couvre aufli-tôt la bougie d’un
récipient ou cloche cle verre,, de manière que fes
bords inférieurs plongent dans l’eau de la capfule :
on verra bientôt la flamme fe rétrécir , prendre une
couleur bleue, s’éteindre abfolumenr au bout'de
quelques fécondés, & l’eau de la capfule s’élever
dans l’intérieur du récipient au deflus de fon niveau,
à l’inftant mêmeoft la chaleur n’eft plus entretenue par
la flammé, & occuper environ un feizième de. fà capacité.
Cette expérience connue depuis long-temps de
tous les Phyfleiens, eft accompagnée de quelques cir-
conftances bien capables de répandre de Fincertitude
fur les vraies çaufes du phénomène, quand on fe'
AIR 701
borne à ce Ample appareil. Oïl n’a pas manqué cl’ob-
ferver en effet que l’air qu’on renfermok fous la
clociie étoit déjà raréfié par la flamme, qu’il s’en
éqhappoit même prefque toujours quelque huile au
moment oii l’on plaçoit la cloche fur H bougie; juf-
qu’à' ce que les l.oix de la combuftion aient été dévoilées,
on a été tenté de regarder en cônféquence
l’afcenflon de l’eau dans le récipient comme f effet
de la feule condenfation de l’air par le refroidifle-
mènt ; & l’effort de dilatation de l’air par la chaleur,
effort qui dans 1111 efpaçe borné équivaut à denfité 5
me femlftoit alors l’une des eau fes- les plus probables
de Fextinâion , de la bougie ( Mémoires de TAcad.de
Dijon, 1769, page 4(6- )■ Mais on peut opérer, de-manière
que toutes ces circonftaoces acceffoires difpa-
roiflent, ÉÉ avec elles les conjeftures auxquelles elles
avoient donné lieu.
Pour cela on place la chandelle non allumée dans
un grand flacon, après avoir fixé fur l’extrémité de
la mèche un très - petit morceau de foufre ou encore
mieux de phofphore ; on ferme enfuite le flacon
avec un bouchon portant un tube qui communique
avec un récipient de la manière décrite .dans la précédente
expérience & dans la même vue de tenir l’air
renfermé à la prefïion uniforme de Fathraofphère ;
lés chofes ainfi difpofées, on allume la chandelle par
le moyen de la lentille, & on obferye également
•& FextincHon & la diminution du volume de F air
déterminée par l’afcenfion de l’eau au deflus du point
oh elle fe tenoit dans le récipient avant l’opéra non:
d’ou il fuit invinciblement que _ l’effet eft indépendant
foit de la condenfation , foit de la. réaftion dê
Fair échauffé.
Remarques. En procédant à l’anaîyfe de Fair, notre
premier objet a dû être de porter l’attention vers
cette partie qui s’en, fépare pour entrer dans la com-
pofition d’un corps fixe.; or la calcination des métaux
en fournit la preuve la plus direéle. Il étoit naturel,
après cela de confidérer la même diminution de
l’air dans l’opération à laquelle on a plus fpéciale-
merit attaché le nom cle combuftion &. toutes les idées
'qu’il rappelle. La bougie que nous verrons dans la
fuite fournir deux différens produits de combuftion
repréfènte donc ici tout Amplement une fubftance
quelconque du genre des combuftibles proprement
dits, tels qiie les bois,, les charbons , les huiles ,
Falcohol, l’éther & autres femblables, d’un ordre de
compofltion déjà très-avancé y dont telle eft la condition
qu’ils n’agiflent fur Fair qu’au moyen- d’use
première flamme, c’eft-à-dire,. d’une température
très-élevée ;. qu’après cette dernière inflammation ,
ils continuent de brûler fpontanément tant qu’sis ont
le contaél d’ un air renouvelle; que Fair qui les environne
eft diminué en proportion des progrès de
la combuftion; enfin, que pendant tout le temps de
la combuftion., il y a production, de chaleur r très-
fenfible.-
Dans cette dernière opération, Ta diminution de Fair
i n’a été que d’une quantité inférieure h celle de Tes