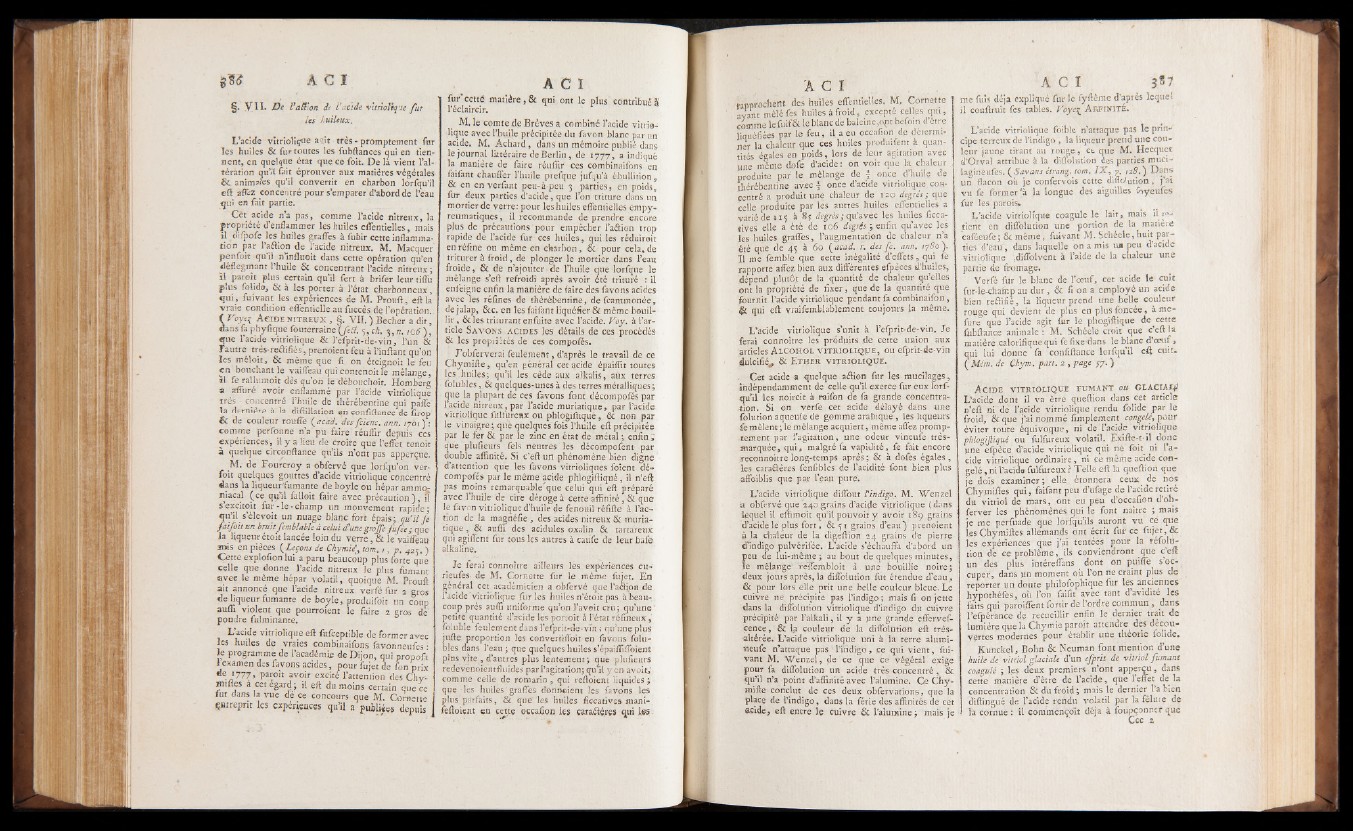
gs? A C I
§ . V I I . V e Vallon de Vacide vitriolique fur
les huileux.
L’acide vitrioliçue aeit très-promptement ftir
les huiles & fur toutes les fiibftances qui en tiennent,
en quelque état que ce foit. De là vient l’altération
qu’il fait éprouver aux matières végétales
& animales qu’il convertit en charbon lorfqu’il
eft aflêz concentré pour s’emparer d’abord de l’eau
qui en fait partie.
Cét acide na pas, comme l’acide nitreux, la
propriété d’enflammer les huiles effentielles, mais
il difpofe les huiles grades à fubir cette inflammation
par l’aflion de l’acide nitreux. M. Macquer
penfoit qu’il n’înfluoit dans cette opération qu’en
déflegmant l’huile & concentrant l’acide nitreux;
i l paroît plus certain qu’il fert à brifer leur tiflu
plus folide, & à les porter à l’état charbonneux,
q u i, fuivant les expériences de M. Prottft, eft la
vraie condition effentielle au fuecès de l’opération.
< Voyeq A c id e n i t r e u x , S. VII. ) Becher a dit,
flans fa phyfique fouterraine (/tf?. q,ch. y,n. 106),
que l’acide vitriolique & l’efprit-de-vin, l’un &
feutre tres-reâifies, prenoient feu à l’inflant qu’on
les mêloit, & même que fi on éteignoit le feu
en bouchant le vaiffeau qui contenoit le mélange,
il fe raîiumoit dès qu’on le débouchoit. Homberg
a afluré avoir enflammé par l’acide vitriolique
très - concentré l’huile de thérébentine qui paffe’
la derniere à la diftillation en confiflance de flrop
& de couleur roufle Çercad. des fcïenc. arm. 1761) :
comme perfonne na pu faire réulîir depuis ces
expériences , il y a lieu de croire que l’effet tenoit
a quelque circonflance qu’ils n’ont pas apperçue. :
M. de Fourcroy a obfervé que lorfqu’on ver-
foit quelques gouttes d’acide vitriolique concentré
dans la liqueur'fumante de boyle ou hépar ammtÿ
oiacal (ce qq’il falloit faire avec précaution), il
s’excitoit fur-le-champ un mouvement rapide;
qu’il s’élevoit un nuage blanc fort épais; qu’il Je
faifoitttn bruit femblable à celui dlune grojjefufée ; que
la liqueur étoit lancée loin du verre ,& le vaiffeau
mis en pièces (:Leçons de Chymie], tom. 1, p. 42 e. )
Cette explofton lui a paru beaucoup plus forte que
celle que donne l’acide nitreux le plus fumant
avec le même hépar volatil, quoique M. Proufl
ait annoncé que l’acide nitreux, verfé fur 2 gros
de liqueur fumante de boyle, produifoit un coup
auffi violent que pourroient le faire 2 gros de
pondre fulminante.
L acide vitriolique eft fufceptible de former avec
les huiles de vraies combinaifons favonneufes î
le programme de l’académie de Dijon, qui propofa
1 examen des favons acides, pour fujet de fon prix
fle 1777, paroît avoir excité l’attention des Chy-
miftes à cet egard; il eft du moins certain que ce
fut dans la vue dé ce concours que M. Cornette
ÇHtreprit les expériences qu’il a publiées depuis
A C I
fur"cetté matière,& qui ont le plus contribué5
l’éclaircir.
M. le comte de Brèves a combiné l’acide vitri©-
•lique avec l’huile précipitée du favon blanc par un
acide. M. Achard, dans un mémoire publié dans
le journal littéraire de Berlin, de 17 77, a indiqué
la manière de faire réulîir ces combinaifons en
faifant chauffer l’huile prefque jufqu’à ébullition,
& en en verfant peu-à-peu 3 parties, en poids,
fur deux parties d’acide, que Ton triture dans un
mortier de verre: pour les huiles elfentielles empy-
reumatiques, il recommande de prendre encore
plus de précautions pour empêcher l’a&ion trop
rapide de l’acide fur ces huiles, qui.les réduirait
en réline ou même en charbon, & pour cela, de
triturer à froid, de plonger le mortier dans Feau
froide, & de n’ajouter de l’huile que lorfque le
mélange s’eft refroidi après avoir été trituré : il
enfeigne enfin la manière de faire des favons acides
avec les rélines de thérébentine »■ de feammonée,
de jalap, &c. en les faifant liquéfier & même bouillir
, & les triturant enfuite avec l’acide. Voy. à l’article
S a v o n s a c id e s les détails de ces procédés
& les propriétés de ces compofés.
J’obferverai feulement, d’après le travail de ce
Chymifte, qu’en général cet acide épailfit toutes
les huiles; qu’il les cède aux alkalis, aux terres
folubles,.& quelques-unes à des terres métalliques;
que la plupart de ces favons font décompofés par
l’acide nitreux, par l’acide muriatique, par l’acide
vitriolique fulfureax ou phlogiftiqué, & non par
le vinaigre; quë quelques fois l’huile eft précipitée
par le fer & par le zinc en état de métal ; enfin ï
que plufieurs fels neutres les décompofent par
double affinité. Si c’eft un phénomène bien digne
d’attention que. les favons vîtrioliques foient décompofés
par le même acide phlogiftiqué, il n’eft
pas moins remarquable que celui qui eft préparé
avec l’huile de cire déroge à cette affinité, & que
le favon vittiolique d’huile de fenouil réfifte à, Faction
de la magnéfie, des acides nitreux & muriatique
, & auffi des acidulés oxalin & tartarewx
qui agiffent fur tous les autres à caufe de leur bafe
alkaline.
Je ferai connoître ailleurs les expériences cu-
rieufes- de M. Cornette fur le même fujet. En
général cet académicien a obfervé que l’aclion de
l’acide vitriolique fur les huiles n’étoit pas à beaucoup
près auffi uniforme qu’on l’avoit cru; qu’une '
petitè. quantité d’acide les portoit à l’état réfineux,
foluble feulement dans l’efprit-de-vin ; qu’une plus
jufte proportion les converfciffoit en favons folu-
bles dans l’eau ; que quelques huiles s’épaiffiftoient
plus vite , d’autres plus lentement; que plufieurs
redevenoient fluides par l’agitation; qu’il y en avoir,*
comme celle de romarin , qui reftoient liquides ;
que les huiles grades donneient les favons les
plus parfaits, & que les huilés ficcatives mani-
feftoient en cette occafion les cara&èjes qui les -
à c 1
rapprochent des huiles effentielles. M, Cornette
avant mêlé fes huiles à froid, excepté celles qui,
comme lefuif& le blanc dé baleine,opt befoin d’être
liquéfiées par le feu, il a eu occafion de déterminer
la chaleur que ces huiles produifent à quantités
égales en poids, lors de leur agitation avec
une même dofe d’acide: on voit que la chaleur ,
produite par le mélange de | once d’huilç de
thérébentine avec f once d’acide vitriolique concentré
a produit une chaleur de 120 degrés; que
celle produite par les autres huiles effentielles a
varié de 115 à 85 degrés ; qu’avec les huiles ficcatives
elle a été de 106 degrés', enfin qu’avec les
les huiles graffes, l’augmentation de chaleur n’a
été que de 45 à 6b {acad. r. des fc . arm. 1780).
I l me femble que eette inégalité d’effets, qui fe
rapporte affez bien aux différentes efpèces d’huiles,
dépend plutôt de la quantité de chaleiir qu’elles
ont la propriété de fixer, que de la quantité que
fournit l’acide yitrioÜque pendant fa combinaifon,
$ qui eft vraifemblablement toujours la même.
L’acide vitriolique s’unit à l’efprit-de-vin. Je
ferai connoître les produits de eette union aux
articles A l c o h o l v i t r i o l i q u e , ou efprit-de-vin
dulcifié^ & E t h e r v i t r i o l i q u e .
Cet acide a quelque aftion fur les mucilages,
indépendamment de celle qu’il exerce fur eux lorfqu’il
les noircit à raifon de fa grande concentration.
Si on verfe cet acide délayé dans une
folution aqueufe de gomme arabique , les liqueurs
fe mêlent; le mélange acquiert, même affez promptement
par l’agitation, une odeur vineufe très-
marquée, qui, m,algr.é fa vapidité, fe fait encore
reconnoitre long-temps après; & à dofes égales ,
les caradères fenfibles de l’acidité font bien plus
-affaiblis que par l’eau pure'.
L’acide vitriolique diffout Vindigo. M. Wenzel
a obfervé que 2.40grains d’aciçje vitriolique (dans
lequel il eftimoit qu’il pouvoit y avoir 189 grains
d’acide le plus fort, & 51 grains d’eau") prenoient
à la chaleur de la digeftion 2.4 grains de pierre
d’indigo pulvérifée. L’acide s’échauffa d’abord un
peu de lui-même; au bout de quelques minutes,
le mélange1 réffembiôit à une bouillie noire ;
deux jours après, la diffolution fut étendue d’eau ,
& pour lors elle prit une belle couleur bleue. Le
cuivre ne précipite pas l’indigo ; mais fi on jette
dans la diffolution vitriolique d’indigo du cuivre
précipité par l’alkali, il y a une grande effer.vef-
çence, & la couleur de la diffolution eft très-
■ skérée. L’acide vitriolique uni à la terre alumi-
îieufe n’attaque pas 1 l’indigo, ,ce qui vient, fuivant
M. Wenzel, de ce que ce végétal exige
pour fa diffolution un acide très concentré, &
qu’il n’a point d’affinité avec l’alumine. Ce Chy-
mifte conclut de ces deux obfervations, que la
place de l’indigo, dans la férié des affinités de cet
aeide, eft entre le cuivre & l'alumine; mais je
A C I 3*7
me fuis déjà expliqué fur le fyftême d’apres lequel
il conftruit fes tables. Voye£ A kfinité.
L’acide vitriolique foible n’attaque pas le principe
terreux de l’indigo, la liqueur prend une couleur
jaune tirant au rouge, ce que M. Hecquet
d’Orval attribue à la diffolution des parties muci-
lagineufes. ( Savans étrang. tom.. IX , p. 128.} Dans
un flacon où je confervois cette diflo'.ution , j’ai
vu fe former 'à la longue des aiguilles îoyeufes
fur les parois^.
L’acide vitriolique coagule le lait, mais il re-*
tient en diffolution une portion de la matière
caféeufe; & même, fuivant M. Schéele, huit parties
d’eau , dans laquelle on a mis ua peu d acide
vitriolique .diffolvent à l’aide de la chaleur une
partie de fromage.
Yerfé fur le blanc de l’oeuf, cet acide le cuit
fur-le-cha'mp au dur, & fi on a employé un acide
bien reftifié , la liqueur prend une belle couleur
rouge qui devient de plus en plus foncee, à me-
fure que l’acide agit £ur le phogiftique de cette
fubftance animale: M. Schéele croit que c eft la
matière calorifique qui fe fixe-dans le blanc d’oeuf»
qui lui donne fa confiftançe lorfqu’il eft cuit.
(Mérti. de Chym. part. 2 , page 77. S)
A c id e vitr io liq ue f u m a n t ou glacial^
L’acide dont il va être queftion dans cet article
n’eft pi de l’acide vitriolique rendu folide par le
froid, & que j’ai nommé fimplement congelé, pour
éviter toute équivoque, ni de l’acide vitriolique
phlogiftiqué ou fulfiireux volatil. Exifte-t-il donc
une efpèce d’acide vitriolique qui ne foit^ ni 1 a-
cide vitriolique ordinaire, ni ce même acide congelé
, ni l’acida fulfureux ? Telle eft la queftion que
je dois examiner; elle étonnera ceux de nos
Çhy.miftes qui, faifant peu d’ufage de l’acide retire
dp vitriol de mars, ont eu peu d’occafion d’ob-
ferver les phénomènes qui le font naître ; mais
je me perfuade que lorfqu’ils auront vu ce que
les Chymiftes allemands ont écrit fur ce fujet, &
les expériences que j’ai tentéés pour la refolu-
tion de ce problème, ils conviendront que c’eft
un des plus intéreffans dont on puiffe s oc-
cuper, dans un moment ou l’on ne craint plus de
reporter un doute philofophique fur les anciennes
hypothèfes, où l’on faifit avec tant d’avidité les
faits qui paroiffent fortir de l’ordre commun , dans
lefpérance de recueillir enfin le dernier trait de
lumière que la Chymie paroît attendre^ des découvertes
modernes pour établir une théorie folide.
Kamckel, Bohn & Neuman font mention d’une
huile de vitriol glaciale d’un efprit de vitriol fumant
coagulé ; les deux premiers n’ont apperçu, dans
cette manière d’être de l’acide, que 1 effet de la
concentration & du froid ; mais le dernier l’a bien
diftingué de l’acide rendu volatil par la fêlure de
la cornue : il commençoit déjà à îoupçonner que
Ccc z