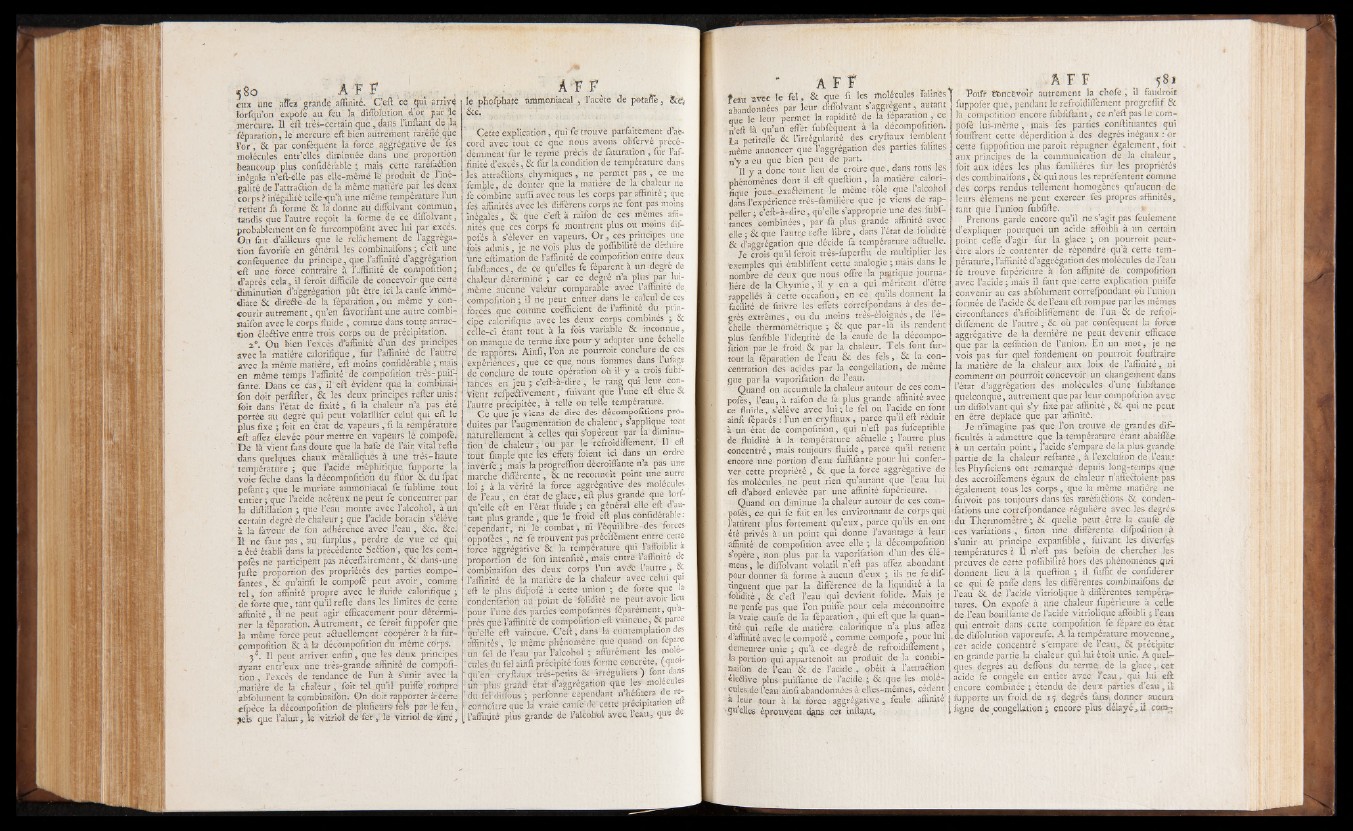
,8o A F F eux une a fiez grande .affinité. C ’eft ce fjiu arriva
lorsqu’on expofe au feu la. diffolution dor par le
mercure. Il eft très-certain que , dans l’inftant dé la
Réparation, le' mercure eft bien autrement raréfié que
l ’o r , & par conféquent la force. aggrègàtive de fos
molécules entr’elles diminuée dans une' proportion
beaucoup plus conltdérable ; mais cette raréfaction
inégale n’eft-élle pas ëîle-mêiné le produit’ 'dp l’inç-
, galité de l’attraélion- de la même matière par les deux
corps i mégalité telle-qu'à une même température l’un
retient fa.forme & la donne ali diffolvant commun,
tandis que l’autre reçoit la forme de Ce diffolvant,
probablement en fe furcompofant avec lui par excès.
On fait d’ailleurs que le relâchement de l’aggréga-
tion fevorife en général les combinaifons ; ç’eil une
tonféquence du principe, que l’aifinitè d’aggrégation
eft une force’ contraire à l’affinité de compoiition;
d’après cela, il ferOit difficile dé concevoir que cette
diminution d’aggtêgation put être ici la caufe immédiate
& cErêfte -de la réparation , ’ou même y concourir
autrement, qu’en fàvorifant imè autre cofflbi-
naifon avec le corps fluide, comme dans toute attraction
éleétivè entre trois corps ou de précipitation.
i° . Ou bien l’excès d’affinité d’un des principes
avec la matière calorifique, fur l’affinité de l’autrej
avec la même matière, eft moins çonfidérablé ; mais
en même temps l’affinité de compofition très-puif-
fante. Dans ce cas7 il'eft évident que la combinai-;
fon doit perfifter, & les deux principes reftfer unis t
foit dans l’état de fixité, fi la chaleur n’a pas été
portée au degré qui peut volatilïfer celui qui eft le'
plus fixe ; foit en état de vapeurs, fi la température
eft allez élevée pour mettre en vapeurs lé compofé.
De là vient fans doute que la bafe de l’ait vital refie
dans quelques chaux métalliques à une très-haute
température ; que l’acide1 méphitique, fupporté ; la
voie fèche dans la déeompofition du fluor & dii fpat
pefant ; que le muriate ammoniacal fe. fublime .tout
entier; que l’acide acéteux ne peut fe concentrer par.
la diftillation ; que l’eau monte avec l’alcohol1, à un
certain degré de 'chaleur ; que l’acide boracin s’élève
à la faveur de fon adhérence 'avec-, 'l’eàii , Sec. &cl
Il ne finit pas, au furpltis, perdre. de vufe ce ijuil
a été établi dans ia'précédente Se'flion', que les coin-:
pofés ne participent pas néceffairemènt, dans-une
Julie proportion des propriétés des parties compo-'
fentes , & qu’ainfi le compofé peut avoir, comme,
t e l , fon affinité propre avec le fluide calorifique ;
de forte que, tant qu’il refte dans'les .limites de cette
affinité, il' ne peut agir efficacement pour déterminer
la fêparation. Autrement , ce feroit fuppofer que
la même force peut aéluèllement coopérer à la fur-
compofition 8c à la déeompofition du même corps.
3*. Il peut arriver enfin, que les deux principes
ayant entr’eux une très-grande affinité de compofition
, l’excès de tendance de l’un à s’unir avec; la
.matière de la chaleur, foit tel qu’il puiffe'rompre?
abfolument la combiriaifon. On doit rapporter à cette
efpèce la déeompofition ,<ïe plufieùrs-fols par le fort,.
*els que l’alun, k vitriol de fer 7 le vitriol de fitiér
À F F le phosphaté ammoniacal l’acète de pôtalfe, &ë)
'6cc.
Çàtte'explication, qui fe trouvé parfaitement d’afe-
cord avec tout ce que nous avons ôbferve précédemment'fur
le terme précis de fàturatlon , fur Faf-
•finité d’excès1 Bc fur la condition de température dans
les attrapions' chymiques, ne permet pas , ce me
Temble, de. douter que la matière de la chaleur ne
fe combine àiiffiavec tous les corps par affinité; que
fos affinités aVec lés différons corps ne font pas moins
'inégalés, & que C’eft à raifon de ces mêmes affinités
que ces corps fe montrent plus ou moins dif-
pofés à s’élever en vapeurs. O r , ces principes une
fois admis, je ne vois plus de poffibilité de déduire
une eftimatioii de l’affinité de compofition entre deux
fubftances;, de ce qu’elles fe féparent à un degré de
chalèur déterminé ; car ce degré n’a plus par lui-
même aucune valeur comparable avec 1 affinité de,
compofition ; il ne peut entrer dans le calcul de ces
forces que comme coefficient dé l’affinité du principe
calorifique avec les deux corps combines ; &
celle-ci étant tout à la fois variable & inconnue,
ori manque de terme fixe pour y adapter une échelle
de rappbrtsi Ainfi, l’on rie pourroit conclure de ces
expériences , que ce que, nous fommes dans 1 ufage
de conclure de toute opération où il y a trois fubf-
' tances en' jeu ; c’eft-a-dire , le rang qm leur convient
refpééfivement, ’fiiivant que 1 une eft elue &
l’autre précipitée, à telle on telle température.
Ce que je viens de dire des décompofîtions produites
par l’augmentation de chaleur , s’applique tout
naturellêinent à celles qui s’opèrent par la diminution
de chaleur, ou par le refroidiffement. Il eft
foùt fimple que lés effets fbient ici dans un ordre
inverfe ; maisTa progreffion décroiflante n’a pas une
marche différente, 6c ne reconnaît point une 'autre
loi ; à la vérité la force agrégative des molécules-
de l’eau , en état de glace , eft plus grande que lorf-
qu’elle éft en l’état fluide ; en général elle eft d’autant
plus grande , que le froid eft plus coiifidetable.
'crepénBarit , ni le combat, ni 1 équilibré-des forces
oppofèes ; ne fo trouvent pas prècifément entre cette,
force aggrégàtive & la température qui laffoiblit a
proportion dé fon iritenfite, mais' entre 1 affinité de
combinai fon dès deux corps l’un avé’c 1 autre, &
l’affinité de la matière de la chaleur avec celui qai
eft le plus d'ifpofe à' cette union ; de forte que la
condenfation, ait point de folidite ne peut avoir lieu
pour l’unè des parties compofantes féparément, qu’â-
: près que l’affinité dé compofitioneft vaincue , & parce
' qu’elle eft vaincue. C ’e ft, dans la contemplation des
( affinités , le même phénomène que quand on fépar-e
: un fel de l’eau par l’alcohol ; affilrément les mole-
!" cirles du fel ainfi précipité fous forme concrète, (quoi-
rqti’en cfyftàux très-petits 8e irréguliers ) font dans
■ uri plus grartd état d’àggrégation qiie les molécules
il du foi diifous ; perfonne1 cependant n’héfitera de re-
f'connbître que là vraie carifé-clfe'cette précipitation élt
l’affinité plus grande de l’aleoh’ol aveç l’eau, que m
feau avec le fe l, & que fi les molécules TalmèsT
abandonnées par leur diffolvant s’aggrègent, autant
crue le leur permet la rapidité de la fêparation, ce
n’eft là qu’un effet fubféquent à'la déeompofition.
La petiteffe & l’irrégularité des cryftaux femblent
même annoncer que l’aggrégation des parties faliries
n’y a eu que bien peu de part.
Il y a donc tout lieu de croire que, dans tous les
phénomènes dont il eft queftion, la matière calorifique
joud^exaftement le même rôle que l’alcohol
dans l’expérience très-familière que je viens de rappeler
; c’eft-à-dire, qu’elle s’approprie une des fubf-
tances combinées , par fa plus grande affinité avec
elle ; & que l’autre refte libre, dans l’état de folidite
& d’aggrégation que décide fa température aéluelle.
Je crois qu’il feroit très-fuperflu de multiplier les
exemples qui établiffent cette analogie ; mais dans le
nombre de ceux que nous offre la piptique journalière
de la Chyrnie , il y en a qui méritent d’être
rappellés à cette occafion, en ce qu’ils donnent , la
facilité de fuivre les effets cdrrefpondans à des degrés
extrêmes, ou du moins tres-elôignes , de 1 e—
chelle thermomètrique ; & que par-là ils rendent
plus fenfible- l’ideijfitê de la caufe de la décompo-
fition par Je froid & par la chaleur. Tels font fur-
tout ia fêparation de l’eau & des fols, & la concentration
des acides par la congélation, de même
gué par la vapor jfation de l’eau.
Quand on accumule la chaleur autour de ces com-
pofés, l’eau, à raifon de fa plus grande affinité avec
ce fluide, s’élève avec lui ; le fol ou l’acide en font
ainfi féparés : l’un en cryftaux, parce qu il éft réduit
à un état de compofition, qui n’eft pas fufceptible
de fluidité à la tempéràture aéluelle ; l’autre plus
concentré, mais toujours fluide, parce qu il retient
encore une portion d’eau fuffifante pour lui confor-
ver cette propriété, 6c que la force aggrégative de
fes molécules ne peut rien qu’autant que l eau. lui
eft d’abord enlevée par une affinité fupérieure.
Quand on diminue la chaleur autour 4e ces com-
pofés, ce qui fe fait en les environnant de corps qui
l’attirent plus fortement qu’eux, parce qu’ils en ont
été privés à un point qui donne l’avantage à leur
affinité de compofition avec elle ; la déeompofition
s’opère, non plus par la vaporifation d’un des ele-
mens, le diffolvant volatil n’eft pas allez abondant
pour donner fa forme à aucun d’eux ; ils ne fe dif-
tinguent que par la différence de la liquidité a la
folidité , & c’eft l’eau qui devient folide. Mais^ je
ne penfo pas que l’on puiffe pour cela meconnpitre
la vraie caufe dé la fêparation, qui eft que la quantité
qui refte de matière calorifique n’a plus affez
d’affinité avec le compofé , comme compofé, pour lui
demeurer unie ; qu’à ce degré de refroidiffement,
la portion qui appartenoit au produit de la cômbi-
fcaifon de: l’eau & de l’acide , obéit à l’attraélion
éleélive plus puiffante de l’acide ; 8c que les molécules
de l’eau ainfi abandonnées à elles-mêmes, cèdent
a leur tour à la. force aggrégative ^ foule affinité.
• Scelles éprouvent c^ns cet inûa;it,
Poift ttncêvoïr autrement la chofe, il faudroit
fuppofer que, pendant le refroidiffement progreffif &
la compofition encore fùbfiftant, ce n’eft pas le compofé
lui-même , mais fes parties conftitûantes qui
fouffrent cette déperdition à des degrés inégaux : or
cette fuppôfition me paroît répugner également, foit
aux principes de la communication de la chaleur,
foit aux idées les plus familières fur les propriétés
des combinaifons, & qui nous les repréfontent comme
des corps rendus tellement homogènes qu’aucun de
leurs élémens né peut exercer fos propres .affinités,
tant que l’union fubfifte. _ *
Prenons garde encore qu’il ne s’agit pas feulement
d’expliquer pourquoi un acide affoibli a un certain
point ceffe d’agir fur la glace ; on pourroit peut-
être alors fe contenter de répondre qu’à cette température,
l’affinité d’aggrégation des molécules de Tèau
fo trouve fupérieure à fon affinité de compofition
avec l’acide; mais il faut que cette explication puifle
convenir au cas abfolument correfpondant où l’union
formée de l’acide & de l’eau eft rompue par les mêmes
circonftances d’affoibliffement de l’un & de refroi-
diffement de l’autre,- & où par conféquent la force
aggrégative de -la dernière ne peut devenir efficace
que par la ceffation de l’union. En un mot, je ne
vois pas fur quel fondement on pourroit fouftraire
la matière de la chaleur aux loix de l’affinité, ni
comment on pourroit concevoir un changement dans
l’état d’aggrégation des molécules d’une fubftance
quelconque, autrement que par leur compofition avec
un diffolvant qui s’y fixe par affinité, & qui ne peut
en être déplacé que par affinité.
Je n’imagine pas que l’on trouve de grandes difficultés
à admettre que la température étant abaiffé-e
à un certain point, l’acide s’empare delà plus grande
partie de la chaleur reftante , àTexclufion de,l’eau:
les Phyficiens ont remarqué-depuis long-temps que
des accroiffemens égaux de chaleur n’affeélqienr pas
également tous les corps, que la même matière ne
fuivpit pas toujours dans fos raréfaélions 6c conden-
fations une correfpondance régulière avec les degrés
du Thermomètre ; & quelle peut être la caufe de
ces.variations , finon une différente difjpofttion; à
s’unir au principe expanfible, fuivant les .diverfojs
températures ^ Il n’eft pas befoin de chercher les
preuves dé cette poffibilité hors des phénomènes qui
donnent lieu a' la queftion ; il fuffit de confidérer
ce qui fo paffe dans les différentes combinaifons de
l’eau & de l’acide vitriolique à différentes températures.
On exppfo à une chaleur fupérieure à celle
de l’eau bouillante de l’acide vitriolique affoibli ; l’eau
qui entroit dans cette compofition fo. fépare en état
.de diffolution vaporeufo. A la température moyenne,
cet acide concentré s’empare de Feau, Si précipite
en grande partie la chaleur qui lui étois unie. À quelques
degrés au deffous du terme de la glace,.cet
acide fo congèle en entier avec î?eau, qui lui eft:
encore combinée ; étendu de deux pâmes d’eau , i l
fupporté un froid de 15. degrés • iansj donner aucun
figne de congellation 5 encore plus délayé, il cont;