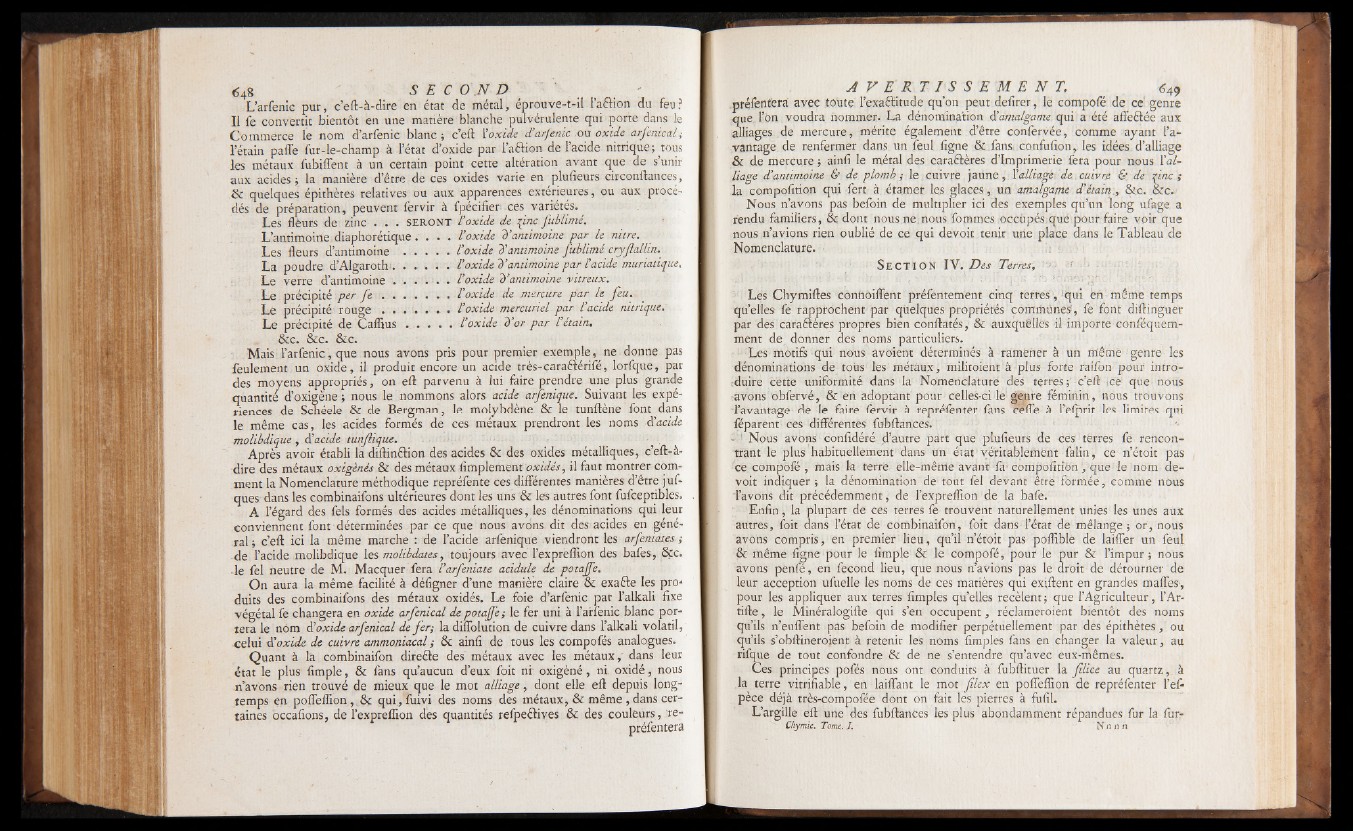
648 S E C O.N D ' '
L’arfenic pur, c’eft-à-dire en état de métal, éprouve-t-il l’aêlion du feu?
Il fe convertit bientôt en une matière blanche pulvérulente qui porte dans le
Commerce le nom d’arfenic blanc; c’eft Y oxide d’arjenic ou oxide arfenical;
l’étain paffe fur-le-champ à l’état d’oxide par l’aftion de l’acide nitrique; tous
les métaux fubiffent à un certain point cette altération avant que de s unir
aux acides ; la manière d’être de ces oxides varie en plufieurs circonftances,
& quelques épithètes relatives ou aux apparences extérieures, ou aux procédés
de préparation, peuvent fervir à Ipécifier ces variétés.
Les fleurs de zinc . , . seront l’oxide de {inc fublimé.
L’antimoine, diaphorétique. . . . l’oxide d’antimoine par le mtre.
Les fleurs d’antimoine ... . . . l’oxide d'antimoine fublimé cryjlallin.
La poudre d’AlgarotE. . .. » . . l’oxide 'd’antimoine par l’acide muriatique.
Le verre d’antimoine . . . . . Voxide d’antimoine vitreux.
Le précipité per f e ................... l ’oxide de mercure par le feu.
Le précipité-rouge . . . . . . . l’oxide mercuriel par l’acide nitrique.
Le précipité de Caffius............. l’oxide d’or par l’étain.
&c. & c. &c.
Mais l’arfenic , que nous avons pris pour premier exemple, ne donne pas
feulement un oxide, il produit encore un acide très-caraêlérifé, lorfque, par
des moyens appropriés, on eft parvenu à lui faire prendre une plus grande
quantité d’oxigène ; nous le nommons alors acide arfenique. Suivant les expériences
de Schéele & de Bergman, le molybdène & le tunftène font dans
le même cas, les acides formés de ces métaux prendront les noms d’acide
molibdique , à’acide tunflique.
Après avoir établi la diftinftion des acides & des oxides métalliques, c’eft-à-
dire des métaux oxigènés.& des métaux Amplement oxides, il faut montrer comment
la Nomenclature méthodique repréfente ces différentes manières d’être juf-
ques dans les combinaifons ultérieures dont les uns & les autres font fufceptibles.
A l’égard des fels formés des acides métalliques, les dénominations qui leur
conviennent font déterminées par ce que nous avons, dit des acides en général;
c’eft ici la même marche : de l’acide arfenique viendront les arfeniates ;
de l’acide molibdique les molibdates, toujours avec l’expreflion des bafes, &c.
•le fel neutre de M. Macquer fera l’arfeniate acidulé de potajfe.
On aura la même facilité à défigner d’une manière claire & exafte les produits
des combinaifons des métaux oxidés. Le foie d’arfenic par l’alkali fixe
végétal fe changera en oxide arfenical de potajfe; le fer uni à l’arfenic blanc portera
le nom d’oxide arfenical de fer; la diffolution de cuivre dans l’alkali volatil,
celui dé oxide de cuivre ammoniacal ; & ainfi de tous les compofés analogues.
Quant à la combinaifon direêle des métaux avec les métaux, dans leur
état le plus Ample, & fans qa’aucun d’eux foit nr oxigèné, ni. oxidé, nous
n’avons rien trouvé de mieux que le mot alliage, dont elle eft depuis longtemps
en poffeffion, & qui, fuivi des noms des métaux, & même, dans certaines
occaftons, de l’exprefîion des quantités refpeftives & des couleurs , repréfentera
A V E R T I S S E M E N T . g49
préfeniera avec toute l’exaéïitude qu’on peut defirer, le compofé de ce' genre
que. l’on voudra nommer, La dénomination dé amalgame, qui a été affeélée aux
alliages de mercure, mérite également d’être confervée, comme ayant l’avantage,
de renfermer dans un feu! flgne & fans, confufion, les idées, d’alliage
& de mercure ; ainfl le métal des caractères d’imprimerie fera pour nous l’alliage
d’antimoine & de plomb,; le, cuivré jaune, l’alliage de .cuivre & de fine;
la compofltion qui fert à étamer les glaces, un amalgame d’étain;, &c. &c.
Nous n’avons pas befoin de multiplier ici des exemples qu’un long ufage a
rendu familiers, & dont nous ne.nous îommes occupés que pour faire voir que
nous n’avions rien oublié de ce qui devoit. tenir une place dans le Tableau de
Nomenclature. ; :
Section IV. Des Terres,
Les Chymiftes connoiffent préfentement cinq terres , !qui ën même temps
qu’elles fe rapprochent par quelques propriétés communes1, le font diftiriguer
par dés caraêïères propres bien confiâtes, & auxquêlles il importe conféquem-
ment de donner des noms particuliers.
Les motifs qui nous avoient déterminés à ramener à un même genre les
dénominations de tous les'métaux, militoient à plus forte raifon pour intro-
eduire cette uniformité dans la Nomenclature des terres; c’eft tce que; nous
avons obfervé, & en adoptant pour celles-ci le genre féminin, nous trouvons
l’avantage de le faire fervir à reprélènter fans ceffe à l’elprit les limites qui
féparent ces différentes fubftances. ;
- 1 Nous avons confldéré d’autre pârt que plufleurs de ces terres fe rencontrant
le plus habituellement dans un état ! véritablement falin, ce n’étoit pas
ce compofé , mais la terré elle-même avant eompofltiôn , que Te nom devoit
indiquer ; la dénomination de tout fel devant êtré fbrmée, comme nous
l’avons dit précédemment , de l’expreflïon de la bafe.
Enfin, la plupart de ces terres fe trouvent naturellement unies les unes aux
autres, foit dans l’état de combinaifon, foit dans l’état de mélange; or, nous
avons compris, en premier lieu, qu’fl n’étoit pas poffiblè de laiffer un feul
& même ligne pour le fimple & le compofé, pour le pur & l’impur; nous
avons penfé, en fécond lieu, que nous n’avions pas le droit de détourner de
leur acception ufuelle les noms de ces matières qui exjftent en grandes maffes1,
pour les appliquer aux terres fimples qu’elles recèlent ; que l’Agriculteur, l’Ar-
tifte, le Minéralogifte qui s’en occupent, réclameroient bientôt des noms
qu’ils n’euffent pas befoin de modifier perpétuellement par des épithètes, ou
qu’ils s’obftineroient à retenir les noms fimples fans en changer la valeur, au
rifque de tout confondre & de ne s’entendre qu’avec eux-mêmes.
Ces principes pofés nous ont conduits à fubftituer la flice au quartz, à
la terre vitrifiable, en laiffant le mot filex en poffeflion de repréfenter l’ef-
pèce déjà très-çompofée dont on fait les pierres à fufil.
L’argille eft une des fubftances les plus abondamment répandues fur la fur-
Chymie. Tome., J, N n n n