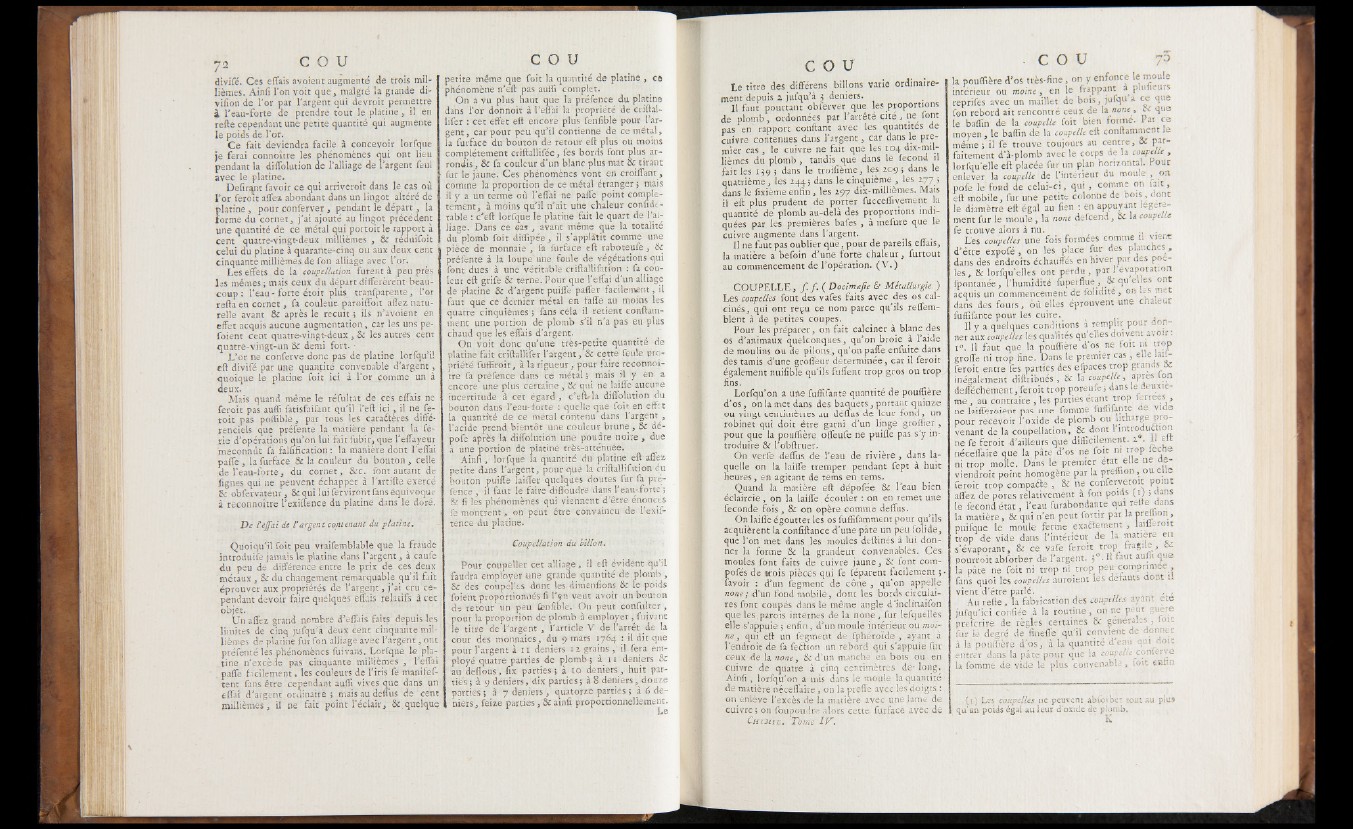
•jo. C O U
divifé. Ces effais avoient augmenté de trois millièmes.
Ainfi l'on voit que, malgré la grande di-
vifion de l’or par l'argent qui devroit permettre
à l’ eau-forte de prendre tout le platine, il en
refie cependant une petite quantité qui augmente
le poids de l'or.
Ce fait deviendra facile à concevoir lorfque
je ferai connoître les phénomènes qui ont lieu
pendant la diffolution de l’alliage de l'argent feul
avec le platine. _
Délirant favoir ce qui arriveroit dans le cas où
l'or feroit affea abondant dans un lingot altéré de
platine, pour çonferver , pendant le départ, la
forme du cornet, j'ai ajouté au lingot précédent
une quantité de ce métal qui portoit le rapport à
cent quatre-vingt-deux millièmes , & réduifoit
celui du platine à quarante-cinq ou aux deux cent
cinquante millièmes.de fon alliage avec l'or.
Les effets de la coupellation furent à peu près
Iss mêmes ; mais ceux du départ différèrent-beaucoup
: l'eau-forte étoit plus tranfparente, l'or
refia en cornet, fa couleur, paroiffoit affez naturelle
avant & après le recuit ; ils n'dvoient en
effet acquis aucune augmentation., car les uns pe-
foient cent quatre-vingt-deux, & les autres cent
quatre-vingt-un & demi fort. ■
L’or ne conferve donc pas de platine lorfqu'il
efl divifé par une quantité convenable d’argent,
quoique le platine foit ici à l’ or comme un à
deux.
Mais quand même le réfultat de ces effais ne
feroit pas auffi fatisfaifant qu’il l’eft ic i, il ne fe - ,
roit pas poffible , par tous les caraûères diffé-
renciels que préfente la matière pendant la férié
d'opérations qu’on lui fait lubir, que l'effayeur
méconnût fa falfification : la manière dont l'effai
paffe, la furface & la couleur du bouton, celle '
de l'eau-forte, du cornet, &c. font autant de
Lignes qui ne peuvent échapper à l'artifte exercé
& obfervateur, & qui lui ferviront fans équivoque
à reconnoître l'exiflence du platine dans le doré.
De leffai de l'argent contenant du platine. ‘
Quoiqu’ il foit peu vraifembiable que la fraude
introduire jamais le platine dans l'argent, à taufe
du peu de différence entre le prix de ces deux
métaux, & du changement remarquable qu’il fa it.
éprouver aux propriétés de l’ argent, j’ai cru cependant
devoir faire quelques effais relatifs à cet
objet. / ' /. 1
Un affez grand nombre d’effais faits depuis-les.
limites de cinq jufqu’à deux cent cinquante mil- '
lièmes de platine fur fon alliage avec l’argent, ont
préfenté les phénomènes fuivans. Lorfque le platine
n’excède pas cinquante millièmes , l’effai
paffe facilement, les couleurs de l’ iris fe manifef-
tent fans être cependant auffi vives que dans un
effiii d'argent ordinaire ; mais au demis de cent
millièmes, il ne fait point l'éclair, & .quelque
C O U
petite même que foit la quantité de platine , ce
phénomène n'eft pas auffi complet.
On a vu plus haut que la préfence du platine
dans l'or donnoit à l ’effai la propriété de criftal-
lifer : cet effet eft encore plus fenfible pour Farge
nt , car pour peu qu'il contienne de ce métal,
la furface du bouton de retour eft plus ou moins
complètement criftallifée, fes bords font plus arrondis,
& fa couleur d’un blanc plus mat & tirant
fur le jaune. Ces phénomènes vont en croiflant,
comine la proportion de ce métal étranger ; mais
il y a un terme où l'effai ne paffe point complètement.,
à moins qu'il n'ait une chaleur confïde-
rable : c’ eft lorfque le platine fait le quart de Fai-
liage. Dans ce cas , avant même que la totalité
du plomb foit diffipée, il s’applatit comme une
pièce de monnaie , fe furface eft raboteufe, &
préfente à la loupe'une. foule de végétations qui
font dues à une véritable criftallifation : fa couleur
eft grife & terne. Pour que l’effai d'un alliage
de platine & d'argent puiffe paffer facilement, il
faut que ce dernier métal en faffe au moins les
quatre cinquièmes; fans cela il retient conftam-
ment une portion de plomb s'il n'a pas eu plus
chaud que les effais d'argent.
On voit donc qu'une très-petite quantité de
platine fait criftallifer l'argent, & cette feule pro*
prière fuffiroit, à la rigueur, pour faire reconnoï-
tre fa préfence dans ce métal ; mais il y en a
encore une plus certaine, & qui ne laiffe aucune
incertitude à cet égard, c'eftrla diffolution du
bouton dans l'eau-forte : quelle que foit eh effet
la quantité de ce métal contenu dans l'argent,
l’acide prend bientôt une couleur brune -, & dé-
pofe après la diffolution une poudre noire, due
à üne portion de platine très-atténuée.
A in fi, lorfque la quantité du platine eft affez
petite dans Fargent, pour que la criftallifvtion du
bouton puiffe laiffer quelques doutes fur fa pre-
fence , il faut lé faire diffoudre dans l'eau-forte ;
& iî les phénomènes qui viennent d’être énoncés
fe montrent, on peut être convaincu de l'exif-
tence du platine.
Coupellation dubillon.
Pour coupeller cet alliage, il eft évident qu’il
faudra employer une grande quantité de plomb ,
& des coupelles dont les dimenfions & le poids
foient proportionnés fi l'_$n veut avoir un bouton
de retour un peu fenfible. On peut confulter,
pour la proportion de plomb à employer, fui vaut
lé titre de Fargent , l'article V de l’arrêt de la
cour des monnaies, du 9 mars 1764 : il dit que
pour Fargent à n deniers 12. grains , il. fera employé
quatre parties de plomb ; à 11 deniers &
au deffous , fix parties ; à io~ deniers , huit parties;
à 9 deniers, dix parties; à 8 deniers, douze
parties ; à 7 deniers , quatorze parties ; à 6 deniers,
feize parties, & ainfi proportionnellement.
C O U
t e titre des différens billons varie ordinairement
depuis 1 jufqu'à 3 deniers.
Il faut pourtant obferver que les proportions
de plomb, ordonnées par l'arrêté c ité , ne font
pas en rapport confiant avec les quantités de
cuivre contenues dans Fargent, car dans le premier
cas , le cuivre ne fait que les 104 dix-millièmes
du plomb, tandis que dans le fécond il
fait les 139 ; dans le troifièrne, les 209; dans le
quatrième, les 244; dans le cinquième , les 277 ;
dans le fixième enfin, les 297 dix-millièmes. Mais
il eft plus prudent de porter fucceffivement la
quantité de plomb au-delà des proportions indiquées
par les premières baies , à mefure que le
cuivre augmente dans Fargent.
II ne faut pas oublier que, pour de pareil^ effais,
la matière a befoin d'une forte chaleur, furtout
au commencement de l’opération. (V .)
COUPELLE, ƒ. ƒ. ( Docimafie & Métallurgie.)
Les coupelles font des vafes faits avec des os calcinés,
qui ont reçu ce nom parce qu'ils reffem-
blent à de petites coupes.
Pour les préparer, on fait calciner à blanc des
os d'animaux quelconques, qu'on broie à l’aide
de moulins ou de pilons, qu’on paffe enfuite dans
des tamis d’une groffeur déterminée, car il feroit
également nuifible qu'ils fuffent trop gros ou trop,
fins.
Lorfqu'on a une fuffifante quantité de pouffière
d'os, on la met dans des baquets, portant quinze
ou vingt centimètres au déffus de leur fond, un
robinet qui doit être garni d'un linge grofher,
pour que la pouffière offeufe ne puiffe pas s’y introduire
& Fobftruer.
On verfe deffus de l’eau de rivière, dans la- -
quelle on la laiffe tremper pendant fept à huit
heures, en agitant de tems en tems.
Quand la matière eft dépofée 8c Feau bien
éclaircie, on la laiffe écouler : on en remet une
fécondé fois, 8c on opère comme deffus.
On laiffe égoutter les os fuffïfammentpour qu'ils
acquièrent la confiftance d'une pâte un peu folide,
que Fon met dans les moules deftinés à lui donner
la forme 8c la grandeur convenables. Ces
moules font faits de cuivre jaune, 8c font com-
pofés de crois pièces qui fe réparent facilement ; •
favoir : d'un fegment de cône , qu'on appelle
none; d’un fond mobile, dont les bords circulaires
font coupés dans le même angle d'inclinaifon
que les,parois internes de la none,"fur lefquelles
elle .s’appuie ; enfin, d’un moule intérieur ou moine
3 qui eft un fegment de fphéroïde , ayant à
l ’endroit de fa fedtion un rebord qui s'appuie fur
ceux de la none, & d'un manche en bois ou en
cuivre de quatre à cinq centimètres de- long.
Ainfi , lorfqu’on a mis dans le moule la quantité •
de matière néceffaire, on la preffe avec les doigts.:
on enlève l’excès de la matière avec une lame de
cuivre ; on foupoudre alors cette furface avec de
Chimie, Tome IV.
la pouffière d’ os très-fine, on y enfonce le inouïe
intérieur ou moine, en le frappant a plu leurs
reprifes avec un maillet de bois, jufqu a ce que
fon rebord ait rencontré ceux de h none , oc que
le baffin de la coupelle foit bien formé. 1 ar ce
moyen, le baffin de la coupelle eft conftamment le
même; il fe trouve toujours au centre, oc parfaitement
d’à-plomb avec le corps de la coupelle ,
lorfqu’elle eft placée fur un plan horizontal. Pour
enlever h coupelle de l’intérieur du moule , on
pofe le fond de celui-ci, qui , comme on îa it,
eft mobile, fur une petite colonne de bois , dont
le diamètre eft égal au fien : en appuyant legere-
mént fur le moule, là none defeend, 8c la coupelle
fe trouve alors à nu. i ..
Les coupelles une fois formées comme il vient
d'être expofé , on les place fur des planches;,
dans des endroits échauffés en hiver par des poêles,
& lorfqu'elles ont perdu, par l’évaporation
fpontanée, l’humidité fupetflue , 8c qu elles ont
acquis un commencement de folidité, on les met
dans des fours, où eiies éprouvent une chaleur
fuffifante pour les cuire.
Il y a quelques conditions à remplir pour donner
aux coupelles les qualités qu’elles doivent avoir :
i°. Il faut que la pouffière d’os ne foit ni trop
groffe ni trop fine. Dans le premier cas, elle lau-
feroit entre fes parties des efpaces trop grands oc
inégalement diftribués , & la coupelle, apres on
defféchement, feroit trop poreufe; dans le deuxieme
, au contraire , les parties étant trop ^ rre^ >
ne laifferoient pas une fomme fuffifante de vide
pour recevoir l’oxide de plomb ou utharge pio-
venant de la coupellation, 8c dont 1 introduction
ne fe feroit d'ailleurs que difficilement. 2 . Il e
néceffaire que la pâte d'os ne foit ni trop ieche
ni trop molle. Dans le premier état elle ne de-
viendroit point homogène par la preffion , ou elle
feroit trop compacte , 8c ne conferveroit point
affez de pores relativement à fon poids ( y ; dans
le fécond état, Feau furabondante qui relie dans
la matière, & qui n'en peut fortir par la preliion,
puifque le moule ferme exactement, laifleroit
trop de vide dans l’intérieur de la matière en
s’évaporant, & ce vafe feroit trop fragile, oc
pourroit abforber de Fargent. 30. Il faut auffi que
la pâte ne foit ni trop ni trop peu comprimée,
fans quoi les coupelles auroient les defauts dont 1*
vient d’être parlé. . , ,
Ail refte, la fabrication des coupelles ayant ete
jufqu’ici confiée à la routine, on ne peut guère
preferire de règles certaines & générales, foit
fur le degré de fineffe qu'il convient de donner
à la pouffière d’os, à la quantité d eau qui doit
entrer dans la pâte pour que la coupelle conlerve
la fomme de vide le plus convenable, foit enfin
(1) Les coupelles ne peuvent abforber tout au plus
qu’un poids égal au leur d’oxide de plomb,
K