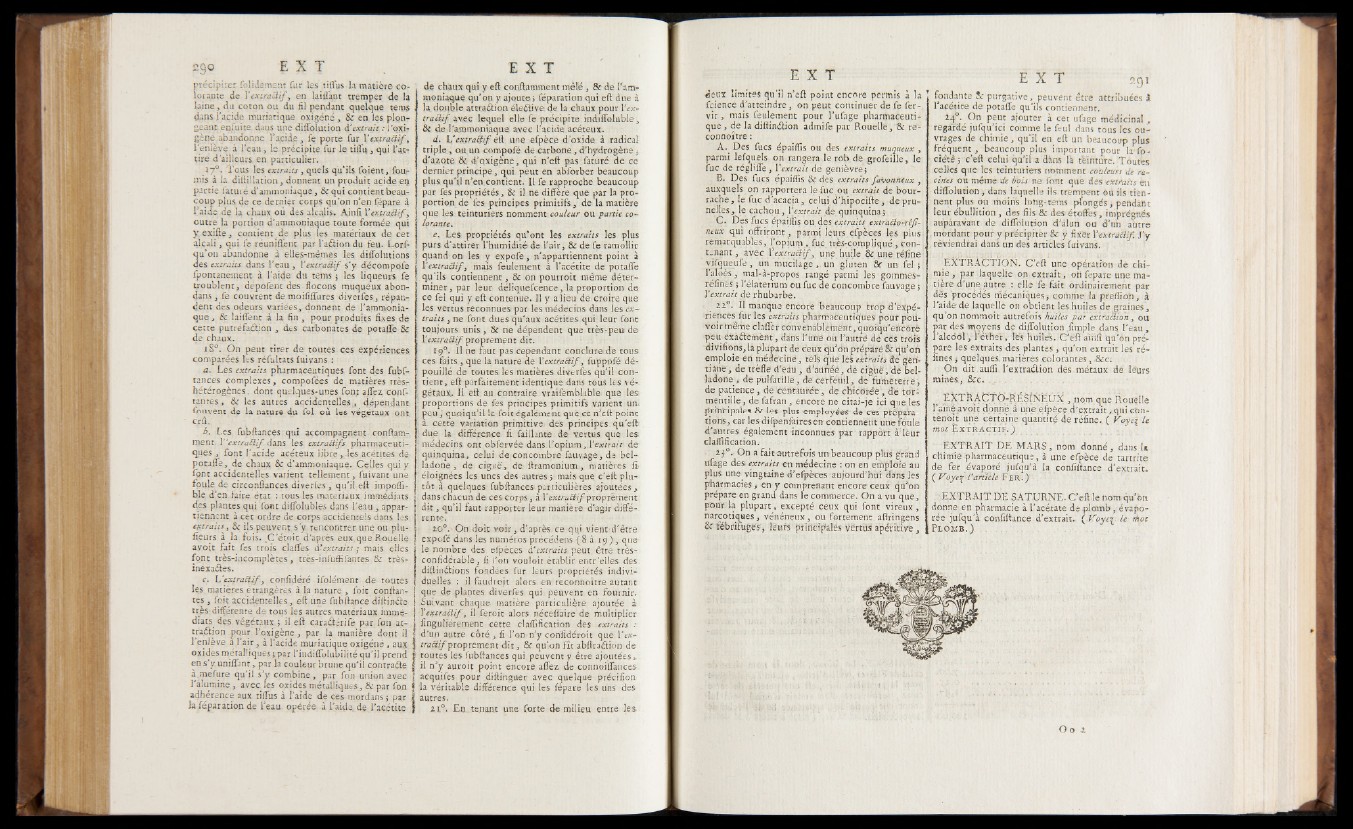
ego E X T
précipiter folidement fur les tiffus la matière colorante
de Y extrait i f 3 en laiffapt tremper de la
laine, du coton ou du fil pendant quelque tems
dans l'acide muriatique oxigéné , 8c en les plongeant
enfuite daus une diflolution à‘extrait : i'oxi-
gène abandonne faci.de , fe porte fur Yextraftif,
l'enlève à l'eau, le précipite fur le tiffu , qui l’attire
d'ailleurs en particulier.
170. Tous les extraits 3 quels qu’ils foient, fou-
nus à la diftillation, donnent un produit acide en
partie laturé d’ammoniaque, & qui contient beaucoup
plus de ce dernier corps qu’on n’en fépare à
l’aide de la chaux ou des alcalis. Ainfi l’extractif 3
outre la portion d’ammoniaque toute formée qui
y exifte, contient de plus les matériaux de cet
alcali, qui fe réunifient par l’aétion du feu. Lorf-
qu’on abandonne à elles-mêmes les diflolutions
des ex.cn tits dans l’eau , Y extra c tif s’y décompofe
fpontanement à l’aide du tems j les liqueurs fe
troublent, dépofent des flocons muqueux abon-
dans , fe couvrent de moififfures diverfes, répandent
des odeurs variées, donnent de l’ammoniaque,
& laiffent à la fin , pour produits fixes de
cette putréfaélion , des carbonates de potaffe &
de chaux.
i8°. On peut tirer de toutes ces expériences
comparées les réfultats fuivans :
a. Les extraits pharmaceutiques font des fubf-
tances complexes, compofées de matières très-
hétérogènes, dont quelques-unes fon; a fiez, confiantes
, 8c les autres accidentelles, dépendant
Couvent de la nature du fol où les végétaux ont.
qru.
b. Les fubftances qui accompagnent confiam?.
ment. Y ‘e xtra £ iif dans les extractifs pharmaceutiques
, font l’acide açéteux libre, -les acétites de
potaffe, de chaux & d’ammoniaque. Celles qui y
font accidentelles varient tellement, fuivant une
foule de circonftances diverfes , qu’il eft impofli-
ble d’en faire état : tous les matériaux immédiats
des plantes qui font diffolubles dans l’eau , appartiennent
à cet ordre de corps accidentels dans les
extraits3 & ijs peuvent, s'y rencontrer une ou plu-
fïeurs. à la fois. _C’étoit d’après eux.que Rouelle
ayoit fait fes trois claffes d"extraits ; mais elles
font très-incomplètes, très-infufE fautes 8ç très-
inexaâes.
c. U extractif 3 confidéré ifqléme-nt de- toutes
les matières étrangères à la nature fpit confiant
tes , foit accidentelles.,, eft une fu bilan ce diftinéle-
très-différente de tous les autres, matériaux immédiats
des végétaux; il eft çaraèlirifé par fon.attraction
pour l’oxigène, par la manière dont il
1 enlève à l’air , à l’acide muriatique oxigéné , aux
oxides métalliques; par l’indiffolubiliré qu’il prend
en s’y unifiant, par la couleur brune qu’il contracte
a mefure qu’il s’y combine, par fon union avec
l’alumine, avec les oxides métalliques, & par fon
adhérence aux tiffus à l ’aide de ces mord ans ; par
la réparation de l’eau opérée à l'aide, de l’acétite
E X T
de chaux qui y eft conftamment mêlé, & de l’ammoniaque
qu’ on y ajoute ; réparation qui eft due à
la double attraction éleétive 4e ta chaux pour l’exv
tra&if avec lequel elle fe précipite indiffoluble,
& de l'ammoniaque avec facide acéteux.
d. Uextra&if eft une efpèce d’oxide à radical
triple, ou un compofé de carbone, d’hydrogène y
d’azote &; d’qxigène, qui n’eft pas faturé de ce
dernier principe, qui peut en abforber beaucoup
plus qu’il n’en.contient. Il fe rapproche beaucoup
par fes propriétés, & il ne diffère que par la proportion
de fes. principes primitifs, de la matière
quç les teinturiers nomment;couleur ou partie colorante.
e. Les propriétés qu’ ont les extraits les plus
purs d’attirer l’humidité de l’air, & de fe ramollir
quand on les y expofe, n’appartiennent point à
Y ex traSif3 mais feulement à l'acétate de potaffe
qu’ils contiennent, & on pourroit même déterminer,
par leur déliquefcence, la proportion de:
ce fe! qui y eft contenue. Il y a lieu de croire que
les vertus reconnues par les médecins dans les extraits
y ne font dues qu’aux acétites qui leur font
toujours unis, & ne dépendent que très-peu de
Yexcraftif proprement dit.
I9q. Il ne faut pas cependant conchire.de tous
ces faits, que la nature de l’extractif, fuppofé dépouillé.
de toutes, les matières diverfes qu’il con-
: tient, eft parfaitement identique dans tous les vé-
: gétaux.. Ii< eft au contraire vraifembkble que les*.
: proportions de fes principes primitifs varient uni
■ peu, quoiqu’il le foit égalément que ce n’eft point
■ à. cette variation primitive des principes qu’eft
• due la différence fi faiihnte de vertus que les-
j médecins ont obfervée dans, l’opium ,.Yextrait de
quinquina, celui de concombre fauv.age, de belladone
, de ciguë, de ftramonium:, matières fit
ï éloignées les.unes des autres ; mais que c’elt plu-
> tôt à. quelques fubftances- partkulières.ajoutées,,
dans chacun de ces corps., à Yextra&if proprement
dit, qu’ il faut rapporter leur manière d’agir différente.
20°. On. doit voir, d’après ce qu,i vient d’être
expofé dans les numéros précédens ( 8 à. 1 9 ) , que
le nombre des efpèqes à*extraits peut être très-
confidérâble, fi l’on vouloir établir entr elles des
diftinétions fondées fur leurs propriétés individuelles
: il faudroit alors en reconnoître autant
que de plantes diverfes qui peuvent en fournir.
Suivant chaque matière particulière ajoutée à
Yextraüf, il feroit alors néceffaire de multiplier
finguliérement cette claffification des extraits :
d’un autre côré, fi l’on n’y confidéroit que Y ex-
traclif proprement dit, & qu’on fît abftra&ion de
toutes les fubftances qui peuvent y être ajoutées,
il n’y auroit point encore affez de connoiffances
acquifes pour .diftinguer avec quelque précifion
la véritable différence qui les fépare les uns desautres.
21°. En tenant une foite de milieu entre les.
E X T
deux limites qu’il n’eft point encore permis à la
fcience d’atteindre, on peut continuer de fe fer-
v ir , mais feulement pour l’ufage pharmaceutique,
de la diftin&ion admife par Rouelle, & ré-
connoître :
A. Des fucs épaiflis ou des extraits muqueux,
parmi lefquels on rangera le rob de grofeille, le
fuc de régliffe, Y extrait de genièvre;
B. Des fucs épaiflis & des extraits fa\>onnèux ,
auxquels on rapportera le fuc ou extrait de bourrache,
le fuc d'acacia, celui d’hipociftei de prunelles
, le cachou, Y extrait de quinquina ;
C. Des fucs épaiflis ou des extraits extr'afto-rêfi- ;
neux qui offriront parmi leurs, efpèces les plus i
remarquables, l’opium, fuc très-compliqué , con- j
tenant, avec Ÿ extrait f 3 une huile 8c une réfine ■ 3 un mucjlage .»• un gluten & un fel ;
falots* mal-à-propos rangé parmi les gommes-
réfineS; l’élaterium ou fuc de concombre fauvage ;
Yextrait de rhubarbe.
22°. Il manque encore beaucoup trop d’ëxpé-
riefices fur les extraits pharmaceutiques pour p'bii-
voir même clafîér convenablement, quüiqu’ehcôrè
peu ëxàdlémènt, dâns l’uné ou l’autré dè cës trôis
divifions, la plupart dé ceux qu’dn préparé 8c qü’on
emploie ën médèciné, tels qtië lèfc extraits dè gêfi-
tianë, de trèfle d’eàu , d’aufïéë, dé ciguë, de belladone
i de pulfârillé, de cerfétiil, dé fuihëterfë^
de patience, de cëntàürée, dë chicbfëè, dë tor-
mentille, de fafran , encore ne citai-je ici que.les
principales Sc les plus employées de ces préparations
, car les-difpenfàires en contiennent une foule
d’autres également inconnues par rapport à lèur
claflîfic-ation.
230. On a fait-autrefois un beaucoup pliis grând
ttfage des extraits -en médecine : on en emplofié au
plus une vingtaine d’efpèces 'aujourd’hui dans les
pharmacies t en y comprenant encore ceux cjûen
prépare en grand dans le commerce. On a vu que,
pour-la plupart, excepté ceux qui font vireux ,
narcotiques, vénéneux, ou fortement aftringens
8c fébrifuges, leurs priricipalès vertus apéritive,
E X T 2 9 1
fondante 8c purgative, peuvent être attribuées i
1 acetite de potaffe qu'ils contiennent.
24°. On peut ajouter à cet ufage médicinal,
regardé jufqu’ici comme le feul dans tous Jes ouvrages
de chimie, qu’il en eft un beaucoup plus
fréquent, beaucoup plus important pour la-fp-
cieté ; c’eft celui qu’il a dàns là teinture. Toutes
celles que les teinturiers nomment couleurs de racines
ou même de bois ne font que des extraits en
diflolution ; dans laquelle ils trempent ou ils tiennent
plus ou moins long-tems plongés, pendant
leur ébullition, des fils & des étoffes, imprégnés
auparavant de diflolution d’àlun ou d’un autre
« mordant pour y -précipjtër 8c y fixer Yextrâftif J'y
; réviendrai dans un des articles fuivans.
ËXTRÀCTÏON. C’eft une opération dè chimie,
par laquelle on extrait, on fepaie une matière
d’une_ autre : elle fe fait ordinairement par
des procédés mécaniques * epinme la preflîoii, à
l ’aide de laquellè on obtient les huiles de graines,
qu on nommoit autrefois huiles par extraction, ou
par des moyens dp diffolution ,fimple danç l’eau,
l ’alcdôl , l’éther, les huiles. G’ëft ainfi qu’on prépare
les extraits des plantes, qu’on extrait les réfines
'y quelques, matières .colorantes, 8cc:
Ôn dit.aufli l’extraélion des métaux de lëurs
minés., & c . . .
P EXTRAITO-RÉSÎNEÛX , nom que. Rouelle
l’aînëâvoit donne a une e/pèce d’extrait ^qui con-
tenoit une certaine quantité de réfîne.. ( Voye\ le
mot Extrac tif .)
EXTRAIT DE MARS, nom donné, dans la
chîmiè pharmaceutique, à une efpèce de tartrite
de fer évaporé jufqu’à la confiftance d’extrait.
( Voye\ L‘article Fer.)
. EXTRAIT DE SATURNE. C ’eft le nom qu’On
donne.en pharmacie à l’acétate de plomb, évaporée
jufqu a confiftance d’extrait. { Voyei le thot
Plomb.)