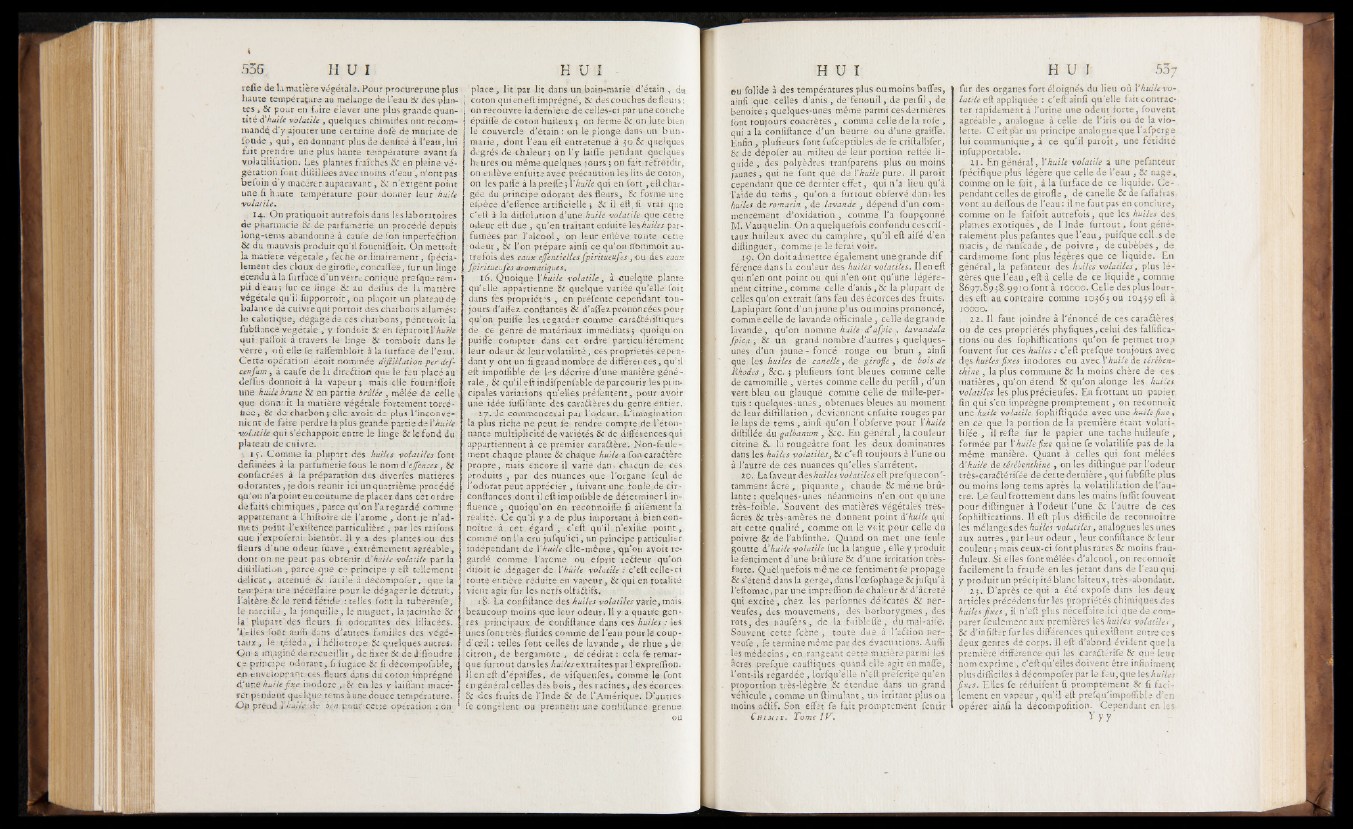
536 H U I
refîe de ta matière végétale. Pour procurer une plus
haute température au mélange de l'eau & des plantes,
& pour en faire élever une plus grande quantité
d1 huile volatile, quelques chimifles ont recommandé
d'y ajouter une certaine dofe de muriate de
ioude , qui, en donnant plus de denfité à l’eau, lui
fait prendre une plus haute température avant fa
volatilifation. Les plantes fraîches & en pleine végétation
font diüillées avec moins d'eau , n'ont pas
befoin d’y macérer auparavant, 8c n’exigent point
une fi haute température pour donner- leur huile
•volatile.
14. On pratiquoit autrefois dans les laboratoires
de pharmacie & de parfumerie un procédé depuis
iong-tems abandonne à eaufe de fon imperfeéïion
& du mauvais produit qu’il fourniflbit. On mettoit
la matière végétale, fëche ordinairement, fpécia-
lement des doux de girofle, concaftée, fur un linge
étendu à la fur face d'un verre conique prefque rempli
d'eau; fur ce linge & au deftus de la matière
végétale qu’il fupporcoit, on plaçoit un plateaùde
balance de cuivré qui portoit des charbons allumés*,
le calorique, dégagé de ces charbons, pénetroit la
iubftance végétale , y fondoit & en féparoitrAar/e
qui pafloit à travers le linge de tomboic dans le
verre, où elle fe raffembloit à la furface de l'eau.
Cette opération .était nommée diftillation perdefi-
c.enfum , à caufe de la direction que le feu placé au
de/fus donnoit à la vapeur 4 mais.elle fourniffoit <
une huile brune & en partie brûlée , mêlée de celle
que donnoit la matière végétale fortement torréfiée,
& de charbon; elle avoit de plus l'inconvé-['
nient de faire perdre la plus- grande partie de Y huile
volatile qui s'échappait entre le linge & le fond du
plateau deacuivre,
I 1 f . Comme la plupart des huiles volatiles (ont
defîinées à la parfumerie fous le nom d'ejfences , &
çonfacrées à la préparation des diverfes matières
odorantes, je dois réunir ici un quatrième procédé
qu'on n’a point eu coutume de placer dans cet ordre
défaits chimiques, parce qu’on l’a regardé comme
appartenant à l’hiftoire de }’ar.ome , dont -je n’admets
point l’exiftence particulière , par les raifons
que j’expoferai bientôt. Il y a des plantes ou des
fleurs d'une odeur fuave , extrêmement agréable,
dont on.ne peut pas obtenir d’huile volatile par la
diftillation, parce quë ce principe y eft tellement
délicat, atténué. & facile à décompofèr, que la
tempérai ure nécèffaire pour le dégager le détruit,
l ’altère fie-le rend fétide : telles font la tubéreufe,
le narcifle, la jonquille, le muguet, la jacinthe &
la plupart des fleurs fl odorantes dès. liiiacées.
Telles font auflV dans d'autres familles des végé-.
taux;, le r.éféda, l’héliotrope & quelques autres.
Qn a invaginé de recueillir, de fixer & dediflfoudre
ce. principe odorant, fl fugace & fi décompoiable,
e/i enveloppant ces fleurs dp ns du coton imprégné
d'une huile fixe inodore , . & en les y lai fiant macérer
pendant quelque te ms à une douce température.
•On pren dYhailç.àc b.en pour cette opération : on
h u 1
place, lit par lit dans un bain-marie d'étain , du
j coton qui en eft imprégné, fie des couches de fie lu s ;
011 recouvre la dernière de celles-ci par une couche
épâiflè de coton huileux ; on ferme & on lute bien
le couvercle d'étain : on le plonge dans un bain-
marie, dont l’eau eft entretenue à 30 & quelques
de g rés. de chaleur; on l'y biffe pendant quelques
heures ou même quelques jours ; on fait refroidir,
on enlève enfui te avec précaution les lits de coton,
on les palfe à la prefle ; Y huile qui en fort, eft chargée
du principe odorant des fleurs, & forme une
efpèce d'eflfence artificielle ; & il eft. fl vrai que
c'tft à la diiloljtion d'une huile volatile que cette
odeur eft due, qu'en traitant enluite les huiles parfumées
par l'alcool, on leur enlève toute .cette
odeur, 8c l'on prépare ainfi ce qu’on îïommoit autrefois
des eaux ejfientielles fipiritueufies 3 ou des eaux
fipiritueufies aromatiques.
16. Quoique Y huile volatile, à quelque plante
qu'elle appartienne 8c quelque variée qu'elle foie
dans les propriétés , en préfente cependant toujours
d'aflèz confiantes & d'aflez prononcées pour
qu'on puilfe les regarder comme caraéféiiftiques
■ de ce genre de matériaux immédiats ; quoiqu’on
puifle compter dans cet ordre particuliérement
; ieur odeur & leur volatilité, ces propriétés cependant
y ont un fi grand nombre de différences, qu’ il
eft impolflble de les décrire d’une manière générale,
& qu'il eft indifpenfable de parcourir les piin-
cipales variations, qu'elles préfentent, pour avoir
une idée fuffifante des caractères du-genre entier.
17. Je commencerai par Todeur. L’imagination
la plus riche ne peut fe rendre compte.de Téton-
| nante multiplicité de variétés & de difféisences qui
I appartiennent à ce premier caradère. Non-feulement
chaque plante & chaque huile afon caractère
propre, mais encore.il varie dan> chacun de ces
produits , par des nuances que l'organe feul de
l’odorat peut apprécier , fuivant un.e.. fou!e.<de cjr-
conftances dont il eft impofflble de déterminer l'influence
, quoiqu’on en reconnoilfe fi aifément la
réalité. Ce qu'il y a de plus important à biencon-
noïtre à. cet. égard , c'eft qu’il n'exifle point,
comme on l'a cru jufqü’ici, un principe particulier
indépendant d.e Yhuile elle-même, qu'on avoir regardé
comme l’arcme ou efprit redeur qu'on
difoit le .dégager de Yhuile volatile./'c'eft celle-ci
; route entière réduite en vapeur., & qui en totalité
vient agir fur les nerfs olfàdifs. -
18. La cpnfiftance des huiles volatiles varie, mais
beaucoup moins que leur odeur. 11 y a quatre genres
principaux de confiftanee dans ces huiles : les
Unes font très.:fluides comme de l'eau pour le coup-
d’oeil : telles font celles de lavande, de rhue, de
citron, de bergamote , de- cédrat : cela fe remarque
furtout dans les A a.;/e.r ext rai tes par 1expreffion.
II en. eft d’épaifles, de vifqueufes, comme le font
en général celles des bois, des racines, des écorces
& des fruits de l'Inde & de l’Amérique. D’autres
fe congèlent ou prennent une confiftanee grenue
ou
H U I
©u folide à des températures plus ou moins baffes,
ainfi que celles d’anis , de fenouil, de peifil, de
benoite ; quelques-unes même parmi ces dernières
font toujours concrètes, comme celle de la rofe,
qui a la confiftanee d'un beurre ou d’une graille.
Enfin, plufieurs font fufceptibles de fe criftallifer,
& de dépofer au. milieu de leur portion reftée liquide,
des polyèdres tranfparens plus ou moins
jaunes, qui ne font que de Yhuile pure, il paroît
cependant que ce dernier effet, qui n'a lieu qu’à
Taidedu terhs, qu'on a furtout obfervé dam les
huiles de romarin , de lavande , dépend d’un commencement
d’oxidation , comme l'a foupçonné
M. Vatiquelin. On a quelquefois confondu ces crif-
t.aux huileux avec du camphre, qu’il eft aifé d’en
diftinguer, comme je le ferai voir.
19. On doit admettre également une grande dif
férence dans la couleur des huiles volatiles. Il en eft
qui n'en ont point ou qui n'en ont qu'une légèrement
citrine,.comme celle d’anis,& la plupart de
celles qu’on extrait fans feu des écorces des fruits.
Laplupart font d’un jaune plus ou moinsprononcé,
comme celle de lavande officinale, celle de grande
lavande, qu'on nomme huile d3afpic , lavandula,
fipica , & un grand nombre d'autres ; quelques-
unes d’un jaune ^ foncé rouge ou brun , ainfi
que les huiles de canelle> de' girofie , de bois de
Rhodes, &c. ; plufieurs font bleues comme celle
de camomille, vertes comme celle du perfil, d'un
vert bleu ou glauque comme celle de mille-pertuis
: quelques-unes, obtenues bleues au moment
de leur diftillation , deviennent enfuite rouges par
le laps de tems , ainfi qu'on l'obferve pour Yhuile
diftillée du galbanum , &c. En général, la couleur
citrine &. la rougeâtre font les deux dominantes
dans les huiles volatiles, c'eft toujours à l’une ou
à l’autre de ces nuances qu'elles s’arrêtent.
20. La faveur d^s huiles volatiles eft prefqueconr-
tamment âcre, piquante, chaude & même brûlante:
quelques-unes néanmoins n’en ont qu'une
très-foible. Souvent des matières végétales très-
âcres & très-amères ne donnent point d’huile qui
ait cette qualité, comme on le voit pour celle du
poivre & de l’abfinthe. Quand on met une feule
goutte d3huile volatile fur la langue, elle y produit
le fentiment d’une brûlure 8c d’une irritation très-
forte. Quelquefois même ce fentiment fe propage
& s’étend dans la gorge, dans l’oefophage & jufqu’à
l’eftomac, par une ivnpreffion de chaleur & d’âçreté
qui excite, chez les perfonnes délicates & ner-
veufes, des mouvemens, des borborygmes, des
rots, des. naufées, de la foib’leffe, du mal-aife.
Souvent cette fc.ène , toute due à l'aCtion ner-
veufe , fe termine même par des évacuations. Auffi
les médecins, en rangeant cette matière parmi les
âcres prefque cauftiques quand elle agir en maffie,
l’ont-ils regardée, lorfqu’elle n’eft preferite qu’en
proportion très-légère & étendue dans un grand
véhicule, comme un ftimulant, un irritant plus ou
moins aCtif, Son effet fe fait promptement fende
Ch im i e . Tome IV.
H U I 537
fur des organes fort éloignés du lieu où Yhuile vo- ,
latile eft appliquée : c’eft ainfi qu'elle fait contracter
rapidement à l'urine une odeur forte, fouvent
agréable , analogue à celle de l'iris ou de la violette.
C eft par un principe analogue que l'afperge
lui communique, à ce qu'il paroît, une fétidité
infupportable.
21. En général, Yhuile volatile a une pefanteur
fpécifique plus légère que celle de l'eau , & nage,
comme on le fait, à la furface de ce liquide. Cependant
celles de girofle, de canelle & de faflafras
vont au deffous de l'eau: il ne faut pas en conclure,
comme on le faifoit autrefois, que les huiles des
plantes exotiques, de l'Inde furtout, font généralement
plus pefantes que l’eau, puifquecell.s de
macis, de mufeade, de poivre, aecubèbes, de
cardamome font plus légères que ce. liquide. En
général, la pefanteur des huiles volatiles, plus légères
que l'eau, eft à celle de ce liquide, comme
8697.8938.99io font à 10000. Celle des plus lourdes
eft au contraire comme 10363 ou 10439 eft à
10000. .
22. Il faut joindre à l’énoncé de ces caraélères
ou de ces propriétés phyfiques, celui des falfifica-
tions ou des fophiftications qu'on fe permet trop
fouvent fur ces huiles : c'eft prefque toujours avec
des huiles fixes inodores ou avec Yhuile de térébenthine
, la plus commune & la moins chère de ces .
matières, qu’on étend & qu'on alonge .les huiles
volatiles les plusprécieufes. En frottant un papier
fin qui s*en imprègne promptement, on reconnoît
une huile volatile fophiftiquée avec une huile fixe ,
en ce que la portion de la première étant volati-
lifée , il refte fur le papier une tache huileufe,
formée par Yhuile fixe qui ne fe volatilife pas de la
même manière. Quant à celles qui font mêlées
d'huile de térébenthine , on les diftingue par l'odeur
très-cara&érifée de cette dernière, qui fubfifte plus
ou moins long tems après la volatilisation de l'autre.
Le feul frottement dans les mains fuffit fouvent
pour diftinguer à l'odeur l'une & l’autre de ces
fophiftications. Il eft plus difficile de reconnoître
les mélanges des huiles volatiles, analogues les unes
aux autres, par leur odeur, leur confiftanee & leur
couleur ; mais ceux-ci font plus rares & moins frauduleux.
Si elles font mêlées d'alcool, on reconnoît
facilement la fraude en les jetant dans de l’eau qui
y produit un précipité blanc laiteux, très-abondant.
23. D'après ce qui a été expofé dans les deux
articles précédens fur les propriétés chimiques des
huiles fixes, il n’.eft plus néceffaire ici quë de comparer
feulement aux premières les huiles volatiles,
& d'infifter fur les différences qui exiftent entre ces
deux genres de corps. Il eft d'abord évident que la
première différence qui les caraétérife & que leur
nom exprime, c’eft qu’elles doivent être infiniment
plus difficiles à décompofer par le feu, que les huiles
fixes. Elles fe réduifent fi promptement & fi facilement
en vapeur, qu’il eft prefqu'impoffible d'en
opérer ainfi la décompofition. Cependant en les
y y y