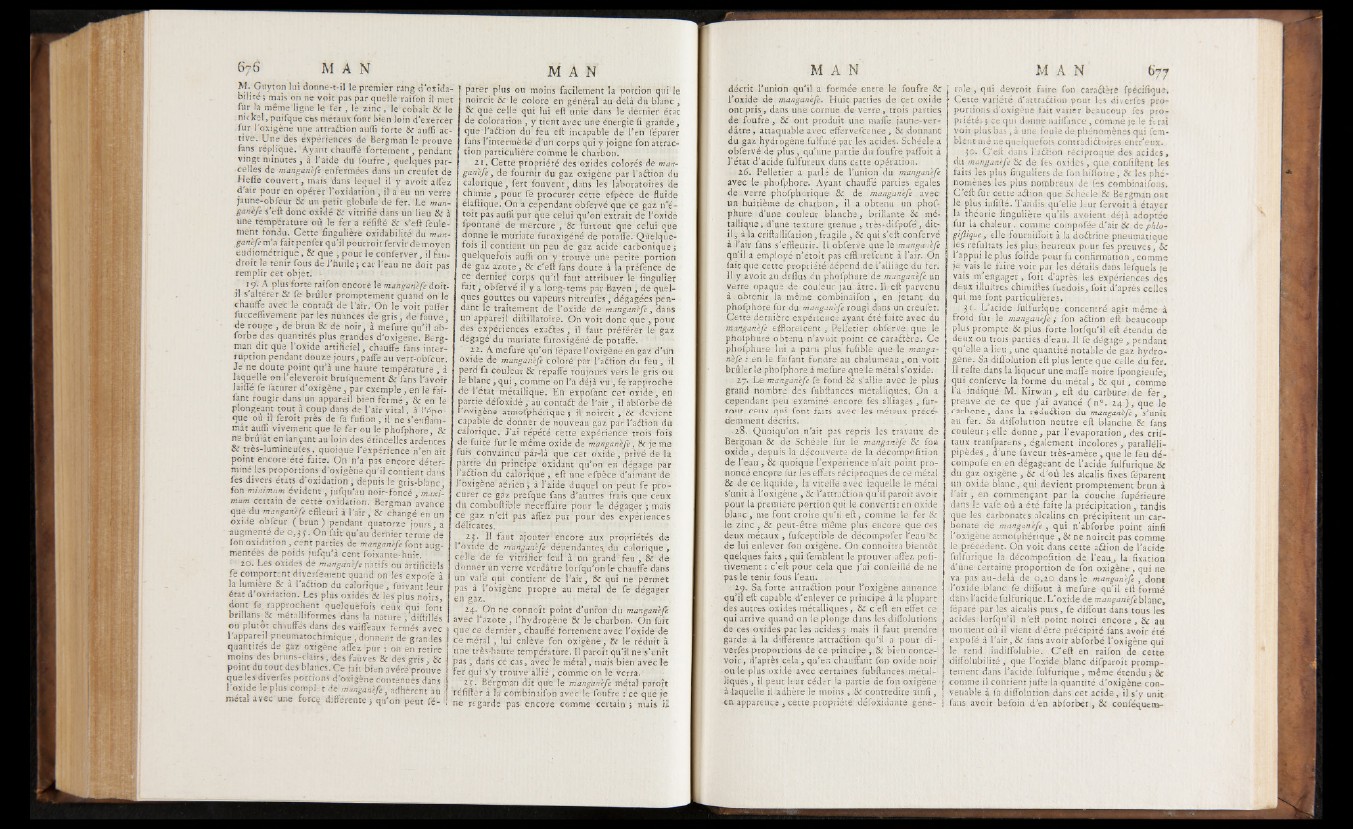
M. Guyton lui donne-t-il le premier rang d’oxida-
bilité; mais on ne voit pas par quelle raifoh il met
fur la même ligne le fer , le zinc , le cobalt & le
nickel, puifque cès métaux font bien loin d'exercer
fur l'oxigène une attraction aufli forte 8c au (fi active.
Une des expériences de Bergman le prouve
fans réplique. Ayant chauffé fortement, pendant
vingt minutes, à l'aide du foufre, quelques parcelles
de manganefe enfermées dans un creufet de
Helfe couvert, mais dans lequel il y avoit aflez
d’air pour en opérer l’oxidation, il a eu un verre
jaune-obfcur & un petit globule de fer. Le manganefe
s'ëft donc oxidé & vitrifié dans un lieu & à
une température où le fer a réfifté & s'eft feule- j
ment fondu. Cette fingulière oxidàbiîité du manganefe
m’a fait penfer qu'il pourroit fervir de moyen
eudiométrique, & que , pour le conferver, il fau-
droit le tenir fous de l'huile ; car l'eau ne doit pas
remplir cet objet. -
19. A plus forte raifon encore le manganefe doit-
il s'altérer & fe brûler promptement quand on le
chauffe avec le conta# de l ’air.On le voit pàfler
fucceflivement par les nuances de gris, de fauve, :
de rouge, de brun & de noir, à mefure qu'il ab-
forbe des quantités plus grandes d'oxigène. Bergman
dit que l'oxide artificiel, chauffe fans interruption
pendant douze jours, paffe au vert-obfcur.
Je ne doute point qu'à une haute température, à
laquelle onl'éleveroit brufquement & fans lavoir
laiffé fe faturer d’oxigène, par exemple, en le faisant
rougir dans un appareil bien fermé, & èn le
plongeant tout à coup dans de l’air vital, à fépoque
où il' feroit près de fa fufion, il ne s'enflammât
aufli vivement que le fer ou le phofphore, &
ne bruiat en lançant au loin des étincelles ardentes
& très-lumineufes, quoique l'expérience n'en ait
point encore été faite. On n'a pas encore déterminé
les proportions d’oxigène qu’il contient dans
fes divers états d'oxidation , depuis le gris-blanc
fon minimum évident, jufqu'au noir-foncé , maximum
certain de cette oxidation. Bergman avance
que du manganefe effleuri à l'air, & changé en un
oxide obfcur (brun) pendant quatorze jours,a
augmenté de 0,3 y. On lait qu’au dernier terme de
fon oxidation, cent parties de manganefe font augmentées
de poids jufqu’ à cent foixante-huit. .
2.0. Les oxides de manganefe natifs ou artificiels
fe comportent diverfement quand on les expofé à
la lumière & à l’aclion du calorique, fuivant leur
état d'oxidation. Les plus oxidés 8c les plus noirs,
dont fe rapprochent quelquefois ceux qui font
brillansjk métalliformes dans la nature, dift illés
ou plutôt ch tuffes dans des vaifleaux fermés avec
1 appareil pneumatochimique , donnent de grandes
quantités de gaz oxigène aflez pur : on en retire
moins des bruns-clairs, 'des fauves & des gris, &
point du tout des blancs. Ce fait bien avéré prouve
que les diverfes portions d'oxigène contenues dans •
1 oxide le plus compj .t de manganefe, adhèrent au ■
métal avec une force différente 5 qu'on peut fé- ;
parer plus ou moins facilement la portion qui le
noircit & le colore en général au delà du blanc,
& que celle qui lui eft unie dans le dernier état
de coloration , y tient avec une énergie fi grande,
que l'a#ion du feu eft incapable de l'en féparer
làns l'intermède d'un corps qui y joigne fon attraction
particulière comme le charbon.
21. Cette propriété des oxidès colorés de manganefe
3 de fournir du gaz oxigène par l’a#ion du
calorique, fert fouvent, dans les laboratoires de
chimie , pour fe procurer cette efpèce de fluide
élaftique. On a cependant obfervé que ce gaz n'é-
toit pas aufli pur que celui qu'on extrait de l'oxide
fpontané de mercure , 8c furtout que celui que
donne le muriate furoxigéne de potafle. Quelquefois
il contient un peu de gaz acide carbonique j
quelquefois aufli on y trouve une petite portion
de gaz azote, & c'eft fans doute à la préfence de
ce dernier corps qu'il faut attribuer le fingulier
fait, obfervé il y a long-tems par Bayen , de quelques
gouttes ou vapeurs nitreufes, dégagées pen-
dant le traitement de l'oxide de manganefe, dans
un appareil diftillatoire. On voit donc que, pour
des expériences exactes, il faut préférer le gaz
dégagé du muriate furoxigéné de potafle.
22. A mefure qu'on fépare Voxigène en gaz d’un
oxide de manganefe coloré par l'a#ion du feu, il
perd fa couleur & repafie toujours vers lé gris ou
le blarrc, qui, comme on l'a déjà vu , fe rapproche
de l'état métallique. En expofant cet oxide, en
partie défoxidé, au conta# de l’air , il abforbe dé
î'oxigène atmosphérique 5 il noircit , & dévient
capable de donner de nouveau gaz par l’a#ion du
calorique, j ’ai répété cette expérience trois fois
dë fuite fur le même oxide de manganefe, & je me
i fuis convaincu par-là que cet oxide, privé de la
partie du principe oxidant qu’on en dégage par
1 à#ion du calorique , eft Une efpèce d’aimant de
1 oxigène aérien > à l'aide duquel on peut fe procurer
ce gaz prefque fans d’autres frais que ceux
du combuftrble néceffaire pour te dégager } mais
cè gkz n’eft pas aflez pur pour des expériences
délicates.
23. Il faut ajouter encore aux propriétés de
l'oxide de m'àngànefe dépendantes, du Calorique,
celle de fe vitrifier feiil à un grand feu , 8c de
donner un verre verdâtre lorfqu’on le chauffe dans
un valè qui contient de l’air, & qui ne permet
pas à I'oxigène propre au métal de fe dégager
en gaz.
24. On ne connort point d’union du manganefe
avec l'azote, l'hydrogène & lecharbon. On fait
que ce dernier, chauffé fortement avec l’oxide de
ce métal , lui enlève Ton oxigène, 8c le réduit à
une très-haute température. Il parort qu'il ne s’unit
pas , d^ns ce cas, avec le métal, mais bien avec te
fer qui s’y trouve allié, comme on le Verra.
2y. Bergman dit que le manganefe métal parort
réfifter à la combinaifon avefc'le foufre : ce que je
ne regarde pas encore comme certain > mais iJi
décrit 1*union qu'il a formée entre le foufre &
l'oxide de manganefe. Huit parties de cet oxide
ont pris, dans une cornue de-verre, trois parties
de foufre, 8c ont produit une mafle jaune-verdâtre
, attaquable avec effervefcenee, & donnant
du gaz hydrogène.fulfuré par lés acides. Schéele a
obfervé de plus, qu'une partie du foufre pafloit à
l’état d’acide fulfureux dans cette opération.
26. Pelletier a parlé de l’union du manganefe
avec le phofphore. Ayant chauffé parties égales
de verre phofphorique & de manganefe avec
un huitième de charbon, il a obtenu un phof-
phure d’une couleur blanche, brillante 8c métallique,
d’une texture'grenue , très-difpofé, dit-
il} à la criftallifation, fragile , & qui s’eft confervé
à l’air fans s’effleurir. Il obferve que le manganefe
qu’il a employé n’étoit pas efflorefcent à l’air. On
fait que cette propriété dépend de l’aiiiage du fer.
Il y avoit au deffus eu phofphure de manganefe un
verre opaque de couleur jaunâtre. Ik eft parvenu
à.obtenir la même combioaifon , en jetant du
phofphore fur du manganefe rougi dans un creufet.
Cette dernière expérience ayant été faite avec du
manganefe efflorefeent, Pelletier obferve que le
phofphuré obtenu n’avoir point ce cara#ère. Ce
phofphure lui a paru plus fufible que le manganefe
: en le faifant fondre au chalumeau, on voit
brûler le phofphore à mefure que le métal s’oxide;
27. Le manganefe fe fond & s’allie avec le plus
grand nombre des fubftances métalliques. On a
cependant peu examiné encore fes alliages, fur-
tout ceux qui font faits avec les métaux précédemment
décrits.
• 28. Quoiqu’on n’ait pas repris les travaux de
Bergman & de Schéele fur le manganefe 8c fon
oxide, depuis la découverte de la décompofition
de l’eau, & quoique l’expérience n’ait point prononcé
enepre fur les effets réciproques de ce métal ;
& de ce liquide, la viteffe avec laquelle le métal
s’unit à I’oxigène , & l’attra#ion qu’il paroît avoir
pour la première portion qui le convertie en oxide
blanc, me font croire qu’il eft, comme le fer &
le zinc, & peut-être même plus encore que ces
deux métaux , fufceptible de décompofer l’eau 8c
de lui enlever fon oxigène. On connoïtra bientôt
quelques faits, qui femblent le prouver aflez pofi-
tivement : c’eft pour cela que j’ai confeillé de ne
pas le tenir fous l’eau.
29. Sa forte attra#ion pour I’oxigène annonce
qu’il eft capable, d’enlever ce principe à k plupart
des autres oxides métalliques, & c'eft en effet ce
qui arrive quand on le plonge dans les diftolutions
de ces oxides par les acides } mais il faut prendre
garde à la différente attra#ion qu’il a pour diverfes
proportions de ce principe , & bien concevoir
, d’après cela, qu’en chauffant fon oxide noir
ou le plus oxidé avec certaines fubftances métalliques
, il peut leur céder la partie de fon oxigène ■
à laquelle il.adhère le moins, 8c contredire ainfi ,
en apparence, cette propriété défoxidante généraie
, qui devroit faire fon cara#ère fpécifique.
Cette variété d’attra#ion pour les diverfes proportions
d’oxigène fait varier beaucoup fes propriétés
5 ce qui donne naiflance , comme je le ferai
voir plus bas, à une foule de phénomènes qui fem-
bient même quelquefois contradi#oires entr’eux.
30. C’eft dans l'a#ion réciproque des acides,
du manganefe 8c de fes oxides, que confiftent les
faits les plus finguliers de fon hiftoire, & les phénomènes
les plus nombreux de fes combinaifons.
C'eft fur cette a#ion que Schéele & Bergman ont
: lé plus infifté. Tandis qu’elle leur fervoit à étayer
la théorie fingulière qu’ils avoient déjà adoptée
; fur la chaleur, comme compofée d’air & dephlo-
giftique3 elle fournilfoit à Ja do#rine pneumatique
; les réfuitats les plus heureux ptmr fes preuves, &
; l’appui le plus folide pour fa confirmation , comme
je vais le faire voir par les détails dans lefqueis je
vais m’engager , foie d’après les, expériences des
deux illuftres chimiftes fuédois, foit d’après celles
qui me font particulières.
31. L’acide fulfurique concentré agit même à
froid fur le manganefe ; fon a#ion eft beaucoup
plus prompte & plus force lorfqu’il eft étendu de
deux ou trois parties d’eau. Il fe dégage pendant
qu’elle a lieu, une quantité notable de gaz hydrogène.
Sa difïblution eft plus lente que celle du fer.
Il refte dans la liqueur une mafle noire fpongieufe,
qui conferve la forme du métal, & qui, comme
La indiqué M. Kirwan „ eft du carbure, de fer ,
preuve de ce que j'ai avancé ( n°. 2 4 ) , que le
. carbone, dans la rédu#ion du manganefe, s'unit
au fer. Sa diflolution neutre eft blanche & fans
couleur} elle donne, par l'évaporation, des crif-
taux tranfparens , également incolores , parallélépipèdes,
d’une faveur très-amère, que le feu dé-
compofe en en dégageant de l’acide fulfurique &
du gaz oxigène , 8c d’où les alcalis fixes féparent
un oxide blanc, qui devient promptement brun à
l’a ir, en commençant par la couche fupérieure
dans le vafe où a été faite la précipitation, tandis
que les carbonates alcalins en précipitent un carbonate
de manganefe , qui n’abforbe point ainfï
I’oxigène atmofphérique, & ne noircit pas comme
le précédent. On voit dans cette a#ion de l’acide
fulfurique la décompofition de l’eau, la fixation
d’iine certaine proportion de fon oxigène, qui ne
va pas au-delà de 0,20 dans le manganefe , dont
l'oxide blanc fe diffout à mefure qu’il eft formé
dans l’acide fulfurique. L'oxide de manganefe blanc,
féparé par les alcalis purs, fe diflout dans tous les
acides lorfqu'il n’eft point noirci encore, 8c au
moment où il vient d’être précipité fans avoir été
expofé à l’air, & fans avoir abforbé I’oxigène qui
le rend .indiflbluble. C'eft en raifon de cette
diffolubilité, que l ’oxide blanc difparoît promptement
dans l’acide fulfurique, même étendu ; &
comme il contient jufte la quantité d'oxigène convenable
à.fa diflolution dans cet acide, il s’y unie
fans avoir befoin d’en abforbër, & conféquem