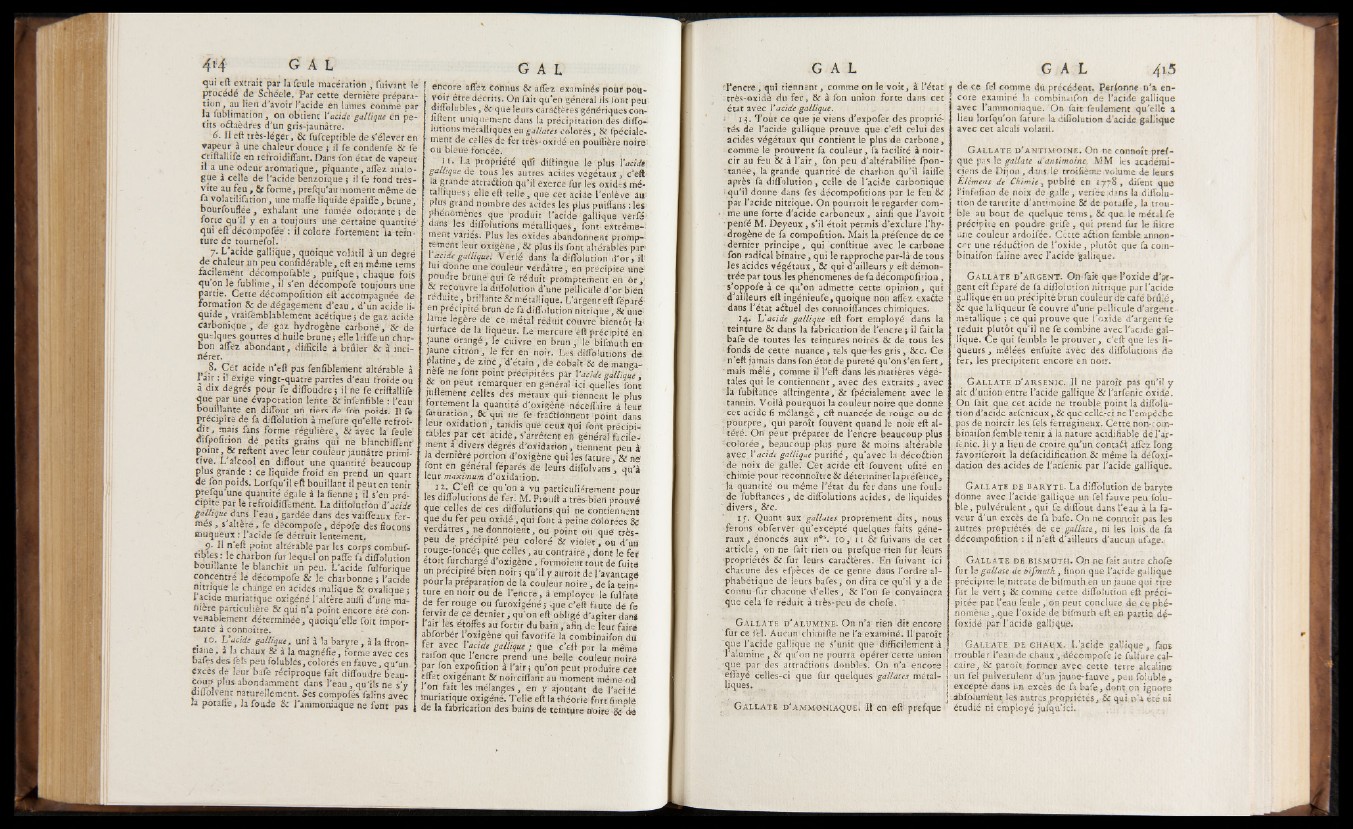
qui eft extrait par la feule macération , fuivànt le
procédé de Scnéele. Par cette dernière préparation
, au lieu d’avoir l'acide en laines comme par
la fublimation , on obtient Yacide gallique en petits
oétaèdres d'un gris-jaunâtre. 6. Il eft très-léger, & fufceptible de s'élever en
vapeur à une chaleur douce ; il fe condenfe & fe
çriftallife en refroidiffant. Dans fon état de vapeur
il a une odeur aromatique, piquante, affez analogue
à celle de l’acide benzoïque ; il fe fond très-
vite au feu, & forme, prefqu'au moment même de
fa volarilifation, une malle liquide épaiffe, brune,
bourfouflée, exhalant une fumée odorante; de
forte qu'il y en a toujours une certaine quantité';
qui eft décômpofée : il colore fortement ia-tefn- j
tUfe de tournefol.
7. L'acide gallique, quoique volatil à un degré
de chaleur un peu confidérable, eft en même tems
facilement décompofable, puifque, chaque fois
qu on le fublime , il s'en décompofe toujours une
partie. Cette décompofïtiôn eft accompagnée de
formation & de dégagement d'eau, d’un acide liquide
, vraifembhblement acétiques de gaz acide
Carbonique , de gaz hydrogène carboné, & de
quelques gouttes d’huile brune, elle liiffe un charbon
allez abondant, difficile à brûler & à incinérer.
«'?• Ç ét àcide nJeft pas fenlïblement altérable à
Pair : il exige vingt-quatre parties d'eau froide ou
a dix degrés pour fe diffoudre 5 il ne fe criftallife
^ue.Pat üne évaporation lente & infenfible : l’eau
bouillante en diffoùt uri tièrs de fon poids. Il fe
précipité de fa diffolution à mefure qu'elle refroid
it, mais fans forme régulière, & avec la feule
difpofition dé petits grains qai ne blanchiff-nr
point, & refterit avec leur couleur jaunâtre primitive.
L'âîcool en diflout une quantité beaucoup
plus grande : ce liquide froid en prend un quart
de fon poids. Lorfqu’il eft bouillant il peut en tenir
prefqu'une quantité égale à la fienne j il s'en précipite
par le refroidiffement. La diffolutiond’acide
gallique fans l'eau, gardée dans des vailfeaux fermés
, s'altère, fe décompofe, dépofe des flocons
muqueux : l'acide fe détruit lentement.
-2* 11 n e^ P°*nt ^érable par les corps combuf-
tiqîes : le charbon fur lequel on paffe fa diffolution
bouillante le blanchit un peu. L'acide fulfurique
concentré le décompofe & le char bonne j l'acide
nitrique le changé en acides' milïque & oxalique ;
l’acide muriatique oxigéné l’altère auffi d’une manière
particulière & qui n'a point encore été convenablement
déterminée, quoiqu’elle foit importante
â connoître.
. lù - L’acide gallique, uni à la baryte, à fa ftron-
fiâne, a la chaux & a la magnélîe, forme avec ces
bafes des fets peu folublés, colorés en fauve, qu'un
excès de leur bafe réciproque fait diftoudre beaucoup
plus abondamment dans l'èau, qu'ils ne s'y
diftolvent naturellement. Ses compofés faims avec
là pot a lie, la fonde & l’ammoniaque ne font pas
encore allez Cohnus & affez examinés pour pois-
| voir être décrits. On fait qu’en général ils font peu
. diftolubles, âcque leurs cardéîètes génériques con-
!î “ “ ?nt uniquement dans la précipitation des difto-
lutions métalliques en gal/ates colorés, & fpéciale-
ment de celles de fer très^oxidé en pouffière noirô'
ou bleue foncée.
H. La propriété qiîî diftingue le plus Yacide
gallique de tous les autres acides végétaux , c'eft
là grande attraction qu’ il exercé fur les oxides métalliques,
elle eft telles qiie cet acide l’enlève âu
plus grand nombre des acides les plus puiffans : lés
phénomènes que produit l’acide gallique vérfé
dans les diftolutiorts métalliques, font-extrêmement
variés; Plus les oxides abandonnent promptement
leur oxigène, & plus ils font altérables par
Yatide galliqueï Verfé dans la diftolutioh d’o r , il
lui donne une couleur ve'rdâtrèj, en précipite une
poudre brune qui fe réduit promptement eh Or,'
& recouvre la diftolutioh d’une pellicule d’or bien
réduite , brillante & métallique. L’argent eft féparé-
en précipité brun de fa diffolution nitrique , 8c une
lame légère de ce. métal réduit couvre bientôt ta
furrace de la liqueur. Le mercure èft précipité en
(aune orangé, le cuivre en brun, le bifmuth em
jaune citron, Je fer en noir. Les diftolutiorts de
platine, de zinc, d’étain , de cobalt•& dé manga-
nefe ne font point précipitées par Vacide gdllïque ,
& on peut remarquer en général ici quelles font
jhftemenr celles des métaux qui tiennent lé plus
fortement la quantité d'oxigènê nécefluire à leur
faturation, & qui ne fe fractionnent point dans
leur oxidatiotl, tandis- qu'è. Ceux qui font précipitables
par cet atide, s’arrêtent ert général facile-
men’t à divers degrés d'oxidation, tiennent peu à
la dernière portion d'oxigèrie qui lés fature, & ne’
font en général féparés de leurs dilfolvans , qu'à
leur- maximum d’oxidation.
fM ce S I on a vu particuliérement pour
les diffolutions de fer. M. Prouft a très-bien prouvé
que celles de ces diffolutions qui ne contiennent
que du fer peu oxide, qui font a peine colorées
Verdâtres, ne donnoient, ou point ou quë très-
peu de précipité peü coloré & violet , où d'un
rouge-foncé; que celles, au contraire, dont le fetf
étôit furchargé d'oxigènê, formoient tout dé fuite
un précipité bien noir ; qu'il y auroit de l'avantage
pour la préparation de la couleur noire, de la teirU
ture en noir ou de l’encre, à employer le fulfaté
de fer rouge ou furoxigéné ; que c’eft faute dé fe
fervir de ce dernier, qu'on eft obligé d'agiter darti
l'air les étoffes au fortir du bain’ leur fairë
abforbéf loxigène qui favofife la Combinaifon dü
fer avec Yacide gallique ; que c’eft par la même
rai fon que l'encre prend une belle couleur noiré
par fon expofition à l'air j qu’on peut produire cet
effet oxigénant 8c nôirciffant au moment même où
l'on fait les mélanges, en y ajoutant de l'aeiJé
muriatique oxigéné. Telle eft la théorie fort Arnold
de la fabrication des bain* de teinture noire &
iTencre, qui tiennent, comme on le voit, à l'état
très-oxidé du fer, & à fon union forte dans cet
état avec Yacide gallique.
1 13. Tout ce que je viens d’expofer des proprié*
‘ tés de l'acide gallique prouve que c’eft celui des
acides végétaux qui contient le plus de carbone,
comme le prouvent fa couleur, fa facilité à noircir
au feu & à l'air, Ibn peu d’altérabilité fpon-
■ tanée, la grande quantité de charbon qu’il laiffe
après fa diffolution, celle de l'acide carbonique
qu'il donne dans fes décompofitions par le feu 8c
par l’acide nitrique. On pourroit le regarder comme
une forte d'acide carboneux, ainfi que l'avoit
penfé M. Deyeux, s'il étoit permis d'exclure l'hydrogène
de fa compofition. Mais la préfence de ce
dernier principe, qui conftitue avec le carbone
fon radical binaire, qui le rapproche par-là de tous
les acides végétaux, & qui d’ailleurs y eft démontrée
par tous les phénomènes defadécompofttior»,
s'oppofe à ce qu’on admette cette opinion, qui
d'ailleurs eft ingénieufe, quoique non affez exaâe
dans l'état aéluel des connoiffances chimiques.
14. L’acide gallique eft fort employé dans la
teinture & dans la fabrication de l'encre ; il fait la
bafe de toutes les teintures noires & de tous les
fonds de cette nuance, tels que les gris, &c. Ce
n’eft jamais dans fon état de pureté qu’on s'en fert,
■ mais mêlé, comme il l’eft dans les matières végé- :
taies qui le contiennent, avec des extraits, avec
la fubftance aftringentô, & fpécialement avec le 1
tannin. Voilà pourquoi la couleur noire que donne |
cet acide fi mélangé, eft nuancée de rouge ou de '
pourpre, qui paroît fouvent quand le noir eft altéré.
On peut préparer de l'encre beaucoup plus
'colorée, beaucoup plus puré & moins altérable
avecJ'acide gallique purifié, qu'avec la décoétion
de noix de galle. Cet acide eft fouvent ulité en
chimie pour reconnoître&déterminer la préfence,
la quantité ou même l'état du fer dans une foule
de fubftances, de diffolutions acides, de liquides
' divers, &c.
ir . Quarit aux gallatesproprement dits, nous
ferons obfervèr qu'excepté quelques faits généraux
, énoncés aux n°s. 10, 11 & fui vans de cet
article, on ne fait rien ou prefque rien fur-leurs
propriétés &.fur leurs cara&ères. En fuivant ici
chacune des efpècés de ce genre dans l'ordre alphabétique
de leurs bafes, on dira ce qu’il y a de
connu fur chacune d'elles, & l’on fe convaincra :
que cela ïe réduit à très-peu de chofe.
Gallate d'alumine. On n'a rien dit encore;
fur ce lél. Aucun chimifte ne l'a examiné. Il'paroit:
que l’acide gallique ne s'unit que difficilement à
l’alumi-ne, & qu’on ne pourra opérer cette union
que par des attrapions doubles. Ôn n'a encore
effayé celles-ci que fur quelques gallates métal- •
Üques.
Gallate d'ammoniaque! Il en eft- prefque
de ce fel comme dû précédent, Pérfonne n'a encore
examiné la combinaifon de l’acide gallique
avec l'ammoniaque. On fait feulement qu'elle a
lieu lorfqu’on fature la diffolution d’acide gallique
avec cet alcali volatil.
Gallate d'antimoine. On ne connoît prefque
pas le gallate d’antimoine. MM les académiciens
de Dijon , dans, le troifième volume de leurs
Elémens de Chimie, publié en 1778 , difent que
l'infnfion de noix de galle, ver fée dans la diffolution
detartrite d’antimoine 8c de p.otaife, la trouble
au bout de quelque tems, & que. le métal fe
précipite en poudre grijTequi prend fur le filtre
une couleur ardoifée. Cette aPion fembie. annoncer
une réduPion de l’oxide , plutôt que fa combinaison
faline avec facide gallique.
Gallate d'argent. On fait que Loxide d’argent
eft féparé de fa diffolution nitrique par l’acide
gallique en un précipité brun couleur dé café brûlé,
& que la liqueur fe couvre d'une pellicule d’argent
métallique ; ce qui prouve que l’oxide d'argent fe
réduit plutôt qu’il ne fe combine avec l’acide gallique.
Ce qui fembie le prouver, c’eft que les liqueurs,
mêlées enfuite avec des diffolutions de
fer, les précipitent encore en noir.
Gallate d’ar$eniç..,II ne paroît pas qu’il y
aie d’union entre l’acide gallique & l’arfenic oxidé.
On fait que cet acide ne trouble point la diffolution
d’acide arfenieux, & que celle-ci ne l’empêche
pas de noircir les Tels ferrugineux. Cette non-c oui-
binai fon .fçmble tenir à la nature acidifiable dél’ar-
fenic. Il y a lieu de croire, qu’un contap affez long
favpriferoit la défacidification & même la défoxi-
dation des acides de l’arfenic par l’acide gallique.
Gallate de baryte. La diffolution de baryte
donne avec l’aeide gallique un fel fauve peu Colu-
ble, pulvérulent, qui fe. diffout.dans l’eau à la faveur
d’un excès de fa bafe. On ne conncîc pas les
autres propriétés de ce ,gallate, ni les lois de fa
décQtnpofiti.on : il n’eft d’ailleurs d’aucun ufage.
Gallate de bismu-th> On ne fait autre chofe
fur le gallate de hifmutk, fin on que l'acide gallique
précipite le, nitrate de bifmuth en un jaune qui tire
fur le vert ; & comme cette diffolution eft précipitée
par 1,’eau feule, pn peut conclure de ce phénomène
j.que l’oxide de. bifmuth eft en partie dé“
foxidé par l’acide galljque.
Gallate de chaux. L’acide gallique, fans
troubler l'eaii de chaux-, décompofe le fulfure calcaire,
& paroît former avec cette terre alcaline
un fel pulvérulent d’un jaune-fauve, peu foluble^
excepté dans Un excès de fe bafe, dont on ignore
.abfojumleat les autres propriétés, 8c qui;n’a été ni
étudié ni employé julqu’ici.