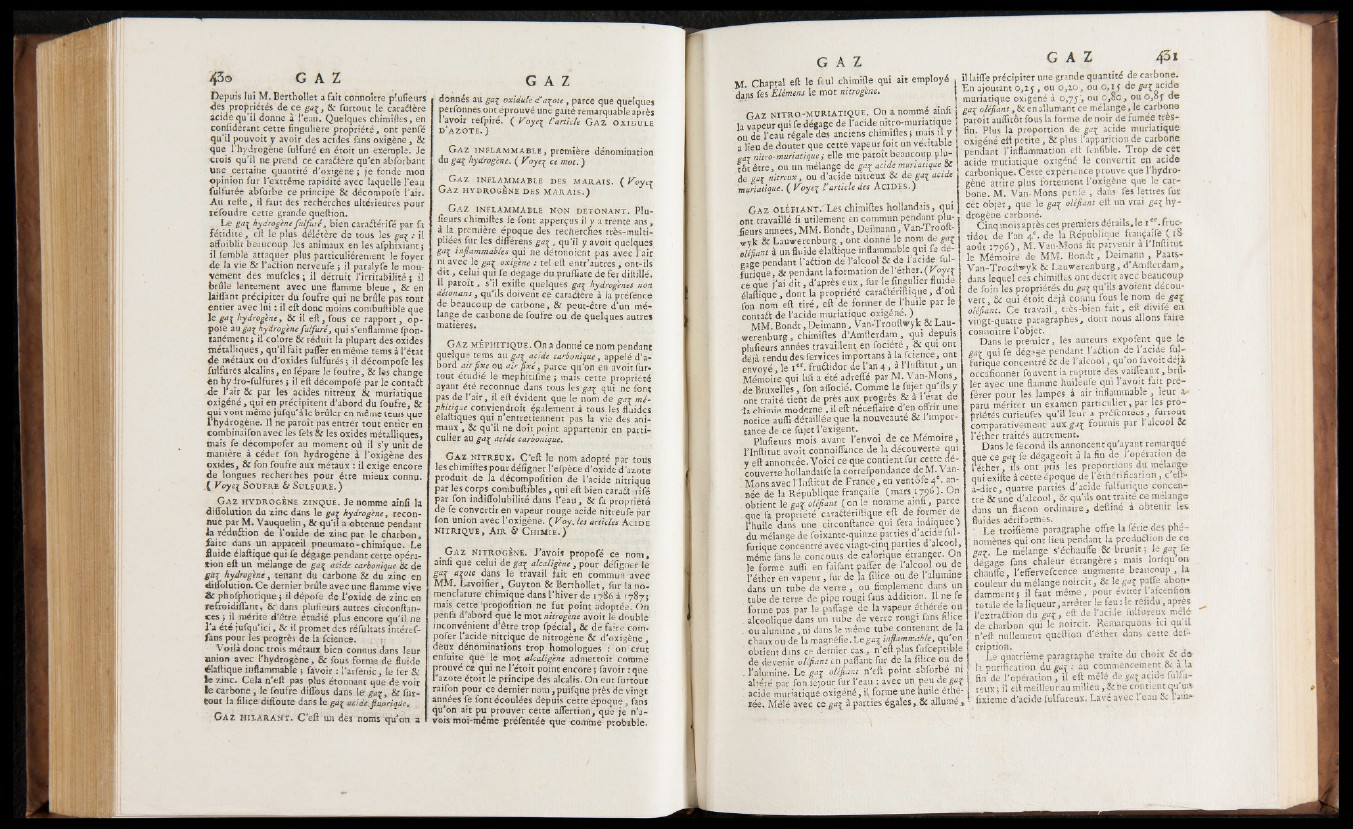
43® G A Z
Depuis lui M. Berthollet a fait connoître plufieurs
propriétés de ce gai, Si furrout le caraêtère
acide qu’il donne à l’eau. Quelques chimiftes, en
confidérant cette fingulière propriété, ont penfé
qu’il pouvoit y avoir des acides fans oxigène, Si
que l'hydrogène fulfuré en étoit un exemple. Je
crois qu’il ne prend ce caraélère qu’en abforbant
une certaine quantité d’oxigène ; je fonde mon
opinion fur l’extrême rapidité avec laquelle l’eau
fulfurée abforbe ce principe & décompofe l’air.
Au relie, il faut des recherches ultérieures pour
réfoudre cette grande queftion.
, Le ga^ hydrogène fulfuré, bien caraétérifé par fa
Fétidité, eft le plus délétère de tous les gaç .- il
affoiblit beaucoup les animaux en les afphixiantj
il femble attaquer plus particuliérement le foyer
de la vie & l’ aélion nerveufe ; il paràlyfe le mouvement
des mufcles ; il détruit l’irritabilité j il
brûle lentement avec une flamme bleue, & en
lailfant précipiter du foufre qui ne brûle pas tout !
entier avec lui : il eft donc moins combuftible que j
le gu; hydrogène, & il eft, fous ce rapport, op-
polë au gai hydrogène fulfuré, qui s’enflamme fpon-
tanément j il-coîore & réduit la plupart des oxides
métalliques, qu’il fait paiTer en même tems à l’état
de métaux ou d’oxides fulfurés; il décompofe les
fulfures alcalins, en répare le foufre, & les change
en hydro-fulfures ; il èft décompofé par le contaél
de l’air & par les acides nitreux Si muriatique
oxigéné, qui en précipitent d’abord du foufre, &
qui vont même jufqu’à le brûler en même tems que
l’hydrogène. 11 ne paroît pas entrer tout entier en
combinaifon avec les fels Si les oxides métalliques,
mais fe décompofer au moment où il s’y unit de
manière à céder fon hydrogène à l’oxigène des
oxides, & fon foufre aux métaux1: il exige encore
de longues recherches pour être mieux connu.
{ V oy ei S o u f r e & S u l f u r e . )
G a z h y d r o g è n e z i n q u é . Je nomme ainfi la
diffolution du zinc dans le gaz hydrogène, reconnue
par M. Vauquelin, Si qu’il a obtenue pendant
la réduétion de l’oxide de zinc par le charbon,
faite dans un appareil pneumato-chimïque. Le
fluide élaftique qui fe dégage pendant cette opération
eft un mélange de gai acide carbonique Si de
gaz hydrogène, tenant du carbone Si du zinc en
dilfolution. Ce dernier brûle avec une flamme vive
& phofphorique ; il dépofe de l’oxide de zinc en
refroidifiant, St dans plufieurs autres circonftan-
ces ; il mérite d’être étudié plus encore qu’il, ne
l’a été jufqu’ic i, Si il promet des réfultats intéref-
fans pour les progrès de la fcience.
Voilà donc trois métaux bien connus dans leur
union avec l’hydrogène, & fous forme de fluide
élaftique inflammable ; favoir : l’arfenic, le fer &
le zinc. Cela n’eft pas plus étonnant que devoir
le carbone, le foufre diffous dans le-gaz, & fur-
tout la Alice dififoute dans le gai acide.fimriqUeK J»
Ga z h ilarant. C ’eft un dès noms qu*bit a
G A Z
donnés au gai oxidule d'aïote, parce que quelques
perfonnes ont éprouvé une gaîté remarquable après
1 avoir refpiré. ( V jjiq l'article Ga z oxidule
d’a zo te .)
Gaz inflammable , première dénomination
du gai hydrogène. ( Voyei ce mot. )
Gaz inflammable des marais. ( Voyei
Gaz hydrogène des marais.)
Gaz inflammable non détonant. Plufieurs
chimiftes fe font apperçus il y a trente ans,
a ja première époque des recherches très-multi-
pliées fur les difrérens gaz , qu’il y avoit quelques
gai inflammables qui ne uétonorent pas avec l'air
ni avec le gai oxigène : te! eft entr’autres , ont-ils
d it, celui qui fe dégage du pruifiate de ferdiltillé.
11^ paroît , s il exifte quelques gai hydrogènes non
détonant, qu’ils doivent ce caractère à la préfence
de beaucoup de carbone, & peut-être d’un mélange
de carbone de foufre ou de quelques autres
matières.
Gaz méphitique. On a donné ce nom pendant
quelque tems au gai acide carbonique, appelé d’abord
air fixe ou air fixé, parce qu’on en avoir fur-
tout étudié le méphitifme j mais cette propriété
ayant été reconnue dans tous les gai qui ne font
pas de l’air, il eft évident que le nom de gai méphitique
conviendrait également à tous les fluides
diadiques qui n’entretiennent pas la vie des animaux
, & qu’il ne doit point appartenir en particulier
au gai acide carbonique.
Gaz nitreux. C ’eft le nom adopté par tous
les chimiftes pour défigner l’efpèce d’oxide d azote
produit de la décompofition de l’acide nitrique
par les corps combuftibles, qui eft bien caraéhrifé
par fon indiffolubilité dans l’eau, & fa propriété
de fe convertir en vapeur rouge acide nitreufe par
fon union avec 1 oxigene. ( J’’oy. les articles Acide
nitrique, Air & Chimie.)
Gaz nitrogène. J’avois propofé ce nom,
ainfi que celui de gai alcalîgene , pour défigner -le
gaq aiçte dans le travail fait en commun'avec
MM. Lavoifier, Guyton Si Berthollet, fur la no-
. menclature chimique dans l’hiver de 1786 à 1787;
mais cette ‘propofition ne fut point adoptée. On
per.fa d abord què le mot nitrogène avoit le double
inconvénient d’être trop fpécial, St défaire fcorn-
pofer l’acide nitrique de nitrogène Si d’oxigène,
deux dénominations trop homologues : on crut
enfuite que le mot alcaligène admettoit comme
prouvé ce qui ne l’étoit point encore j favoir : que
l’azote étoit le principe des alcalis. On eut furtout
raifon pour ce dernier nom, puifqtie près de vingt
années fe font écoulées depuis cette époque, fans
qu’on ait pu prouver cette aflertion, que je n’a-
vois moi-même préfentée que' comme probable.
G A Z
M. Chaptal eft le feul chimifte qui ait employé ,
dans fes Élément le mot nitrogène.
Gaz nitro-muriatique. On a nommé ainfi
la vapeur qui fe dégage de l’acide nitro-muriatique
ou de l’eau régale des anciens chimiftes ; mais il y j
a lieu de douter que cette vapeur foit un véritable j
gai nitro-muriatique; elle me paroît beaucoup plu- j
tôt être, ou un mélange de gfii acide muriatique OC
de gai nitreux, ou d’acide nitreux Si de gai acide
muriatique. ( Voyei l'article des Acides.)
Gaz OLÉFiANT/Les chimiftes hollandais, qui
ont travaillé fi utilement en commun pendant plu-
.(leurs années, MM. Bondt, Deimann, Van-Trooft-
wyk & Lauwerenburg , ont donné le nom de gai j
oléfiant à un fluide élaftique inflammable qui fe de- j
cage pendant FaCtion de l’alcool & de 1 acide ful-
furique, & pendant la formation de l’éther. (Voyez
ce que fai dit, d’après eux, fur le Singulier fluide
élauique, dont la propriété caraétériftique, d’ou
fon nom eft tiré, eft de former de l’huile par le
contaél de l’acide muriatique oxigéné. )
M M .Bondt,Deimann, Van-Trooftwyk & Lau-
werenburg, chimiftes d’Amflerdam, qui depuis
plufieurs années travaillent en fociété, & qui ont
déjà rendu des fervices importans à la fcience, ont
envoyé, le Ier. fruétidor de l’an 4 , à l’Inftitut, un
Mémoire qui lui a été adreffé par M. Van-Mdns,
de Bruxelles, fon affocié. Comme le fujetqu’ ils y
ont traité tient de près aux progrès & à 1 état de
1a chimie moderne, il eft néceffaire d’en offrir une
notice aufli détaillée ^ue la nouveauté & l’importance
de ce fujet l ’exigent.
Plufieurs mois avant l’envoi de ce Mémoire,
l’Inftitut avoit connoiffance de la découverte qui
y eft annoncée. Voici ce que contient fur cette découverte
hollandaife la correfpondance de M. Van-
Mons avec l’Inftitut de France, en ventôfe 4e. an-
. née de la République françaife (mars 1796). On
. obtient le ga1 oléfiant (on le nomme ainfi, parce
. que fa propriété caraCtérifiique eft de former de
l’huile dans une circonftapce qui fera indiquée)
du mélange de foixante-quinze parties d’ acjde ful-
furique concentré avec vingt-cinq parties d alcool,
même fans le concours de calorique étranger. On
le forme aufli en faifant oaffer de l’alcool ou de
l’éther en vapeur, fur de la filice ou de.l alumine
dans un tube de verre, ou Amplement dans un
tube de terre de pipe rougi fans addition. Il ne fe
forme pas par le paffage de la vapeur éthérée ou
. alcoolique dans un tube de verre rougi fans fiuoe
ou alumine ,.ni dans le meme tube contenant de la ,
chaux ou de la magnéfie. Le gai inflammable, qu on
obtient dans ce dernier cas , n’eft plus fufceptible
de devenir oléfiant en paflant fur de la (îlice ou de
. ralumine. Le gai oléfiant n’ell point abforbé ni
altéré par fon.féjour lur l’eau : avec un peu de gai
acide muriatique oxigéné, il forme une huile éthé*
iée.. Mêlé avec ce gai à parties égales allumex
G A Z 43t
il laiffe précipiter une grande quantité de carbone.
En ajoutant 0,2 f , ou 0,20, ou 0,1 y de acide
muriatique oxigéné à 0,75', ou 0,80, ou 0,0y de
gai oléfiant, & en allumant ce mélange, le carbone
paroît auflitôt fous la forme de noir de fumée très-
fin. Plus la proportion de gai acide muriatique
oxigéné eft petite, & plus l’apparition de carborte
pendant l’inflammation eft fenfible. Trop de cét
acide muriatique oxigéné le convertit en acide
carbonique» Cette expérience prouve que l’hydrogène
attire plus fortement l’oxigène que le carbone.
M. Van-Mons penfe , dans fes lettres fur
; cét objet, que le gai oléfiant eft un vrai gai hydrogène
carboné* . . , _
Cinq mois après ces premiers details., le 1 . fructidor
de l’an 4e. de la République françaife Ç18
août 1796), M. Van-Mons fit parvenir a 1 Inftitut
le Mémoire de MM. Bondt, Deimann, Paats-
Van-Trocftwyk & Lauverenburg, d’Amfterdam,
dans lequel ces chimiftes ont décrit avec beaucoup
de foin les propriétés du gai qu’ils avoient découvert,
& qui étoit déjà connu fous le nom de ga%
" oléfiant. Ce travail , très-bien fait, eft divifé eu
vingt-quatre paragraphes, dont nous allons faire
connoître l’objet. .
Dans le premier, les auteurs expofent que le
gai qui fe dégagé pendant 1 aètion de 1 acide fid^
furique concentré & de l’alcool, qu on favoit déjà
occafionner fouvent la rupture des vaifleaux, brûler
avec une flamme huileüfe qui 1 avoit fait préférer
pour les lampes a air inflammable, leur a>"
paru mériter un examen particulier, par les propriétés
curieufes qu’il leur a prefentees, furtout
comparativement aux gai fournis par 1 alcool 8c
| l’éther traités autrement.
Dans le fécond ils annoncent qu’ayant remarqué-
que ce gaz fe dégageoit à la fin de 1 opération de
l’éther, ils ont pris les proportions du mélange
qui exifte à cette époque de l éthérification, c elt-
à-dire, quatre parties d’ acide fulfurique concentré
& une d’alcool, & qu ils ont traite ce mélangé
dans un flacon ordinaire, deftiné à obtenir les.
fluides aériformes.
' Le troifième paragraphe offre laferie des phe-
' nomènes qui ont lieu pendant la production de ce
'gaz. Le mélange s’échauffe 8c brunit j le ga^ te
dégage fans chaleur étrangère} mais lorfqu on
chauffe, l’effervefcence augmente beaucoup, la.
couleur du mélange noircit, & le gai pane abondamment}
il faut même, pour éviter 1 afcenftoti
totale de la liqueur, arrêter le feu : le réfidu, apres
l’extraClion du ga^, eft de l’acide uiltureux mele-
de charbon qui le noircit. Remarquons ici qu il
n’eft nullement queftion d’éthev dans cette description.
. . , , O J
Le quatrième paragraphe traite du choix ce da
' la purification du gai : au commencement & a la
fin de l’opération, il eft mêlé dega^acide fulfu-
reuxj il eft meilleur au milieu, & ne contient qu un
fixieme d’acide fulfureux. Lavé avec l eau & taira*-