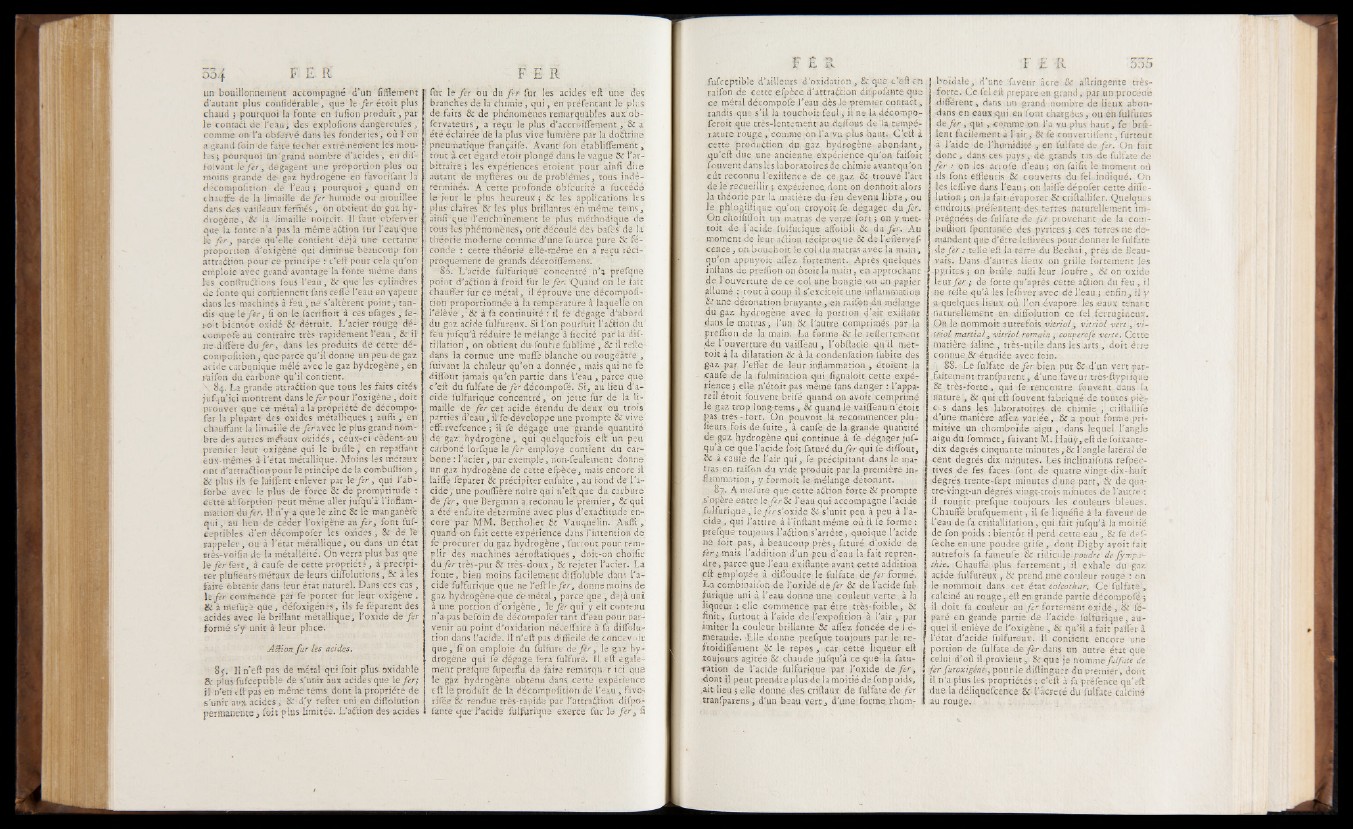
55 4 F E. RT
un bouillonnement accompagné d’un fifflement
d’autant plus confidérabje, que \efer étoit plus
chaud j pourquoi la fonte en fufion produit, par
le contait de l'eau; des explorons dangfereufes,
comme on-fa obfervé dans les fonderies, où K on
a grand foin de faire té cher extrêmement- les moii-
Ls; pourquoi ùn grànd nombre d'acides, eu dil-
folvant le fer , dégagent une proportion plus ou
moins grande de- gai hydrogène en favorifant la
décompofition de l’eau 5- pourquoi, quand on
chauffe de la limaille de fer humide ou mouillée
dans des vai{féaux fermés > on obtient du gaz hydrogène,
6c la limaille noircît-. 11 faut obferver
que la fonte n’a pas la même aétion fur l'eauque
fe fer, parce qu’elle contient déjà une certaine
proportion d’oxigèné qui diminue beaucoup fon
attraction pour ce principe : c’eft pour cela qu’on
emploie avec grand- avantage la fonce même dans
les conffruCtibns fous l’eau, & que les cylindres
de fonte qui contiennent fans ceffe l’eau en vapeur ,
dans les machines à feu, né s’altèrent point y tan- :
dis que le fer, fi on le. fa cri hoir à ces ufages | fe- ;
i-oit bientôt oxidé & détruit. L’acier rouge dé-
compofe au contraire très- rapidement l’eau, & il
ne-diffère du fer, dans les produits de cette dé- ;
compofkion, que parce qu’il donne un peu<de gaz
acide carbonique mêlé avec le. gaz hydrogène, en
j aifon du. carboné qu’il contient.
\ 84. La grande attraction que tous les faits cités
jufqu’ici montrent dans le fer pour l’oxigène , doit
prouver que ce métal a la propriété de décompp-
fer la plupart des oxides métalliques ; attffi , en
chauffant la limaille de ferzvec le plus grand nombre
des autres mét-aùx oxides.* ceux-ci cèdent'au
premier leur exigène qui le brûle, en repayant
eux-mêmes à l ’état métallique. Moins-les- métaux
ont d’attraCtien pour le principe de la combuftion,
& plus ils fe lailfent enlever par le-/«r, qui fab-
forbe avec le plus de force & de promptitude :
cette abforption- peut même aller jufqu’à l’inflammation
du^r. 11: n’y a que le zinc & le manganèfe
qui, au lieu de céder l’oxigène au fer, font fuf-
ceptibles d’en décompofer les oxides , 8c dé le
rappeler, ou à l’état métallique, ou dans un état
très-voifin de la métalléité. On verra plus bas que
\e ferÇext^ à caufe de cette propriété, à prècipi-
rer plusieurs métaux de leurs diffolutions, & à les
faire obtenir dans leur état naturel. Dans ©es cas,
le fer commence par fe porter fur .leur oxigène,
& à meftu-e que, défoxigénés-, ils- fe fëparent des
acides avec le brillant métallique, l’oxide de fer
formé s’y unit à leur place.
Aüionfur les acides.
85. II n’ eft pas de métal qui foit plus, oxidable
& pîus fufceptible de s’unir aux acides que le fer;
il n?eri eft pas en même rems dont la propriété de
s'unir aux acides, & d’y refter uni en diffolütion
permanente, foit plus limitée. L’aCtion des acides
F E R
fur le fer ou du fer fur les acides eft une dès
branches dé la chimie, qui, en préfentant le plus
de faits 8c de phénomènes remarquables aux ob-
fervateurs , a reçu le plus d’accroiffement, 8c a
été éclairée dfe la plus vive lumière par la doctrine
pneumatique ftançàife. Avant fon etabliffement,
tout à cet égard étoit plongé dans le vague Ôc l’arbitraire
; les expériences étoient pour ainfi dire
autant de myftères ou de problèmes, tous indéterminés.
À cette profonde ©bfeurité a fuccédé
le jour le plus heureux; 8c les applications les
plus claires 8c les plus brillantes en même te ms ,
ainft quë d’enchaînement le plus méthodique de
fous les phénomènes, ont découlé des bafe's' de la
théorie moderne comme d’ une fource pure 6c féconde
: cette théorie elle-même en a reçu réciproquement
de grands décroiffemens.
86. L’acide fulfuriquè concentré n’a- préfque
point d’aftion à froid fur le fer. Quand on le fai t
chauffer fur ce métal , il éprouve une décompofi-
tibft proportionnée à la température à laquelle on
l’élève, 8c à fa continuité : il fe' dégage d’abord
du gaz acide fulfureux. Si fon pourfuit l’aètion du
feu jufqu’à réduire le mélange à ficcité par la dif-
tillation, on obtient duToufre fubümé, 8c il relie
dans la cornue une maffe blanche ou rougeâtre ,
fuivant la chaleur qu’on a donnée, mais qui ne fé
diffout jamais qu’en partie dans l’eau, parce que
c’eft du fulfate de fer décompofé. Si, au lieu d’â-
cide fulfuriquè concentré, on jette; fur de la limaille
de fer cet acide étendu de deux ou trois
parties d?eau, if fe-développe une prompte 8c vive
effèrvefcence ; il fe dégage un.e grande quantité
dé gaz hydrogène,, qui quelquefois eft: un peu
carboné lo.rfque le fer employé contient du carbone
: l’acier, par exemple, non-feulement donne
un gaz hydrogéné de cette efpèée, mais encore il
lai fie féparer & précipiter enfuice, au fond de l'acide
y une pouflière noire qui n’eft que du carbure
de fer, que Bergman a;reconnu le premier, 8c qui
a étéenfui te déterminé avec plus cfexaéfitude encore
par MM. Bertholiet 8c Vauquélin. Aufli,
quand on- fait cette expérience dans l’intention de
fe procurer du gaz hydrogène, furtout pour remplir
des machines âéroftatiques, doit-on choifir
du fer très-pur 8c très-doux, 8c rejeter l’acier. La
fonte , bien moins facilement diffoluble dans l’ acide
fulfuriquè que nel’efe lë fer, donne moins de
gaz hydrpgèneque ce métal, parce'que, déjà uni
à une portion d'oxigène, le fer qui1 y eft contenu
n’a-pas befoin de décompofer tant d’eau pour, parvenir
au. point d'oxidation néceffairê à fa diffolütion
dans l’acide. il n’ eft pas difficile de concevoir
que, fîon emploie du fulfure de fer, le gaz hydrogène
qui fe dégage fera ful'fijré. 11, eft également
prefqtie fuperflu. ds faire re.marqu r ici que
le gpz hydrogène obtenu dans,,cette expérience
eft le produit de la décompofition de l'eau, fa va*
rifêé & rendue très-rapide par l’attraêfion difpo-
fante que-l’ acide fulfuriquè exerce fur le fer, fi
| |Ti3\
fufceptible d’ailleurs d'oxidation , &què c’eft en
raifon de cette efpèce d’ attraèfion difpofawte que
ce métal décompofé l’eau dès(le premier contact ,
tandis que s'il la .touchoit fe-u-1, ii ne la décompo-
feroit que très-lentement au deffous de Ta température
royge „'comme on l'a'vu-plus haut. C ’eft à
cette production du, gaz hydrogène abondant,
qu’eft due une ancienne expérience qu’on faifoit
fouvent dans les laboratoires de chimie avant qu 'on
eût reconnu l’exiftence de ce,gaz 6c trouvé l’art
de le recueillir ; expérience, dont on donnoit alors
la théorie par la matière du feu deyen-u libre, ou
Je phtogiftique qu’on croyoit fe dégager du fer.
On choifîffoit un mat ras de verre fort 5 on y met-
toit de l ’acide, fulfuriquè affoibli & du fer. Au
moment:de feur aétion réciproque & de Tcfferyéfi
cence, on. bouchoit le col .du .mat-ras avec la main,
qu’on appuyoit allez fortement.. Après quelques
inftans de preffipn on ô-toit la main, eçi approchant
de l'ouverture de ce col une bougie :o-u un papier
allumé : rout à coup il s’excitoit une inflammation
& une détonation bruyante, en raifon du .mélange
du gaz hydrogène avec la portion 4’air exiflaût
.dans le matras, l’un & l'autre comprimés par la
p re fl j on de la main. La forme le relier rpment
de l’ouyerture du vaiffeau , l’obftacle qu’il met^
toit à la dilatation & à la cpndenfation fubite des
gaz par l’effet de -leur inflammation , étoient la
caufe de la fulmination qui fignaloit cette expérience;
elle n’étoit pas même fans danger : l'appareil
étoit fouvent brifé quand on avoit comprimé
Je gaz trop long-tems, & quand le vaiffeau n’écoic
pas très - fort. On pouvoit la recommencer, plu-
fieurs fois de fuite, à caufe de la.grande quantité
de gaz hydrogène qui continue à fe dégager jufqu’à
ce que l'acide foit fatûré du fer qui fe diffout,
& à caufe de l’air qui, fe précipitant dans le oeà-
tras en raifon du vide produit par.la première inflammation,
y formoit le, mélange détonant.
87. A mefure que cette aCtion forte & prompte
.s’opère entre 1 e ferfte. l’eau qui accompagne l’acide
fulfuriquè,le fer s’oxide & s’ unit peu à peu à l’acide
, qui l’attire à l'inftant même où ij fe forme :
prefque toujours l'aCtion s’arrête, quoique l’acide
ne foit pas , à beaucoup près , faturé d’oxide de
fer,*-mais l’addition d’un peu d’eau la fait reprendre,
parce que l’eau exiftante avant cette addition
eft employée à d-iffoudre; le jfulfate de fer formé.
La combinaison de l’oxide de. fer & de l’acide ful-
furique uni à l’eau donne une couleur verte . à la
liqueur : elle commence par être très-foible, &
finit, furtout à l’aide de-l’expofition à l’air, par
imiter la couleur brillante 8e affez foncée de 1 e-
meraude. -Elle donne prefque toujours par Je re-
froidiffement & le repos, car cette liqueur eft
toujours agitée & chaude jufqu’à ce que la fatu-
ration de l’acide fulfuriquè par l’oxide de fer >
•dont il peut prendre plus de la mo-itié de. fon poids,
,ait lieu ; elle donne des criftaux de fulfate de-fer
tranfparens, d’un beau vert, d'une forme, rhom-
F £ R 555
! boïdale, d’une faveur âcre & aftringente très-
forte. Ce fel eft préparé en grand, par un procédé
différent, dans un grand nombre de lieux abon-
dans en eaux.qui en font chargées , ou èh fuifures
de fe r, qui, co.rame .on l’a vu plus haut, fe brûlent
facilement à l’air., & le convertiifent, furtout
■ à j ’aide de l’humidicé .., en fulfate de fer. On fait
donc, dans ces pays, de. grands tas de fulfate de
fer : on -les arrofe d’eau; on fai fit le moment où
ils. font effieuris 8e couverts du fel indiqué. On
les leflive dans l’eau ; on laiffe dépofer cette diffe-
lution; on la fait évaporer & criftallifer. Quelques
endrojts. préfentant des.terres naturellement imprégnées
.de fulfate de /^ provenant de la com-
bnffion fpéntanée des pyrices ; ces terres ne demandent
que d’ être leflrvées pour donner le fulfate
de fer / .telle'eft la terre du Bêchai, près de Beauvais.
Dans d’autres lieux on grille fortement les
-pyrites > on brûle suffi leur foufre, 6c on oxide
leur fer ; de forte qu’après cette aéiion du feu , il
ne refte qu’à les leflïver avec dé l’eau ; enfin , il y
# quelques lieux.où l’on évapore les eaux tenant
naturellement en diffolütion ce fel .ferrugineux.
On le nommoit autrefois..vkriof, variai vert vi-
itrial martial., vitriol romain, couperofe verse. Cette
matière faline , très-utile dans les arts, doit être
connue,8f étudiée avec foin.
; 88. Le fulfate de fer. bien pur & d’un vert parfaitement
tranfparent, d’une, fave u r .très-ftypt ique 6c très-forte, qui fe rencontre fbuvsent. dans la
nature , & qui eft fouvent fabriqué de toutes pièces.
dans les laboratoires de chimie , criftallife
d’une manière affez variée, & a pour forme primitive
un rhomboïde aigu, dans lequel l’angle
aigu du fommet, fuivant M. Haiiy, eft de foixante-
dix degrés cinquante minutes,& l'angle latéral de
cent degrés dix minutes. Les inclin ai fons refpec-
tives de fes faces font de quatre vingt-dix-huit
degrés.trente-fept minutes d une part, & de quatre
vingt-un degrés vingt-trois minutes de l ’autre :
il rougit prefque toujours les couleurs bleues.
Chauffé brufquement, il fe liquéfie à la faveur de
Beau de fa criftallifation, qui fait jufqu’à la moitié
de fon poids : bientôt il perd cette eau , & fe def-
fèche en une poudre grife, dont Digby avoit fait
autrefois fà fameufe 6c ridicule-poudre de Jymp.;-
thie. Chauffé; plus fortement, il exhale du gaz
acide fulfureux , & prend une couleur rouge : on
le nommoit dans cet état colçothar. Ce fulfate,
calciné au rpuge, eft en grande partie décompofé ;
il doit fa couleur au fer fortement oxidé, & fé-
paré en grande partie de l’acide fulfuriquè, auquel
il enlève de i’oxigène , 8e qu’il a fait paffer à
l’état d’acide fulfureux. Il contient encore une
portion de fulfate >de‘ fer dans un autre état que
celui d’où il provient, 6c que je nomme fulfate de
fer faroxigénr-, pour le diftinguer du premier, dont
il n'a plus les propriétés : c’eft à fa prëfence qu’eft
due la déliquefcence 8e l’-àcreté du fulfate calciné
au rouge.