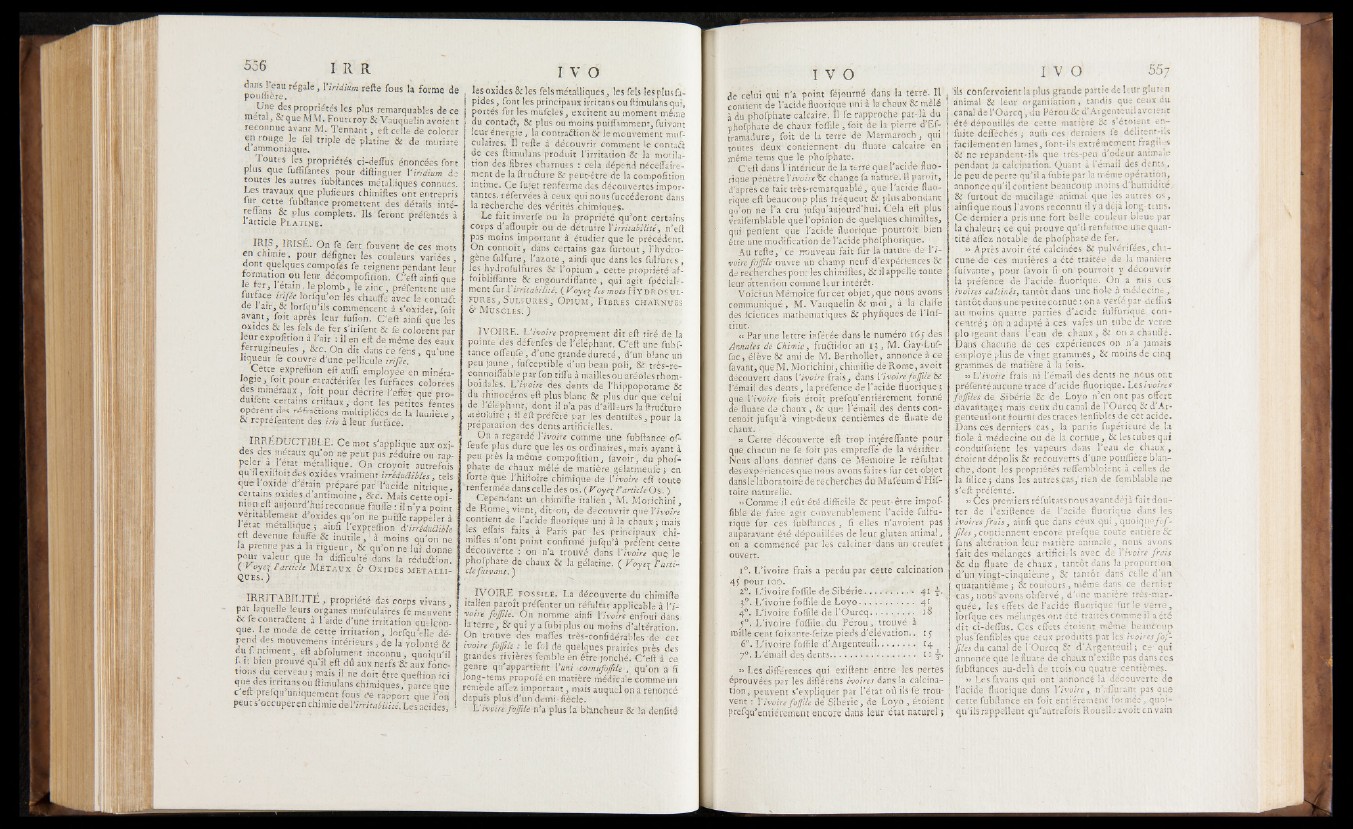
556 i r r
dans 1 eau régale, l'iridium refte fous la forme de
poumère.
Une des propriétés les plus remarquables de ce
métal, & que MM. Fourcroy & Vauqueün avoient
reconnue avant M. Tennant, eft celle de colorer
en rouge le fel triple dé platine & de muriate
d ammoniaque.
Toutes les propriétés ci-deffus énoncées font
plus que fuffifantes pour diftinguer Y iridium de
toutes les autres fubftances métalliques connues.
Les travaux que plufieurs chimiftes ont entrepris
lur cette fubftance promettent des détails inté-
rellans & plus complets. Ils feront préfentés à
I article Platlne.
IRISÉ. On Te fert fouvênt de ces mots
en chimie, pour défigner les couleurs variées,
dont quelques compofés fe teignent pendant leur
formation ou leur décompofition. C'eft ainfi que
Je ter, 1 étain . Je plomb, le zinc, préfentent une
iurtace infee lorfqu’orHes chauffe avec le contai;
de 1 air, & lorftju'ils commencent à s’oxider, foit
avant, foit apres leur fufion. C'eft ainfi quë les
oxides & les Tels de fer s’irifent & fe colorent par
*?ur expofition à I air : il en eft de même des eaux
rerrugineufes , &c. On dit dans ce fens, qu'une
liqueur fe couvre d'une pellicule irifée.
Cette expreffion eft .suffi employée en minéra-
pour caraétérifer les furfaces colorées
des_mmeràux, foit pour décrire l'effet que pro-
duifent certains criftaux, dont les petites fentes
opèrent des réfta&ions multipliées de la lumière
& repréfentent des iris à leur furface. J
IRRÉDUCTIBLE. Ce mot s'applique aux oxj-
des des métaux qu'on ne peut pas réduire ou rap-
peler a 1 état métallique. On croyoit autrefois
qu il exiftoitdes brides vraiment irréduftibies, tels ;
qife l oxidè d étain préparé par l'acide nitrique ,
certains oxides.d’antimoine, & c . Mais cette opinion
eft aujourd’hui reconnue fauffe : il n'y a point
véritablement d'oxides qu’on ne puiffe rappeler à
Jetât métallique ; ainfi l’expreffîon irréductible
eft devenue fauffe & inutile, à moins qu'on ne
la prenne pas à la rigueur, & qu’on ne lui donne
pour valeur que la difficulté dans la réduction.
( Voye^Farticle MÉTAUX & OxiDES MÉTALLIQUES.)
IRRITABILITÉ, propriété des corps vivans,
par laquelle leurs organes musculaires fe meuvent
& fe contractent a l'aide d’une irritation Quelconque.
Le mode de cette irritation, lorfqu’elle dépend
des mouvemens intérieurs, de la volonté &
du intiment, eft abfolument inconnu , quoiqu'il
f n bien prouvé qu'il eft dû aux nerfs & aux fonctions
du cerveau ; mais il ne doit être queftion ici
que des îrritans ou ftimulans chimiques, parce que
c eft prefqu'uniquement fous dé rapport que Loti
peut s occuper en chimie à&Y irritabilité. Les acides,
I V O
les oxides & les fels métalliques, les Tels les plus fa-
pides, font les principaux irritans ou ftimulans qui,
portés fur les mufcles, excitent au moment même
du contaét, & plus ou moins puiffammenr, fuivant
leur énergie, la contraction & le mouvement muf-
culaires. Il refte à découvrir comment le contaCt
de ces ftimulans produit l’irritation & la motila-
tion des fibres charnues : cela dépend néceffaire-
ment de la ftruCture & peut-être de la compofition
intime. Ce- fujet renferme des découvertes importantes.
réfèrvées à ceux qui nous fuccéderont dans
la recherche des vérités chimiques.
Le faitiriverfe ou la propriété qu'ont certains
corps d'affqupir ou de détruire Y irritabilité;, n'eft
pas moins important à étudier que le précédent.
On connoït, dans certains gaz furtout, l'hydrogène
fulfuré, l'azote, ainfi que dans lès fulfures,
les hydrofulfures & l'opium , cette propriété af-
foibliffanre & engourdiffante, qui agit fpéciak-
ment fur .1 irritabilité. ( Voyeç les mots Hy £>ROSULFURES,
Sulfures, Opium, Fibres charnues
& Muscles. )
IVOIRE. Vivoire proprement dit eft tiré de la
pointe des défenfes de l'éléphant. C'eft une fubftance
offeufe, d’une grande dureté , d’un blanc un
peu jaune , fufceptibfe d'un beau poli, 8c très-re-
connoiffable par fon tiffu à mailles ou aréoles rhom-
boïdales. Vivoire des dents de l’hippopotame &
du rhinocéros eft plus blanc & plus dur que celui
de l eléphmr, dont il n’a pas d'ailleurs la ftructure
aréolaire ; il eft préféré par les dentiftes, pour la
préparation des dents artificielles.
On a regardé Yivoire comme une fubftance offeufe
plus dure que les os ordinaires, mais ayant à
peu près la même compofition, favoir, du phof-
phate de chaux mêlé de matière gélatineufe ; en
forte que l’hiftoire chimique de Yivoire eft toute
'renfermée dans celle des os. ( Voye^ Varticle Os . )
Cependant un chimiftè italien 3 M* Morichini,
de Rome, vient, dit-*oh, de découvrir que Yivoire
contient de l’acide fluorique uni à la chaux ; mais
les effais faits a Paris par les principaux chimiftes
n ont point confirmé jufqu'à prélent cette
découverte : on n’a trouvé dans l'ivoire quq le
phofphate de chaux & la gélatine. ( Foyer Varticle
fuivant. )
. IVOIRE^ f o s s i l e . La découverte du chimiftè
italien paroît préfenter un réfultat applicable à î’i-
voire foffile. On nomme ainfi Yivoire enfoui dans,
la terre, 8c qui y a fubi plus ou moins d'altération.
On trouve des maffes trës-confidérables dé cet
ivoire fojfile^ : le fol de quelques prairies près des
grandes rivières Temble en être jonché, C'eft à ce
genre qu appartient 1 uni ■ cornufojjile , qu'on a fi
Jong-tems prqpofé en matière médicale comme un
remède affez important, mais auquel on a renoncé
depuis plus d'un dcmi-fiècle.
L1 ivoire.foffile n'a plus la bhncheur 8c la denfité
I V O
de celui qui n’a point féjourné dans la terre. Il
contient de l’acide fluorique uni à la chaux 8c mêlé
à du phofphate calcaire. Il fe rapproche par-là du
phofphaté de chaux foffile, foit de la pierre d’Ef-
tramadure, foit de la terre de Marmaroch, qui
toutes deux contiennent - du fluate calcaire en
même tems que le phofphate.
C’eft dans l’intérieur de la terre que l'acidé fluorique
pénètre Yivoîrekc change fa nature. 11 paroît,
d'après ce fait très-remarquablé, que l ’acide fluorique
eft beaucoup plus fréqueut & plus abondant
qu'on ne l'a cru jufqu’aujourd'hui. Cela eft plus
vraifemblable que l'opinion de quelques chimiftes,
qui penfent que l'acide fluorique pourroit bien
être une modification de l'acide phofphorique.
Au refte, ce rrouveau fait fur la nature de' 1 i-
voirefoffile ouvre un champ n eu f d’expériences &
de recherches pour les chimiftes, 8c il appelle toute
leur attention comme leur intérêt.
Voici un Mémoire fur cet objet, que nous avons
communiqué, M. Vauquelin 8c moi, à la claffe
des fciences mathématiques & phyfiques de l ’Inf-
titut.
« Par une lettre inférée dans le numéro des
Annales de Chimie, fruêtidor an 13 , M. Gay-Luf-
fac, élève 8c ami de M. Berthollet, annonce à ce
favant, queM. Morichini, chimiftè de Rome, avoit
découvert dans Yivoire frais, dans Yivoire foffile 8c
l'émail des dents , la préfence de l’acide fluorique ;
que Yivoire frais étoit prefqu’entiérement formé
de fluate de chaux, & que l'émail des dents con-
tenoit jufqu’à vingt-deux centièmes de fluate de
chaux. -
» Cette découverte eft trop intéreffunte pour
que, chacun ne fe foit pas empreffé de la vérifier.
Nous allons donner dans ce Mémoire le réfultat
des expériences que nous avons faites fur cet objet
dans le laboratoire de recherches dû Muféum d’Hif-
toire naturelle.
» Comme il eût été difficile & peut-être impof
fible de faire agir convenablement l'acide fulfu-
riqué fur ces fubftances, fi elles n'avoient pas
auparavant été dépouillées de leur gluten animal,
on a commencé par les calciner dans ùn .creufet
ouvert.
i°. L'ivoire frais a perdu par cette calcination
45 pour 100.
2°. L'ivoire foffile de Sibérie. . . . . - . . . . * 41 7.
30. L'ivoire foffile de Loyo........ ; .......... 41
4°. L'ivoire foffile de l'Ourcq.......... • • • • 18
y°. L ’ivoire foffile,du Pérou, trouvé à
mille cent foixante-feize pieds d'élévation.. 15* 6°. L’ivoirè foffile d'Argénteuil.............. 14
7°. L'émail des dents.. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 j .
« Les différences qui exiftent entre les pertes
éprouvées par les différehs ivoires dans la calcination
, peuvent s’expliquer par l'état où ils fe trou-
vent : Yivoire fojfile de Sibérie, de Loyo , étoient |
prefqu'entiérement encore dans leur état naturel 5
1 v o 557
, ils confervoientla plus grande partie de leur gluten
! animal & leur organifation, tandis que ceux du
canal de l’Oarcq, du Pérou & d’Argenteuilavcient:
été dépouillés de cette matière & s’étoient en-
fuite defféchés ; au(li ces derniers fe délitenr-ils
facilement en lames, font-ils extrêmement fragiles
& ne répandent-ils que très-peu d'odeur animale
pendant la calcination. Quant à l’émail des dents,
le peu de perte qu'il a fubie par la même opération,
annonce qu'il contient beaucoup moins d'humidité,
& furtout de mucilage animal que les autres os,
ainfi que nous l’avons reconnu il y a déjà long- te ms.
Ce dernier a pris une fort belle couleur bleue par
la chaleur; ce qui prouve qu’il renferme une quantité
affez notable de phofphate de fer.
! » Après avoir été calcinées & pulvérifées, chacune
dé ces matières a été traitée de la manière
fui vante, pour favoir fi on pourroit y découvrir
la préfence de l’acide-fluorique. On a mis ces
ivoires calcinés, tantôt dans une fiole à médecine,
tantôt dans une petite cornue : on a verfé par-deffus
au moins quatre parties d'acide fulfurique concentré;
on a adapté à ces vafes un tube de verre
plo igeant dans l'eau de chaux , & on a chauffe.
Dans chacune de ces expériences on n'a jamais
, employé plus de vingt grammes, 8c moins de cinq
grammes de matière à la fois.
« Vivoire frais ni l’émail des dents ne nous ont
préfentéaucune trace d'acide fluorique. Les ivoires
foffiles de Sibérie & de Loyo n'en ont pas offert
davantage; mais ceux du canal de l'Ourcq & d’Àr-
genteuil ont fourni des traces fenfibles de cet acide.
Dans ces derniers cas, la partie fupérieure de la
fiole à médecine ou de la cornue, & les tubes qui
conduifoient les vapeurs dans l'eau de chaux,
étoient dépolis & recouverts d'une potiffière blanche,
dont les propriétés reffembloient à celles de
la filice; dans les autresjras, rien de femblable ne
s'eft préfenté.
»Ces premiers réfultats nous ayant déjà fait douter
de i'exiftence de l’acide fluorique dans les
ivoires frais J ainfi que dans ceux qui, quoiqu e fof•
files 3 contiennent encore prefque toute entière &
fans, altération leur matière animale, nous avons
fait des mélanges artificiels avec de Yivoire frais
& du fluate de chaux, tantôt dans la proportion
d'un vingt-cinquième, & tantôt dans celle d’un
quarantième; 8c toujours, même dans ce derni-r
, cas, nous"avons obfervé, d’une manière très-marquée,
les effets de l’acide fluorique fur le verre,
lorfque ces mélanges ont été traités comme il a été
dit ci-deffus. Ces effets étoient même beaucoup
plusTenfibies que ceux produits par les ivoires fof-
files du canal^de l ’Ourcq & d’Argenteuil ; ce qui
annonce que le fluate de chaux n’exifte pas dans ces
fubftances au-delà de trois ou quatre^centièmes.
» Lesfavans qui ont annoncé la decouverte de
l'acide fluorique dans Yivoire, n’affurant pas que
cette fubftance en foit entièrement formée, quoiqu’ils
rappellent qu'autrefôis Rouelle avoit en vain