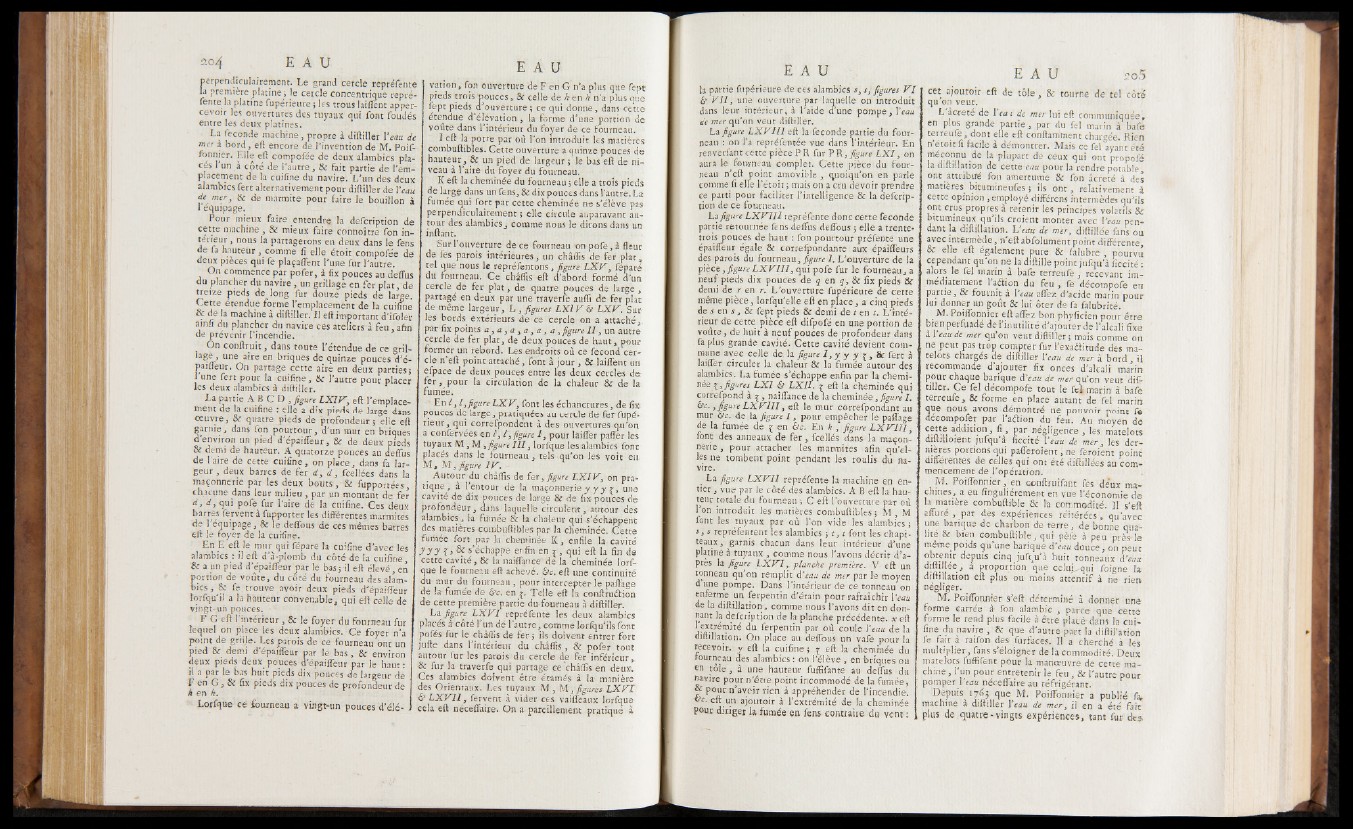
perpendiculairement. Le grand cercle repréfente
la première platine; le cercle concentrique repré-
fente la platine fupérieure ; les trous IaiiTent apper-
cevoir les ouvertures des tuyaux qui font foudés
entre les deux platines.
La fécondé machine , propre à diftiller Veau de
mer à bord ,'e(l encore de l’invention de M. Poif-
fonniér. Elle eft compofée de deux alambics placés
1 un a cote de i’autre , & fait partie de remplacement
de la cuilïne du navire. L'un des deux
alambics fert alternativement pour diftiller de Veau
de mer, & de marmite pour faire le bouillon à
1 équipage.
Pour mieux faire entendre la defeription de
cette machine, & mieux faire connoîtré fon intérieur
, nous la partagerons «n deux dans le fens
de fa hauteur J comme fi elle étoit compofée de
deux pièces qui fe plaçaffent l’une fur l’aiitre.
On commence par pofer, à fix pouces au deffus
du plancher du navire, un grillage en fer plat,, dé
treize pieds de long fur douze pieds de large.
Cette étendue forme l’emplacement de la cuifine
& de la machine à diftiller. Il eft important d’ifoler
ainft du plancher du navire ces ateliers à feu, afin
de prévenir l’incendie.
On conftruit, dans toute l’étendue de ce gril-
lage, une aire en briques de quinze pouces d’é-
paifteur. On partage cette aire en deux parties ;
I une fert pour la cuifine, &• l’autre pour placer
les deux alambics à diftiller.
La partie A B C D , figure LXIVy eft l’emplacement
de la cuifine : elle a dix pieds de large dans
oeuvre, & quatre pieds de profondeur} elle eft
garnie, dans fon pourtour, d’un mur en briques
d’environ un pied d’épaiffeur, & de deux pieds
& demi de hauteur. A quatorze ponces au deftus
de faire de cette cuifine, on place, dans fa largeur
, deux barres de fer d3 d y fcellées dans la
maçonnerie par les deux bouts, & fupporrées,
chacune dans leur milieu, par un montant de fer
d , dy qui pofe fur l ’aire de la cuifine. Ces deux •
barres fervent à fupporter les différentes marmites
de l’équipage, & le deffous de ces mêmes barres
eft le foyer de la cuifine.
En E eft le mur qui fépare fa cuifine d’avec les
alambics : il eft d’à-plomb du côté de la cuifine,
& a un pied d’épaiffeur par le bas; il eft élevé, en
portion de voûte, du côté du fourneau des alambics,
& fe trouve avoir deux pieds d’épaiffeur
îorfqu’iJ a la hauteur convenable, qui eft celle de
■ vingt-un pouces.
F G eft l’intérieur, & le foyer du fourneau fur
lequel on placé les deux alambics. Ce foyer n’a
point de griije. Les parois de ce fourneau ont un
pied & demi d’épaiffeur par le bas, & environ
deux pieds deux pouces d’épaiffeur par le haut :
il a par le bas huit pieds dix pouces de largeur de
F en G , & fix pieds dix pouces de profondeur de
h en k.
Lorfque ce fourneau a vingt-un pouces d’élé- .
vation, fon ouverture de F en G n’a plus que fept
pieds trois 'pouces, & celle de A-en h n’a plus que
fept pieds d’ouvërture; ce qui donne, dans cette
etendue d’élévation, la forme d’une portion de
voûte dans l’intérieur du foyer de ce fourneau.
I eft la porte par où l’on introduit les matières
combuftibles. Cette ouverture a quinze pouces de
hauteur , & un pied de largeur ; le bas eft de niveau
à l’aire du foyer du fourneau.
K eft la cheminée du fourneau 5 elle a trois pieds
de large dans un fens, & dix pouces dans l’autre. La
fumée qui fort par cette cheminée ne s’élève pas
perpendiculairement ; elle circule auparavant autour
des alambics, comme nous le dirons dans un
inftant.
Sur l’ouverture de ce fourneau -on pofe, à fleur
de fes parois intérieures, un châflis de fer plat,
tel cju,e nous le repréfentons, figure LX V , féparé
du fourneau. Ce châflis eft d’abord formé d’un
cercle de fer plat, de quatre pouces de large,
partagé en deux par une traverfe aufli de fer plae
de même largeur, h 3 figures LX1V & LXV. Sur
les bords extérieurs de ce cercle on a attaché,
par fix points a , a , a , a y a y a , figure I I , un autre
cercle de fer plat, de deux pouces de haut, pour
former un rebord. Les endroits où ce fécond cercle
n’eft point attaché, font à jour , & biffent un
; efpace de deux pouces entre les deux cercles det
fe r , pour la circulation de la chaleur & de la
fumée.
1 * En L, figure LX V y font les échancrures, de fix
pouces de large, pratiquées au cercle de fer fupé*
rieur, qui correfpondent à des ouvertures qu’on
a confervées en I f t 3 figure H pour laiffer paffer les
tuyaux M , M , figure I I I y lorfque les alambics font
placés dans le fourneau,. tels qu’on les voit eu
M , M , figure IV .
| Autour du châflis de fer, figure LXIVy on pra*-
M M â l’entour de la maçonnerie y y y ^, une
cavité de dix pouces de large & de fix pouces de
profondeur, dans laquelle circulera:, autour des
alambics , la filmée & la chaleur qui-s’échappent
des matières combuftibles par la cheminée. .Cette
| fumée fort par k cheminée K , enfile la cavité
1 y y y & s’échappe enfin en ^, qui eft la fin de
cette cavité, & la naiffance de la cheminée lorfque
le fourneau eft achevé. &c. eft une continuité
du mur du fourneau , pour intercepter le paft’age
de la- fumée de &c. en^. Telle eft là conftru&ion
de cette premièrepartie du fourneau à diftiller.
LX VI repréfente les deux alambics
places à côté l’un dé l ’autre, comme iorlqu’ils font
pofés fur le châflis de fer ; ils doivent entrer fort
jufte dans l’intérieur du châflis , & pofer tout
autour furies parois du cercle de fer inférieur,
& fur la traverfe^ qui partage ce "châflis en deux;
Ces alambics doivent être étamés à la- manière
des Orientaux. Les tuyaux M , M 3 figures L X V l
& LXV11, fervent à vider ces vaiffeaux lorfque
cela eft néceffaire. On a pareillement pratiqué à
la partie fupérieure de ces alambics s3 s, figures V I
& V I I 3 une ouverture par laquelle on introduit
dans leur intérieur, à l’aide aune pompe, Veau
de mer qu’on veut diftiller.
La figure L X V I ll eft la fécondé partie du fourneau
: on l’a repréfentée vue dans l’intérieur. En
renvërfant cette pièce PR fur P R 3 figure L X I 3 on
aura le fourneau complet. Gette pièce du fourneau
n’eft point amovible, quoiqu’on en parle
comme fi elle l’étoit; mais on a cru devoir prendre
ce parti pour faciliter l’intelligence & la aeferip-
tion de ce fourneau.
La figure LX V I ll repréfente donc cette fécondé
partie retournée fens deffus deffous ; elle a trente-
trois pouces de haut : fon pourtour préfente une
épaiffeur égale & torrefpondanre aux épaiffeurs j
des parois du fourneau, figure 1. L’ouverture de la j
pièce, figure L X V I l l, qui pofe fur le fourneau, a I
neuf pieds dix pouces de j en 5, & fix pieds & j
demi de r en r. L’ouverture fupérieure de cette j
même pièce, lorfqu’ elle eft en place, a cinq pieds
de s en s , & fept pieds & demi de t en t. L’intérieur
de cette pièce eft difpofé en une portion de
voûte, de huit à neuf pouces de profondeur dans
fa plus grande cavité. Cette cavité devient commune
avec celle de. la figure 1, y y y 7 , & fert à
laiffer circuler la chaleur & la fumée autour des
alambics. La fumée s’échappe enfin par la chemi-
née % 3 figures^ LXI & LXII. z eft la cheminée qui
correfpond à %, naiffance de la cheminée, figure I.
bc.} figure L X V I l l, eft le mur correfpondant au
mur &c. de.la figure / , pour empêcher le paffage
de la fumée de ^ en &c. En k , figure L X V I l l,
font des anneaux de fe r , fcellés dans la maçonnerie
, pour attacher les marmites afin qu’elles
ne tombent point pendant les roulis du navire.
La figure LXVI1 repréfente la machine en entier
, vue par le côté des alambics. A B eft la hauteur
totale du fourneau; C eft l’ouverture par où
l’on introduit les matières combuftibles; M , M
font les tuyaux par où l’on vide les alambics ;
s 3 s repréfentent les alambics y t 3t font les chapiteaux,
garnis chacun dans leur intérieur d’une
platine à tuyaux , comme nous l’avons décrit d’apres
la figure LX VI y planche première. V eft un
tonneau qu on remplit d3eau de mer par le moyen
d une pompe. Dans l’intérieur de ce tonneau on
enferme un ferpentin d’étain pour rafraîchir Veau
de la diftillationcomme nous l’avons dit en donnant
la defeription de la planche précédente. * eft 1 extrémité du ferpentin par où coule Veau de la
diftillation. On place au deffous un vafe pour la
recevoir, y eft la cuifine; ^ eft la cheminée du
fourneau des alambics : on l’élève » en briques ou
en tôle , à une hauteur fuffifante au deffus du
navire pour n’être point incommodé de la-fumée,
& pour n’aveir rien à appréhender de l’incendie,
«c. eft un ajoutoir à l’extrémité de la cheminée
pour diriger la fumée en fens contraire du vent :
cet ajoutoir eft de tôle , & tourne de tel côté
qu on veut.
L acreté de 1 eat de mer lui eft communiquée»
en plus grande partie , par du fel marin à bafe
terreufe, dont elle eft conftamtnent chargée. Rien
n’étoit fi facile à démontrer. Mais ce fel ayant été
*a P^uParc de ceux qui ont propofé
la diftillation de cette eau pour la rendre potable,
ont attribué fon amertume & fon âcreté à des
matières bitumineufes ; ils ont , relativement à
cette opinion, employé différens intermèdes qu’ils
ont crus propres à retenir les principes volatils &
bitumineux qu’ils croient monter avec Veau pendant
la diftillation. L‘ eau de mer, diftillée fans ou
avec intermède, n’eftabfolumentpoint différente,
& elle eft également pure & falubre , pourvu
cependant qu’on ne la diftille point jufqu’à ficcité :
alors le fel marin à bafe terreufe, recevant immédiatement
1 action du feu , fe décompofe en
partie, & fournit à Veau affez d’acide marin pour
lui donner un goût & lui ôter de fa falobrité.
M. Poiffonnier eft affez bon phyficien pour être
bien perfuadé del’inutiliré d’ajouter de l’alcali fixe
à Veau de mer qu’on veut diftiller ; mais comme on
ne peut pas trop compter fur l’exa&itude des matelots
charges de diftiller Veau de mer à bord, il
recommande d’ajouter fix onces d'atcali marin
pour chaque barique d tau. de mec qu’on veut diftiller.
Ce fel décompofe tout le feb marin à bafe
terreufe 3 & forme en place autant de fel marin
que nous avons démontré ne pouvoir point fe
décompofer par l’aftion du feu. Au moyen de
JpïîB addition, jjjh par négligence , les matelots
diliiHoienc jufqu a ficcité 1 eau de mtr, les dernières
portions qui pafleroient, ne feroient point
differentes de celles qui ont été diflillées au commencement
de l’opération.
M-. Poiffonnier, en conftruifant fes de’ux machines,
a eu iinguliérement en vue l'économie de
la matière combuftible & ta commodité. 11 s’eft
affûté , par des expériences réitérées, qu'avec
une barique de charbon de terre, de bonne qualité
& bien combuftible, qui pèfe à peu près-le
même poids, qu’une barique d‘ eau douce, on peut
obtenir depuis cinq jufcu'à huit tonneaux d‘eau
diftdlée , à proportion que celui^qui foigne la
diftillation eft plus ou moins attentif à ne rien
négliger.
M. Poiffonnier s’eft déterminé à donner une
forme carrée à- fon alambic , parce que cette
forme le rend plus facile à être placé dans la cuifine
du navire, & que d’autre part la diftH'ation
fe fait à raifon des furfaces. Il a cherché à les
multiplier, fans s’éloigner de la commodité. Deux
matelots fuffifent pour la manoeuvre de cette machine,
l’un pour entretenir le feu, & i’autre pour
pomper l eau neceffaire au réfrigérant.
Depuis^ 1763 que M. Poiffonnier a publié fa,
machine a diftiller Veau de mer y il en a été fait
plus de quatre-vingts expériences, tant fur des.