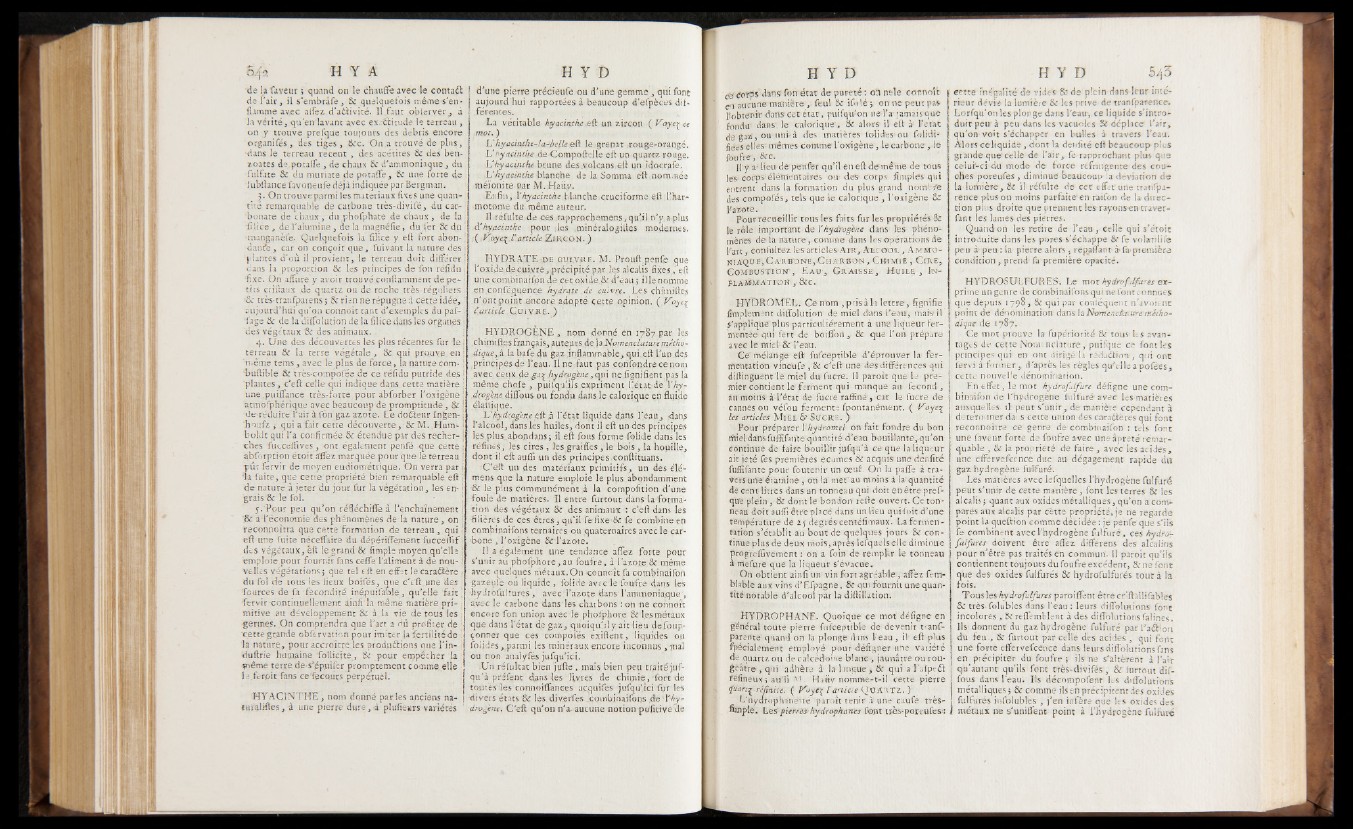
54s H Y À
de la faveur ; quand on le chauffe avec le contact
de l’air, il s’ embrâfe , & quelquefois même-s’en-
flimmeav.ee alfez d’aôh'vité. ll.fauc .obleryer^ à
la vérité, qu’en lavant avec exactitude le terreau,
on y trouve p-refque toujours des débris encore
organifés, des tiges , & c. On,a trouvé de plus,
'dans le terreau récent, des acétices & des ben-
zoates de.potalTe, de chaux & d’ammoniaque, du
fui fixe & du muriate de potaffe, & une forte de
fubilancë favoneufe déjà indiquée par Bergman.
5. On trouve parmi les matériaux fixes une quantité
remarquable de carbone très-divilé, du carbonate
de chaux, dirphofphate de chaux, de la
Alice , de l’alumine, de la magnéfie, du fer & du ■
-manganèfe. Quelquefois la Alice y eft fort abon-j
Gante, car on conçoit que, fuivant la nature des j
plantes d’où il provient, le terreau doit différer S
dans la proportion & les principes de fort réfidu i
fixe. On affure’y avoir trouvé conftamvnent de pe- j
tics criftaux de quartz ou de roche très-réguliers •
■ de très-tranfparens j 6e rien ne répugne à cette idée, '
aujourd’hui qu’on coimoît tant d’exemples du paf- ;
fage & de la diffolution de la Alice dans les organes |,
des végétaux 8e des animaux.
4. Une des découvertes les plus récentes fur le j
terreau 8e la terre végétale , 8e qui prouve en j
même tems, avec le plus de force, la nature corn- !
-buftible 8e très-compofée de ce réfidu putride des j
plantes, c’eft celle qui indique dans cette matière !
une .puiflance trèsrforte pour abforber l’oxigènej
atmofphérique avec beaucoup de promptitude, 8e
de réduire l’air à fon gaz azote. Le doéteur Ingen- j
:houfz , qui a fait cette découverte, 8e M. Hum- j
boldt qui l’a confirmée 8e étendue par des recher- j
-ches fuçceftîves , ont également penfé que cette j
abforption étoit affez marquée pour que le terreau |
■ pût fervir de moyen eudiométrique. On verra par j
‘la fuite, que cette propriété bien remarquable eft j
de nature à jeter du jour fur la végétation, les en- j
grais & le fol.
y. Pour peu qu’on réfléchilïe à l'enchaînement |
!& à l’économie des phénomènes de la nature, on i
reconnoîtra que cette formation de terreau, qui \
eft une fuite nécelfaire du dépériffement fucceftif !
des végétaux, èft le grand & Ample moyen qu’elle j
emploie pour fournir fans ceffe l’aliment à de nou- i
velies végétations 5 que tel eft en effet le caractère |
du fol de tous les lieux boifés, que c’ eft une des :
Sources de fa fécondité inépuifable, qu’elle fait,
fervir continuellement âinft la même matière primitive
au développement 8c à la vie de tous les ■
-germes. On comprendra que l’art a dû profiter de
■ çette grande obfervation pour imiter la fertilité de
la nature, pour accroître les productions que l’ indu
ftr Je humaine fotlicite, & pour empêcher la
même terre de-s’épjuifer promptement comme elfe
le.fcr.oit fans ce fecaurs perpétuel.
HYACINTHE, nom donné parles anciens na- |
iuralifles, à une pierre dure,-à plufie*rs variétés
H Y D
| d’une pierre précieufe ou d’une gemme, qui font
aujourd'hui rapportées à beaucoup d’efpèces différentes.
La véritable hyacinthe .eft un zircon ( Voye^ ce
mot. I
L’hyacinthe-la-'beJU eft le grenat .rouge-orangé.
V hyacinthe deGompoftelle eft un quartz rouge.
Vhyacinthe brune des .volcans .eft un idoçrafe.
1/hyacinthe blanc-he de la Somma eft .nommée
méionite par M.Haiiy.
Enfin, l’hyacinthe blanche.cruciforme eft l’har-
motome du.même auteur.
Il ré fui te. de ces rapprochemens, qu’il n’y, a plus
à*hyacinthe pour : les .minéralogilfces modernes.
i,( iKoyc^.l3article Z i r c o n . )
HYDRATE 0E GUivatE. M. Prouft.penfe que
l’ oxide decuiyre ,,précipité par les alcalis fixe.s ,' eft
une com binaifonde cet o x id e .d ’eau j il le nomme
en .conféquence hydrate ,de cuivre. Les çhimifl.e.s
n’ont point .encore adopté cette opinion. (Voye^
£ article Gviy R E . )
HYDROGENE, nom donné en 1787 par les
.chimifl.es français, auteurs de h.Nomenclature mkho~
.diquej à la bafeflu gaz .inflammable, qui,eft l’up.des
.principes de l’eau. Il neTaut pas confondre ce nom
avec ceux do ,ga^ hyflrpghie, qui n eft gqi fient pa,s la
même chofe , puiiqu’ils expriment l’état de.Yhy-
.dçogène diflous ou fpnd.u dans.le calorique en fluide
élattique.
U hydrogéné eft d Tét;qt liquide d,ans l’eau y -dan^
l’alcoôl, dans les huiles, dont il eft un des principes
les.plus.abondans j il eft fous forme folide dans les
réfines, les cires , les.grailles ,1e bois,,la houille,
dont il eft auflî un des principes.conftituans.
C ’eft un des matériaux primitifs , un des élé-
mens que la nature emploie le plus abondamment
•& le plus communément .à la compofition d’une
foule de matières. Il entre furtout dans la-formation
des végétaux & des animaux : c’eft dans les
filières de ces êtres, qü’il fefixe<&,fe combine en
combinarfons ternaires ou quaternaires avec le carbone
,1 ’oxigène & l’azote.
Il a également une tendance alfez forte pour
s’unir au phofphore,au foufre, àTazo.te.8e même
avec quelques métaux.On connott fa combinaifon
-gazeufe ou liquide , foîide-avec le foufre dans les
hydrofulfures, avec l’azote dans Tammonia.que ,
avec le carbone dans les charbons : on ne corrnoît
encore fon union avec*le phofpbore & les métaux
que dans l’état de gaz, quoiqu’ il y ait lieu defoup-
çonner que ces compofés exiftent, liquides ou
foiides,rparmi les minéraux encore inconnus , pial
ou non analyfés jufqu’ ici.
:Un réfultat bien jufte, mais bien peu traité jtlf-
qu’à préfent d^ns les livres de chimie, fort de
toutes les connoifiances acquifes jufqu’ici fur ’les
divers états & les.diyer'fes „çombinaifoqs .de !l’/?y-
drogene. C ’eft qu’on n’a- aucune notion poficive de
H Y D
e£ CdYps cl'à'nsf fon état de pureté : oïl nele connoît
en aucune manière ,- feul & ifoléy on ne peut pas
liobrenit dans cet état, puifqu’on ne-l’a* jamais-que
fondu- dans', le calorique, & alors il eft à Fera*
de gazî, ou uni-à des matières lolides»ou folidi-
fiées elles- mêmes comme l’oxi gène, le carbone y-le
Ibu fref &c,
XT y a* lieu-de penfef qu’il en eft de même de tous
les corï>s- élémentaires ou- des corps fimples qui
entrent dans la formation du plus grand nombre
des compofés, tels que le calorique , l’oxigène &
Falote.
P'ourrecoeillir tous les faits fur les propriétés &
le rôle important de Y hydrogène dans lès- phénomènes
de la nature , comme dans les opérations de
Fart, cotifultez les article s-Air-, âéco'o-l ,A mrto-
nia:qué>C a’Rbon‘e,.Charbon , Chimie , CrRE,
C o m b u s t i o n " , E a u , G r a t s s e , H u i l e , In -
k a i & m a -t ï o n y & c .
HYDROMEL. Ce nom , pris à li lettre , lignifie
Amplement diffolution de miel dans l’eau* mais- il
S'applique' plus particuliérement à une liqueur fermentée
qui fert de boiffon,- 8i que l’on prépare
avec le miel 8c l’ eau.
Ce" mélange eft- fufceptible d’éprouver la! fermentation
vineufe, & c’eft une desdifférences qui
diftinguent le fniel du fucre. Il paroît que le premier
contient le ferment qui manque au fécond ,
au moins à-l’état de fucre raffiné, car le fucre de
■ cannes ou véfou fermente fpontanément. ( Voye%
lés' articles M i e l & S u c r e . )
Pour préparer Y hydromel on fait fondre du bon
miel dans fuffifm'te quantité d’eau bouillariteyqu’on
Continue de faire bouillir jufq-u’à ce que la liqueur
ait jeté fes premières écumes & acquis une denfité
fuffifante pour foutenir un oeuf. On la pafte à traders
uh'eé'rarriiné , oti là'met' au moins à la; quantité
de cent' litres dans un tonneau qui doit en être pref-
qifë plein-',- & dont le bondoiv refte ouvert. Ce tonneau
doit aufli être place' dans' un lieu qui foit d’une
température de 2y degréscemélimaux. Lafermeri-
Catfoil s’établit au bout de quelques jours & continue
plus de deux mois, après leiquelselie diminue
progrelfivement : on a foin de remplir le tonneau
a mefuré que la liqueur s’évacue.
On obtient ainfi un vin fort agréable, alfez ft-rrï-
blable aux vins d’ Efpagne, 8c qui fournit une quantité
notable d’ alcool par la diftillation.
HYDROPHà NE. Quoique' ce mot défigne en
général toute pierre fufceptible de devenir tranf-
parente quand on la plonge d-ins Peau, il' eft plus
fpécialement employé pour défigner une vaiiéré
de quartz ou de calcédoine blanc, jaunâtre ou rougeâtre,
qui adhère à la langue * 8c qui a l’alpeél
féfinëuxj aufii M Hativ nomme-t-il cette pierre
fuanç-réjînite. ( V o y e\ l 'a rticle QuAHTZ. )
L'nydtoplnnéitê paroît tenir ;l une eaufe très-
ftmple. Les-pierres- h y d ro f haties font tr-ès-poreufes :
H Y D 5/| 3
cette fné'gaUté de vides & de plein dans leur intérieur
dévie la lumière 8c les prive de tranfparenee.
Lorfqu’on les plonge dans l'eau-, ce liquide s’introduit
peu- à peu dans les vacuoles & déplace l’air,
qu’on voit s'échapper en bulles à travers l’eau.
Alors c.el-iqiiide, dont la denfité eft beaucoup plus
grande que celle de l’air ^ fe rapprochant plus que
celui-ci-du mode- de force réfringente des couches
poreufes , diminue beaucoup ! a déviation de
la-lumière,. & ilré fui te de cet effet une rraufpa-
rence plus ou moins parfaite’en r ai fon de la-direction
pins droite que prennent les ra-yons en traver-
funt les lames des pierres.
Quand on les retire de l’eau celle qui s’étoit
introduite dans1 les pores s’échappe 8c fe volatilife
peu- à- peu: la- pierre alors, repaffant à*(à-première
condition, prend1 là première opacité.
H YDROSULFURES-. Le mot hydrofulfures exprime
un genre de combinaifonsqui ne font connues
que depuis 1798, & qui par coméquent n’avoient
point de dénominationdans la Nonienclktiura méthodique
de 1787.
Ce mot prouve la fupérioriré 8d tous ks avantagesde
cette Nom nclarure, puifque ce fondes
principes qui' en ont dirigé la rédaction , qui ont
fervi à former,, d'après les règles qu’elle apo fées,
cette nouvelle dénomination.
Fn effet, le mot hydrofulfure défigne une combinaifon
de l’hydrogène fuifuré avec les matières
auxquelles il peut s’u n irde manière cependant à
déterminer d a ; s cette union des caractères qui font
reconnoître ce genre de combinaifon : tels font
une faveur forte de foufre avec une âpreté remarquable
, & la propriété de faire, avec les acides,
une effervefcence due au dégagement rapide du
gaz hydrogène fuifuré.
Les matières avec lefquelles l’hydrogène fuifuré
peut s’unir de cette manière, font les terres & les
alcalis j quant aux oxides métalliques, qu’on a comparés
aux alcalis par cette propriété, je ne regarde
point la queftion comme décidée : je penfe que s’iis
fe combinent avec l’hydrogène fuifuré, ces hydrofulfures
doivent être a fiez différens des alcalins
pour n’être pas traités en commun. Il paroît qu’ils
contiennent toujours du foufre excédent, & ne font
que des oxides- fulfurés 8c hydrofulfurés tout à là
fois.
Tous les hydrofulfures paroilfent être crIftallifablës
Sz très-folubles dans l’eau : leurs di {fol mi ors font
incolores , & refte m bien t à des diftolutions falines.
Ils donnent du gaz hydrogène fuifuré par l’aékon
du feu., tk furtout parcelle des acides , qui font
une forte effervefcence dans leurs diftolutions fans
en précipiter du foufre ; ils ne s’altèrent à l’air
qu’autant qu’ils font très-divifés, & furtout dif-
fous dans l’eau. Ils décompofenr les diftolutions
métalliques ; & comme ils en précipitent des oxides
fulfurés infolubles , j’en infère que les oxides des
métaux ne s’unifient point à l’hydrogène fuifuré