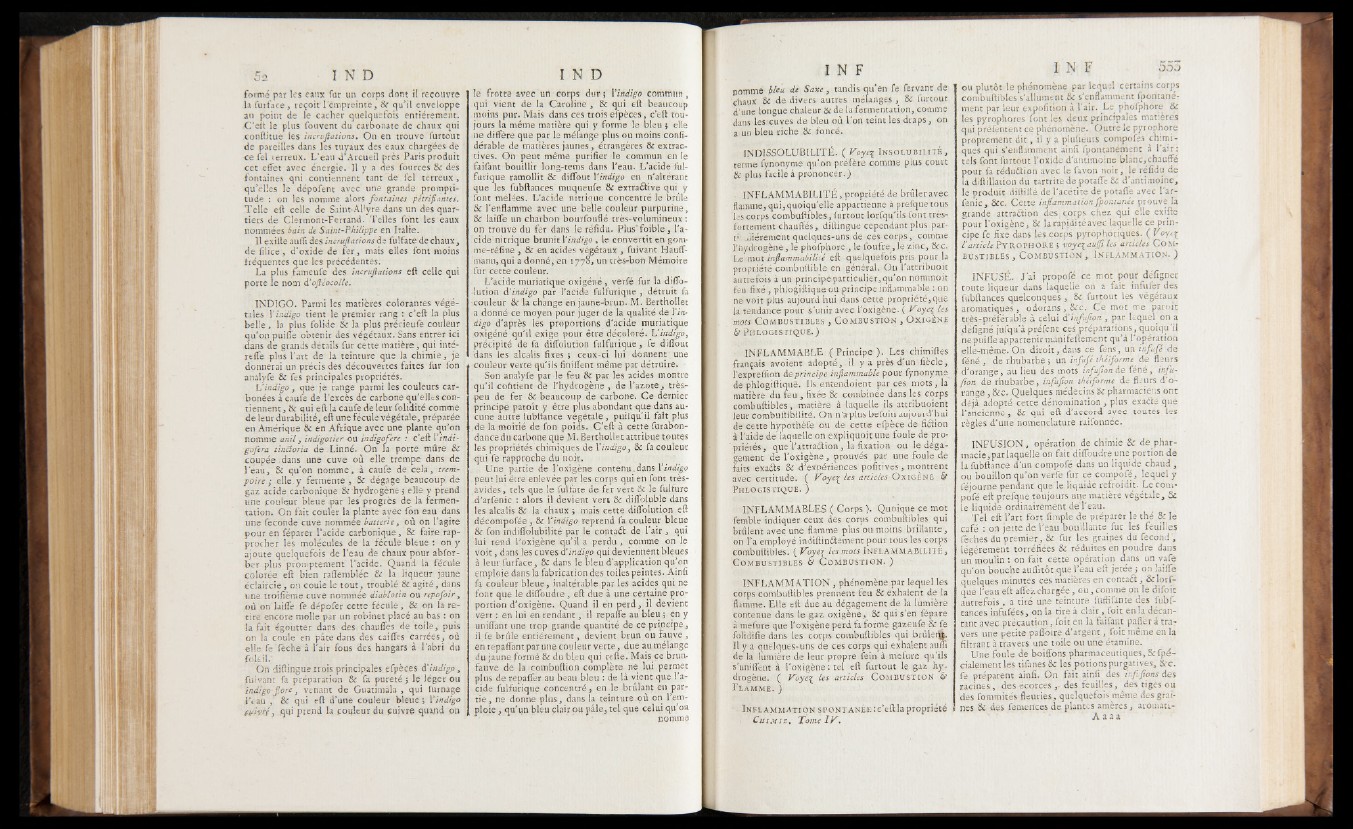
formé par les eaux fur un corps dont il recouvre
la furface, reçoit 1 empreinte, &■ qu'il enveloppe
au point de le cacher quelquefois entièrement.
.C’eft le plus fouvent du carbonate de chaux qui
conflitue les incrufiations, On en trouve furtout
de pareilles dans les tuyaux des eaux chargées de
ce fel terreux. L'eau d’Arcueil près Paris produit
cet effet avec énergie. Il y a des fources & des
fontaines qni contiennent tant de fel terreux,
qu'elles le dépofent avec une grande promptitude
: on les nomme alors fontaines pétrifiantes.
Telle eft celle de Saint-Allyre dans un des quartiers
de Clermont-Ferrand. Telles font les eaux
nommées bain de Saint-Philippe en Italie.
11 exille au (fi des incrufiations de fulfate de chaux ,
de Alice j d'oxide de fer , mais elles font moins
fréquentes que les précédentes.
La plus fameufe des incrufiations eft celle qui
porte le nom d'ofiéocolle.
INDIGO. Parmi les matières colorantes végétales
Y indigo tient le premier rang : c'eft la plus
belle , la plus folide & la plus précieufe couleur
qu'on puiffe obtenir des végétaux. Sans entrer ici
dans de grands détails fur cette matière, qui inté-
reffe plus Part de la teinture que la chimie, je
donnerai un précis des découvertes faites fur fon
analyfè & fes principales propriétés.
L'indigo, que je range parmi les couleurs carbonées
à eaufe de l'excès de carbone qu’elles contiennent
, & qui eft la caufe de leur foliaité comme
de leur durabilité, eft une fécule végétale, préparée
en Amérique & en Afrique avec une plante qu'on
nomme anil 3 indigotier OU indigofére : c’eft Y indigo
fera tinctoria de Linné. On la porte mûre &
coupée.dans une cuve où elle trempe dans de
l ’eau, & qu’on nomme, à caufe de cela, trem-
poirè ; elle, y fermente, & dégage beaucoup de
gaz acide carbonique & hydrogène 5 elle y prend
une couleur bleue par les progrès de la fermentation.
On fait couler la plante avec fon eau dans
une fécondé cuve nommee batterie, où on l'agite
pour en féparer l’acide carbonique, & faire rapprocher
les molécules de la fécule bleue : on. y
ajoute quelquefois de l’eau de chaux pour abfor-
ber plus promptement l'acide. Quand la fécule
colorée eft bien raflemblée & la liqueur jaune
éclaircie, on couie le tout, troublé & agité, dans
une troifième cuve nommée diablotin ou repofoir,
où on laiffe fe dépofer cette fécule, & on la retire
encore molle par un robinet placé au bas : on
la fait égoutter dans des chauffes de toile, puis
on la coule en pâte dans des caiffes carrées, où
elle fe Tèche à l’air fous des hangars à l'abri du
foie il.;
On diftingue trois principales, efpèces d'indigo 3
.fuivant fa préparation & fa pureté 5 le léger ou
indigo flore venant de Guatimàla , qui fumage
l'eau , & qui eft d'une couleur bleue, Y indigo
çitivH, qui prend la couleur du cuivre quand pn
le frotte avec un corps dut--; Y indigo commun,
qui vient de la Caroline , & qui eft beaucoup
moins pur. Mais dans ces trois efpèces, c’eft toujours
la même matière qui y forme le bleu> elle
ne diffère que par le mélange plus ou moins confî-
dérable de matières jaunes, étrangères & extractives.
On peut même purifier le commun en le
faifant bouillir long-tems dans l'eau. L’acide ful-
furique ramollit & diffout Yindigo en n'altérant
que les fubftances muqueufe & extra&ive qui y
font mêlées. L'acide nitrique concentré le brûle
& l’enflamme avec une belle couleur purpurine,
& laiffe un charbon bourfouflé très-volumineux :
on trouve du fer dans le réfidu. PlusToible, l’acide
nitrique brunit Yindigo, le convertit en gom-
me-réfïne , & en acides végétaux , fuivant Hauff-
mann, qui a donné, en 1778, un très-bon Mémoire
fur cette couleur.
L'acide muriatique oxigéné, verfé fur la diffo-
dution d'indigo par l'acide fulfurique , détruit fa
couleur & la change en jaune-brun. M. Berthollec
a donné ce moyen pour juger de la qualité de Y indigo
d’après les proportions d'acide muriatique
oxigéné qu’il exige pour être décoloré. L'indigo,
précipité de fa diffolution fulfurique, fe diffout
dans les alcalis fixes ; ceux-ci lui donnent une
couleur verte qu'ils finiffent même par détruire.
Son anaîyfe par le feu & par les acides montre
qu'il contient aè l’hydrogène, de l’azote, très-
peu dé fer & beaucoup de carbone. Ce dernier
principe paroît y être plus abondant que dans aucune
autre fubftance végétale, puifqu'il fait plus
.de la moitié de fon poids. C ’eft à cette furabon-
dance du carbone que M. Berthollet attribue toutes
les propriétés chimiques de l’indigo, & fa couleur
qui fe rapproche du noir.
Une partie de l'oxigène contenu.dans Yindigo
peut lui être enlevée par les corps qui en font très-
avides, tels que le fulfate de fer vert & le fulfure
-d’arfenic : alors il devient veri & diffoluble dans
les alcalis & la chaux j mais cette diffolution eft
décompofée, & Yindigo reprend fa couleur bleue
& fon îndiffolubilité par le conta# de l'air, qui
lui rend l’oxigène qu’ il a perdu, comme on le
voit, dans les cuves à'indigo qui deviennent bleues
à leur furface, & dans le bleu d’application qu'on
emploie dans la fabrication des toiles peintes. Ainfi
fa couleur bleue, inaltérable par les acides qui ne
font que le diffoudre, eft due à une certaine proportion
d'oxigène. Quand il en perd, il devient
vert > en lui en rendant, il repafle au bleu j en y
unifiant une trop grande quantité de ce principe,
il fe brûle entièrement, devient brun ou fauve,
en repaffam par une couleur verte, due au mélange
du jaune formé & du bleu qui refte. Mais ce brun-
fauve de la combuftion complète ne lui permet
plus de repaffer au beau bleu : de là vient que l'acide
fulfurique concentré, en le brûlant en partie,
ne donne plus, dans la teinture où on l’emploie
, qu'un bleu clair ou pâle, tel que celui qu’on
nomme
nomme bleu de Saxe, tandis qu'en fe fervant de
chaux & de divers autres mélanges, & furtout
d’une longue chaleur & de la-fermentation, comme
dans les neuves de bleu où l'on teint les draps, on
a un bleu riche & foncé.
INDISSOLUBILITÉ. ( Voye^ Insolubilité,
terme fynonyme qu’on préfère comme plus court
& plus facile à prononcer.)
- INFLAMMABILITÉ, propriété de brûler avec
flamme, qui, quoiqu’elle appartienne à prefque tous
les corps combuftibles, furtout lorfqu’ils font très-
fortement chauffés, diftingue cependant plus parti
..fièrement quelques-uns de ces corps, comme
l’hydrogène, le phofphore , le foufre, le zinc, &c.
Le mot inflammabilité eft quelquefois pris pour la
propriété combuftible en général. O11 l’attribuoit
autrefois à un principe particulier, qu’on nommoit
feu fixé , phlogiftique ou principe inflammable : on
ne voit plus aujourd hui dans cette propriété,que
la tendance pour s’unir avec l’oxigène. ( Koye\ les
mots C ombustibles , C ombustion , Oxigéné
& Phlogistique.)
INFLAMMABLE ( Principe ). Les chimiftes
français avoient adopté, il y a près d^un fiècle,
l’expreflion de principe inflammable pour fynonyme
de phlogiftique. Ils entendoient par ces mots, la
matière du feu, fixée & combinée dans les corps
combuftibles, matière à laquelle ils attribuojent
leur combuftibilité. On n'a plus befoin aujourd’hui
de cette hypothèfe ou de cette efpèce de fi#ion
à l’aide de laquelle on expliquoitune foule de propriétés,
que l’attra#ion, la fixation ou le dégagement
de l’oxigène , prouvés par une foule de
faits exa#s & d'expériences pofitive's, montrent
avec certitude. ( Voyet^ les articles-Oxigene &
Phlogistique. )
INFLAMMABLES ( Corps ). Quoique ce mot
femble indiquer ceux des corps combuftibles qui
brûlent avec une flamme plus ou moins brillante,
on l’a employé indiftin&ement pour tous les corps
combuftibles. ( Voyèr^ les mots Inflammabilité,
C ombustibles & C ombustion. )
INFLAMMATION, phénomène par lequel les
corps combuftibles prennent feu & exhalent de la
flamme. Elle eft due au dégagement de la lumière
contenue dans le gaz oxigène, & qui s’en fépare
à mefure que l'oxigène perd fa forme gazeufe & fe
folidifie dans les corps combuftibles qui brûlei^.
Il y a quelques-uns de cës corps qui exhalent aufii
de la lumière de leur propre fein à mefure qu'ils
s'unifient à l’oxigène : tel eft furtout le gaz hydrogène.
( Voye[ les articles COMBUSTION &
F l a m m e . )
Inflammation spontanée :c'eft.la propriété »
1 Chimie% Tome IK»
ou plutôt le phénomène par lequel certains corps
combuftibles s’allument & s’enflamment fpontané-
ment par leur expofition à l'air. Le^ phofphore &
les pyrophores font les deux principales matières
qui préfenterit ce phénomène. Outre le pyrophore
proprement d it, il y a plulieurs compofes chimiques
qui s’enflamment ainfi fpontanément à l’air:
tels font furtout l’oxicle d’antimoine blanc,chauffé
pour fa réduction avec le favon noir, le réfidu de
la diftillation du tartritede potaffe & d’antimoine,
le produit diftilléde l’acétite de potaffe avec l’ar-
fenic , &c. Cette inflammation fpontanée prouve la
grande attra#ion des corps chez qui elle exifte
pour l’oxigène, & larapiditéavec laquelle ce principe
fe fixe dans les corps pyrophoriques. ( Voye%
Varticle PYROPHORE > voye^ aujfi les articles COMBUSTIBLES
, C ombustion, Inflammation. )
INFUSÉ. J'ai propofé ce mot pour défigner
toute liqueur dans laquelle on a fait infufer des
fubftances quelconques, & furtout les végétaux
aromatiques, odorans, &c. Ce mot me paroît
très-prérérable à celui üinfufion, par lequel on a
/defigné jüfqu'à préfent ces préparations, quoiqu'il
ne puiffe appartenir manifeftement qu'à l’opération
elle-même. On diroit, dans ce fens, un infufé de
féné , de rhubarbe ; un infufé théiforme de fleurs
d’orange, au lieu des mots infuflon de féné, infu-
fion de rhubarbe, infufion théiforme de fleurs d'orange
, &c. Quelques médecins & pharmaciens ont
déjà adopté cette dénomination , plus exa#ë que
l’arteienne, & qui eft d'accord avec toutes les
règles d’ une nomenclature raifonnée.
INFUSION, opération de chimie & de pharmacie,
par laquelle on fait diffoudre une portion de
la fubftance d'un compofé dans un liquide chaud ,
ou bouillon qu'on verfe fur ce compofé, lequel y
féjourne pendant que le liquide refroidit. Le compofé
eft prefque toujours une matière végétale, &
le liquide ordinairement deTeau.
Tel eft l’art fort fimple de préparer le thé & le
café : on jette de l’eau bouillante fur les feuilles
fèchés du premier, & fur les graines du fécond,
légèrement torréfiées & réduites en poudre dans
un moulin : on fait cette opération dans un vafe
qu’on bouche auffitôt que l’eau eft jetée 5 on laiffe
quelques minutes ces matières en conta#, & lorsque
l'eau eft affezchargée, ou, comme on le difoit
autrefois , a tiré une teinture fuffifante des fubftances
infufées, on la tire à clair, foit en la decantant
avec précaution, foit en la faifant palier à travers
une petite paffoire d’argent, foit même en la
filtrant à travers une toile ou une étamine.
Une foule de boiffons pharmaceutiques, S p é cialement
les tifanes & les potions purgatives, &c.
fe préparent ainfi. On fait ainfi des ir.fifions des
racines, des écorces ,- des feuilles, des tiges ou
des fommités fleuries, quelquefois même des graines
& des femences de plantes amères, aromaci