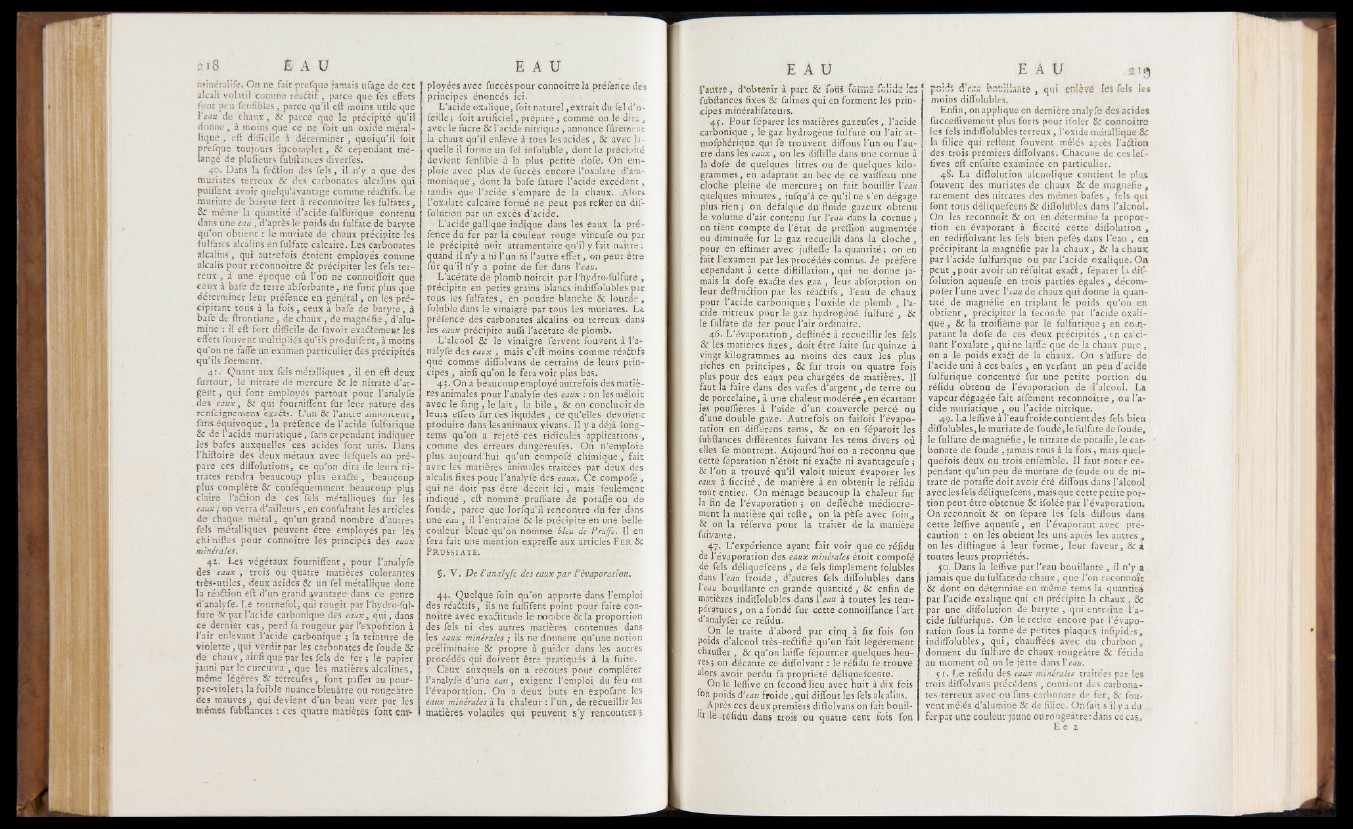
minéralife. On ne fait prefque jamais ufage de cet
alcali volatil comme réaélif, parce que fes effets
font peu fenfibles, parce qu’il eft moins utile que
Veau de chaux, & parce que le précipité qu’il
donne, à moins que ce ne foit un Oxide métallique
, eft difficile à déterminer, quoiqu’ il foit
prefque toujours incomplet, & cependant mélange
de plufieurs fubftances diverfes.
40. Dans la feétion des fels, iL-n’y a que des
muriates terreux & des carbonates alcalins qui
puifient avoir quelqu’avantage comme réaétifs. Le
muriate de baryte fert à reconnoître les fulfates,
& même la quantité d’acide Sulfurique contenu
dans une eau, d’après le poids du fuîfate de baryte
qu’on obtient : le muriate de chaux précipite les
fulfates alcalins en fulfate calcaire. Les carbonates
alcalins, qui autrefois étoient employés comme
alcalis pour reconnoître & précipiter les fels terreux
, à une époque où l’on ne connoiffoit que
ceux à bafe de terre abforbante, ne font plus que
déterminer-leur préfence en général, en les précipitant
tous à la fois, ceux à bafe de baryte, à
bafe de ftrontiane, de chaux, de magnéfie, d’alumine
: il eft fort difficile de lavoir exactement les
effets fouvent multipliés qu’ ils produifent, à moins
qu’on ne faffe un examen particulier des précipités
qu’ils forment.
41. Quant aux fels métalliques , il en eft deux
furtout, le nitrate de mercure & le nitrate d’argent
, qui font employés partout pour l’analyfe
des eaux y 8c qui fourniffent fur leur nature des
renfeignemens exaCts. L’un & l’autre annoncent,
fans.équivoque, la préfence de l’ acide fuîfurique
& de l’ acide muriatique, fans cependant indiquer
les bafes auxquelles ces acides font unis. Dans
l’hiftoire des deux métaux avec lesquels on prépare
ces diffoiutions, ce qu’on dira de leurs nitrates
rendra beaucoup plus exaéle, beaucoup
plus complète & confequemment beaucoup p!u$
claire l’adion de ces fels métalliques fur les
ea u xon verra d’ailleurs , en eonfultant les articles
de chaque métal, qu’un grand nombre d’autres
fels métalliques peuvent être employés par les
chimiftes pour connoître les principes des eaux
minérales.
42. Les végétaux fourniffent, pour l’analyfe
des eaux , trois ou quatre matières colorantes
très-utiles, deux acides & un fel métallique dont
la réa&ion eft d’un grand avantage-dans ce genre
d’analyfe. Lé tonrnefol, qui rougît par l’hydro-ful-
fure & par l ’acide carbonique des eauxy qui, dans
ce dernier cas, perd fa rougeur par l’expofition à
l’air enlevant l’acide carbonique ; la teinture dé
violette, qui verdit par les caroonates de foude &
de chaux, ainfi que par les fels de fer ; le papier
Jauni par le curcuma , que les matières alcalines,
même légères 8c terreufes, font paffer au pourpre
violet; lafoible nuance bleuâtre ou rougeâtre
des mauves, qui devient d’un beau vert par les
mêmes fubftances ces quatre madères font entployées
avec fuccèspour connoître la préfence des
principes énoncés ici.
L’acide oxalique, foit naturel, extrait du fel d’ o-
leille ; foit artificiel, préparé, comme on le dira ,
avec le fucre & l’acide nitrique, annonce fûrëmenc
la chaux qu’il enlève à tous les acides , 8c avec laquelle
il forme un fel infoluble, dont le précipité
devient fenfible à la plus petite dofe. On emploie
avec plus de fuccès encore l’oxalate d’ammoniaque
, dont la bafe fature l’acide excédent,
tandis que l’acide s’empare de la chaux. Alors
l’oxalate calcaire formé ne peut pas refter en dif-
folution par un excès d’acide.
L’acide gallique indjque dans les eaux la préfence
du fer par la couleur rouge vineufe ou par
le précipité noir atramentaire qu’il y fait naître :
quand il n’y a ni l’un ni l’ autre effet, on peut être
fur qu’il n’y a point de fer dans Veau.
L’acétate de plomb noircit par l'hydro-fulfure ,
précipite en petits grains blancs indiffolubles par
tous les fulfates, en poudre blanche & lourde,
fôluble dans le vinaigre par tous les muriates. La
préfence des carbonates alcalins ou terreux dans
les eaux précipite aufti l’acétate de plomb.
L’alcool & le vinaigre fervent fouvent à l ’a-
nalyfe des eavx , mais c’cft moins comme réaétifs
que comme* diffolvans de certains de leurs principes
, ainfi qu’on le fera voir plus bas.
43. On a beaucoup employé autrefois des matières
animales pour l’analyfe des eaüx : on les mêloit
avec le fang, le lait, la bile, & on concluoitde
leurs effets fur ces liquides , ce qu’elles dévoient
produire dans les animaux vivans. Il y a déjà long-
tems qu’on a rejeté ces ridicules applications -,
comme des erreurs dangereufes. On n’emploie
plus aujourd’hui qu’un compofé chimique, fait
avec les matières animales traitées par deux des
alcalis fixes pour l’analyfe des eaux. Ce compofé,
qui ne doit pas être décrit ic i, mais feulement
indiqué , eft nommé pruffiate de potafie ou de
foude, parce que lorfqu’il rencontre du fer dans
une eau, il l’entraîne 6c le précipite en une belle
couleur bleue qu’on nomme bleu de Prujfe. Tl en
fera fait une mention expreffe aux articles Fer 8c
P ru s si at e.
§. V. De ranalyfe des eaux par Vévaporation.
44. Quelque foin qu’on apporte dans l’emploi
des réaétifs, ils ne fuffifent point pour faire connoître
avec exactitude le nombre & la proportion
des fels ni des autres matières contenues dans
les eaux minérales ; ils ne donnent qu’une notion
préliminaire & propre à guider dans les autres
procédés qui doivent être pratiqués à la fuite.
Ceux auxquels on a recours pour compléter
l’analyfe d’une eau, exigent l’emploi du feu ou
l’évaporation. On a deux buts en expofant les
eaux minérales à la chaleur : l’un, de-recueillir les
matières-volatiles qui peuvent s y rencontrer*
l’autre , d^obtenir à part & fous tôrîïïS fchuS ÎCS
fubftances fixes & falines qui en forment les principes
minéralifateurs.
4y. Pour féparer les matières gazeufes, l’acide
carbonique , le gaz hydrogène fulfuré ou l’air at-
mofphérique q^ii fe trouvent diffous l’un ou l’autre
dans les eaux, on les diftille dans une cornue à
la dofe de quelques litres ou de quelques kilogrammes,
en adaptant au bec de ce vaiffeau une
cloche pleine de mercure ; on fait bouillir Veau
quelques minutes, jufqu’à ce qu’il ne s'en dégage
plus rien ; on défalque du fluide gazeux obtenu
le volume d’air contenu fur Veau dans la cornue >
on tient compte de l’état de préffion augmentée
ou diminuée fur la gaz recueilli dans la cloche,
pour en eftimer avec jufteffe la quantité; on en
fait l’examen par les procédé» connus. Je préfère
cependant à cette diftillation, qui ne donne jamais
la dofe exaéte des gaz, leur abforption ou
leur deftruétion par les réàéfcifs, l'eau de chaux
pour l’acide carbonique ; l’oxide de plomb , l'acide
nitreux pour le gaz hydrogéné fulfuré , &
le fulfate de fer pour l’air ordinaire.
46. L’évaporation, deftinée à recueillir les fels
& les matières fixes, doit être faite fur quinze à
vingt kilogrammes au moins des eaux les plus
riches en principes, & fur trois ou quatre fois
plus pour des eaux peu chargées de matières. 11
faut la fai re dans des vafes d’argent, de terre ou
de porcelaine, à une chaleur modérée, en écartant
les pouffières à l’aide d’un couvercle percé ou
d’une double gaze. Autrefois on faifoit l’évaporation
en différens .tems, & on en féparoit les
fubftances différentes fuivant les tems divers où
elles fe montrent. Aujourd'hui on a reconnu que
cette réparation n’étoit tii exaéte ni avantageuse j 8c l’on a trouvé qu’il valoir mieux évaporer les
eaux à ficcité, de manière à en obtenir le réfidu
tout entier. On ménage beaucoup la chaleur fur
la fin de l'évaporation ; on déffèche médiocrement
la matière qui refte, on la pèfe avec foin,,
& on la réferve pour la trairer de la manière
fuivante.
47. L’expérience ayant fait voir que ce réfidu
de F évaporation des eaux minérales étoit compofé
de fels déliquefcens, de Tels Amplement folubles
dans Veau froide, d’autres fels diffolubles dans
Veau bouillante en grande quant i t é enf i n de
matières indiffolubles dans Veau à foutes les températures
, on a fondé fur cette connoiffance l ’art
d’analyfer ce réfidu.
On le traite d’abord par cinq à iïx fois fon
poids d’alcool très-reélifié qu’on fait légèrement
chauffer, &c qu’on laiffe féjo.urner quelques heure^
on décante ce diffolvant : le réfidu fe trouve
alors avoir perdu fa propriété déliquescente.
On le leffive en fécond lieu avec huit à dix fois
fon poids d‘ eau froide, qui diffout les fels alcalins.
Après ces deux premiers diffolvans on fait bouillir
le -.réfidu dans trois ou quatre cent fois fon
poids à’ cuû bcoillsiiÈê, qui enlève les fels les
moins diffolubles.
Enfin, on applique en dernière analyfe des acides
fucceffivement plus forts pour ifoler & connoître
les fels indiffolubles terreux, l'oxide métallique 8c
la filice qui relient fouvent mêlés après i'aétion
des trois premiers diffolvans. Chacune de ceslef-
fives eft enfuite examinée en particulier.
48. La diffolution alcoolique contient le plus
fouvent des muriates de chaux 8c de magnéfie ,
rarement des nitrates des mêmes bafes, fels qui
font tous déliquefcens 8c diffolubles dans l’alcool.
On les reconnoît & on en détermine la proportion
eu évaporant à ficcité cette diffolution ,
en rediffolvant les fels bien pefés dans l'eau , en
précipitant la magnéfie par la chaux, & la chaux
par l'acide fuîfurique ou par l’acide oxalique. On
peut ,pour avoir un réfultat exaét, féparer la diffolution
aqueufe en trois parties égales, décom-
pofer l’une avec Veau de chaux qui donne la quantité
de magnéfie en triplant le poids qu'on en
obtient, précipiter la fécondé par l'acide oxalique
, & la troifième par le fuîfurique ; en comparant
la dofe de ces deux précipités , en calcinant
l’oxalate, qui ne lajffe que de la chaux pure,
on a le poids exaét de la cnaux. On s'affure de
l’acide uni à ces bafes , en verfant un peu d’acide
fuîfurique concentré fur une petite portion du
réfidu obtenu de l’évaporation de l’alcool. La
vapeur dégagée fait aifément reconnoître, ou l’a»
eide muriatique , ou l’acide nitrique.
49. La leffive à l’eau froide contient des fels bien
diffolubles, le muriate.de foude, le fulfate de foude,
le fulfate de magnéfie, le nitrate de potaffe, le carbonate
de foude, jamais tous à la fois, mais quelquefois
deux Ou trois enfemble. Il faut noter cependant
cju’un peu de muriate de foude ou de nitrate
de potaffe doit avoir été diffous dans l’alcool
: avec les fels déliquefcens, mais que cette petite portion
peut être obtenue 8c ifolée par l’ évaporation.
On reconnoît & on fépare les fels diffous dans
cette leffive aqueufe, en l’évaporant avec pré»
! caution : on les obtient les uns après les autres 3
on les diftingue à leur forme, leur faveur, 8c à
toutes leurs propriétés.
yo. Dans la leffive par l’eau bouillante, il n'y a
jamais que du fulfate de chaux, que l’on reconnaît
& dont on détermine en même tems la quantité
par l’acide oxalique qui en précipite la chaux, &
par une diffolution de baryte, qui entraîne l’acide
fuîfurique. On le retire encore par l’évaporation
fous la forme de petites plaques infi-pides,
indiffolubles, qui, chauffées avec du charbon ,
donnent du fulfuré de chaux rougeâtre & fétide
au moment où on le jette dans Veau.
y 1. Le réfidu des eaux minérales traitées par les
trois diffolvans précédens, contient des carbonates
terreux avec ou fans carbonate de fer, & fouvent
mêlés d’alumine & de filice. On fait s'il y a du
feripar une couleur jaune ou rougeâtre: dans ce cas,