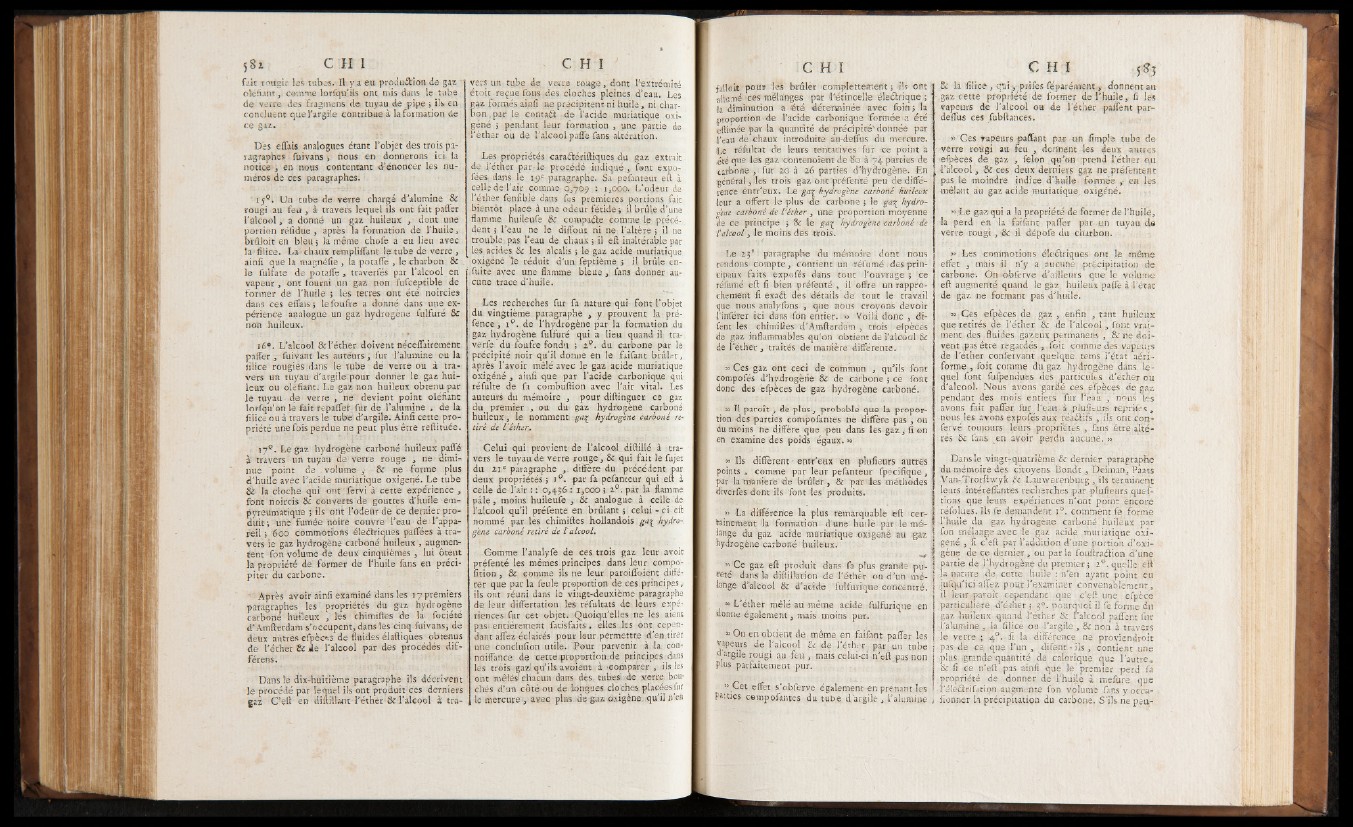
fait rotrgir les tubes. Il y,a eu production de gaz
oléfiant, comme lorfqu’lls ont mis dans le tube
de verre des fragmens; d@; tuyau de pipe ; iiv en
concluent que l’argile contribue à la formation de
ce gaz. . . r
Dés effais analogues étant l’objet des trois paragraphes
furvans i nous en donnerons ici, la
notice 3 en nous contentant d’énoncer les numéros
de ces paragraphes.
' iyQ. Un tube de verre chargé d’alumine &
rougi au feu , à travers lequel ils ont fait paffer
l’alcool, a donné un gaz huileux ,- dont une
portion rélidue, après la formation de l’huile,
brûloit en bleu ; la même chofe a eu lieu avec
la'filice. La chaux rempliffant le tube de verre ,
ainfi que la magnéfîe, la potaffe , le charbon & .
le fulfate de potaffe, traverfés par l’alcool en
vapeur, ont fourni un gaz non fufceptible de
former de l’huile > les terres ont été noircies
dans ces effais i lefoufre a donné dans une expérience
analogue un gaz hydrogène fulfuré &
non huileux.
16 ° . L’alcool Sd’éther- doivent néceffairement
paffer, fuivant les auteurs, fur l’alumine ou la
filice rougies dans le tube dé verre ou à travers
un tuyau d’argile.pour donner le gaz huileux
ou oléfiant. Le gaz non huileux obtenu par
le tuyau de verre , ne devient point oléfiant
lorfqu’on le fait repaffet fur de l’alumine , de la
filice ou à travers le tube' d’argile. Ainfi cette., propriété
une fois perdue ne peut plus être reftituée.
t Le gaz hydrogène carboné huileux paffé
à travers un tuyau de verre rouge , ne diminue
point de volume ,• & -ne -forme plus
d’huile avec l’acide muriatique oxigené. Le tube
& la cloche qui ont' férvi à cette expérience ,
font noircis & couverts de gouttes d’huile em-
pyreumatique ; ils ont l’odenr dé ce dernier produit;
une fumée noire couvre l’eau de l’appareil
; éoo commotions électriques paffées à travers
ie gaz hydrogène carboné huileux , augmentent
fon volume de deux cinquièmes , lui ôtent
la propriété de former de l’huile fans en précipiter
du carbone.
- Après avoir ainfi examiné dans les 17 premiers
paragraphes les 'propriétés du gaz hydrogène
carbone huileux , lés chimiftes de la fociété
d’Amfterdam s’occupent, dansles cinq fuivans, de
deux autres efpèces de fluides élaftiques obtenus
de l’éther & de l’ alcool par des procédés dif-
férens.
Dans le dix-huitième paragraphe ils décrivent
le procédé par lequel ils ont produit ces derniers
gaz G’eft en diltillant l’éther & l ’alcool £ travers
un tube de verre rouge, dont l’extrémité
étoit reçue fous des cloches pleines d’eau. Les
gaz formés ainfi ne précipitent ni huile, ni charbon,
par le contaCt de l’acide muriatique oxi-
géné ; pendant leur formation , une partie de
i’éther ou de l’alcool paffé fans altération.
Les propriétés cara&ériftiques du gaz extrait
de l’éther par-le procédé indiqué,, font expo-
fées,. dans le 19e paragraphe* Sa pesanteur eu à
celle de-l’air comme. Q - j o p - . ; i,opo. L’odeur de
l’éther fenfible dans fos premières portions fait
bientôt placé à une odeur fétide; il brûle d’une
flamme huileufe & compaCle comme, le précédent
; l’eau ne le diflout. ni ne l’altère ; il ne
trouble; pas. l’eau de chaux ; il eâ inaltérable par
les acides & les alcalis j le gaz acide muriatique
‘ oxigené ’te réduit d’un, feptième i il brûle en-
fuite avec une flamme bleue, fans donner aucune
trace d’huile.
Les recherches fur fa nature qui font l’objet
du vingtième paragraphe , y prouvent la ; présence,
i p. de l’hydrogèjne par la formation du
1 gaz hydrogène, fulfuré qui a lieu quand il, tra-
verfe du foufre fondu ; 1 9 . du carbone par le
■ précipité noir qu’il donne en le faifant brplsr,
j-après l’avoir mêlé avec le gaz acide muriatique
‘ oxigené , ainfi que par l’acide carbonique qui
1 ré fuite de fa combuftion avec l’air vital. Les
auteurs du mémoire , pour diftinguer ce gaz
du premier , ou du gaz hydrogène carboné
huileux, le nomment: g a^ h y d r o g é n é c a r b o n é re-
: t i r é d e l'é th e r ..
Celui qui provient de l ’alcoobdiftillé à travers
le tuyau de verre rouge , & qui fait le fujet
du 21e paragraphe ,. diffère du précédent, par
deux propriétés j 1 °. par fa pefanteur qui eft à
celle de Fair : .0,436 à i,ooo ; 2°. par la flamme
pâle, moins huileufe , & analogue à celle de
l’alcool qu’il préfente en brûlant ; celui - çi eft
nommé par les chimiftes hollandois g a^ hydro-.
g èn e c a r b o n é r e t ir e d e t a l c o o l .
Gomme l’analyfe de ces trois gaz leur avoit
préfenté les mêmes principes dans leur compo-
fition, 8e comme ils ne leur paroiffoient différer
que par la feule proportion de ces;principes,
ils ont réuni dans le vingt-deuxième paragraphe
de leur differtation, les réfultars de leurs expériences
fur cet objet. Quoiqu’elles ne les aient
pas; entièrement fatisfaits , elles .les ont cependant
affez éclairés pour leur, permettre d'en,tirer
une conclufion utile. Pour parvenir, à, la. con-
noiffance de •cette.proportioQ.de principes.dans
les trois gaz! qu’ils awoient à >compàre,r , ils les
ont mêiésl chacun dans dés. tubes* de .verre bouchés
d’un côté ou de, Longues cloches placées fur
le mercure , avec plus. de gaz üxigène.,qu’il n’eo
f a l l o l t pou» les brûler complettetnent ; ils ont
allumé 1 ces mélanges par d’étincelle électrique ;
la diminua on à été déterminée avec foin ; la
proportion de l’acide carbonique -Formée >3. été
eftimée par la quantité de précipité''donnée par
l’eau de thaux introduite ap-deffus du mercure.
Le réfultat de leurs tentatives fur ce point à
été que 'les gaz 'dontenoient de 80 à 74 parties de
carbone , fur 2.0 à 26 parties d’hydrogène. En
général , des trois gaz ont préfenté peu de différence
entr’èux. Le ga% h y d ro g è n e c a r b o n é h u i le u x
leur a offert le plus de carbone ; le ga% h y d ro gène
c a r b o n é d e ï é t h e r , une proportion moyenne
ite ce principe ; & le g a ç h y d ro g èn e c a r b o n é de
l 'a l c o o l , le moins des trois.
Le 23e paragraphe du mémoire dont nous
rendons compte, contient un réfumé. des principaux
faits expofés dans tout l’ouvrage ; ce
réfurhé eft fi bien préfenté , il offre un rapprochement
fi exaél des détails de tout le travail
que nous analyfons § que nous croyons devoir
l'inférer ici dans fon entier. *> Voilà donc , di-
fenc les chimiftes d’Amfterdam , trois elpècës
de gaz inflammables qu’on obtient de l’alcool &
de l’éther, traités de manière différente.
«Ces-gaz ont ceci de commun , qu’ils font
compofés d'hydrogène & de carbone ; ce font
donc des efpèces de gaz hydrogène carboné.
» H paroît, de plus , probable que la proportion
des parties compofântes né diffère pas , ou
du moins ne diffère que peu dans les gaz, fi on
en examine des poids égaux. »
& là filice , qui -, pwfes féparément ,■ donnent au
gaz cette propriété de former de l ’huile, fi les
vapeurs de l’alcool ou de l'éther paffent par-
deflTus ces fubftances.
» Ces tapeurs paffant pat un Ample tube de
verre rougi au feu , donnent les deux autres
’efpèces de gaz , félon qu’on prend l’éther ou
l’alcool, '& ces deux derniers gaz ne préfentent
pas le moindre indice d’huile formée,* en les
mêlant au gaz acide muriatique, oxigené.
w.*Le gaz qui a la propriété de former de l’huile,
la perd en la faifent paffer par un tuyau de
verre rougi, &: il dépofe du charbon.
» Les commotions é'ie&riques ont le même
effet , mais il n’y a aucune, précipitation de
carbone. On obferve d’ailleurs que le volume
eft augmenté quand le gaz huileux paffe à l’état
de gaz ne formant pas d’huile.
»;Cès efpèces de g a z , enfin , tant huileux
que retirés de l’éther de l’alcool, font vraiment
des fluides gazeux permanens , A: ne doivent
pas être regardés ,, foit comme des vapeurs
de l ’éther confervant quelque tems l’état aeri-
forme , foit comme du gaz hydrogène dans lequel
font fufpendues des particules d’éther ou
a alcool. Nous avons gardé ces efpèces de gaz
pendant des mois entiers fur l’eau , nous les
avons fait paffer fur l’eau ; à .plufic.urs repris s ,
nous les avons expofés aux réât5iifs , ’ils ont roq-
fervé toujours- leurs propriétés , fans être altérés
& fans en avoir perdu aucune. ^
» Ils diffèrent • entr’eux en plufieurs autres
points , comme par leur pefanteur fpécifique,
par la manière de brûler, & par ies méthodes
diverfes dont ils font les produits.
» La différence la plus remarquable feft certainement
la formation , d une huilé par-le mé>- !
lange du gaz acide muriatique oxigené au gaz j
hydrogène carboné huileux.
- !
” Ce gaz eft produit dans fa plus grande pu- j
•reté dans la diftillarion de l’éther ou d’un nié- !
lange d’alcool & d’acide fullurique concentré.
93 L’ éther mêlé au même acide fulfurique en
donne également, mais moins pur.
*> On en obtient de même en faifant paffer les
Vapeurs de l’alcool Z i de l’éther par un tube!
d argile rougi au feu , mais celui-ci n’eft: .pas non
plus parfaitement pur.
« Cet effet s’obferve également en prenant les j
parties compofântes du tube d’argile , l’alumine j
Dans le vingt-quatrième •& dernier paragraphe
du mémoire des citoyens Bondt, Deiman, Paats
Van-Trorftwyk 8e Lauwerenburg, ils terminent
leurs intéreffantes recherches par plufieurs questions
que leurs expériences n’ ont point encore
réfolues. Ils fe demandent i°. commentfe forme
l’huile du gaz hydrogène carboné huileux par
fon méjange avec le gaz acide mmiàtique oxigené,,
fi c’eft par l’addition d’une .portion d’oxi-
gène de ce dernier, ou parla fouftraélion d’une
partie de l’hydrogène du premier; 2°. quelle eft
la nature de, cette huile : n’en ayant point eu
.jufqu’ici‘aflez pour l’examiner convenablement,
il leur paroît cependant que c’eft: une efpèce
particulière d’écher ; 3?. pourquoi il fe forme du
gaz huileux quand l’éther & Faîcool paflent lur
Illumine ,1 a filice ou l’argile, & non à travers
le verre ; 40. fi la différence^ ne proviendroit
pas de ce :que l’un , difent - i ls , contient une
plus grande quantité de calorique que l'autre,
& fi ce n’eft: pas ainfi que le premier perd fa
propriété de donner de l'huile à rr.efure que
rélèélrifatiqn augmente fon volume fans y occa-
fionner la précipitation du carbone. S'ils ne peu