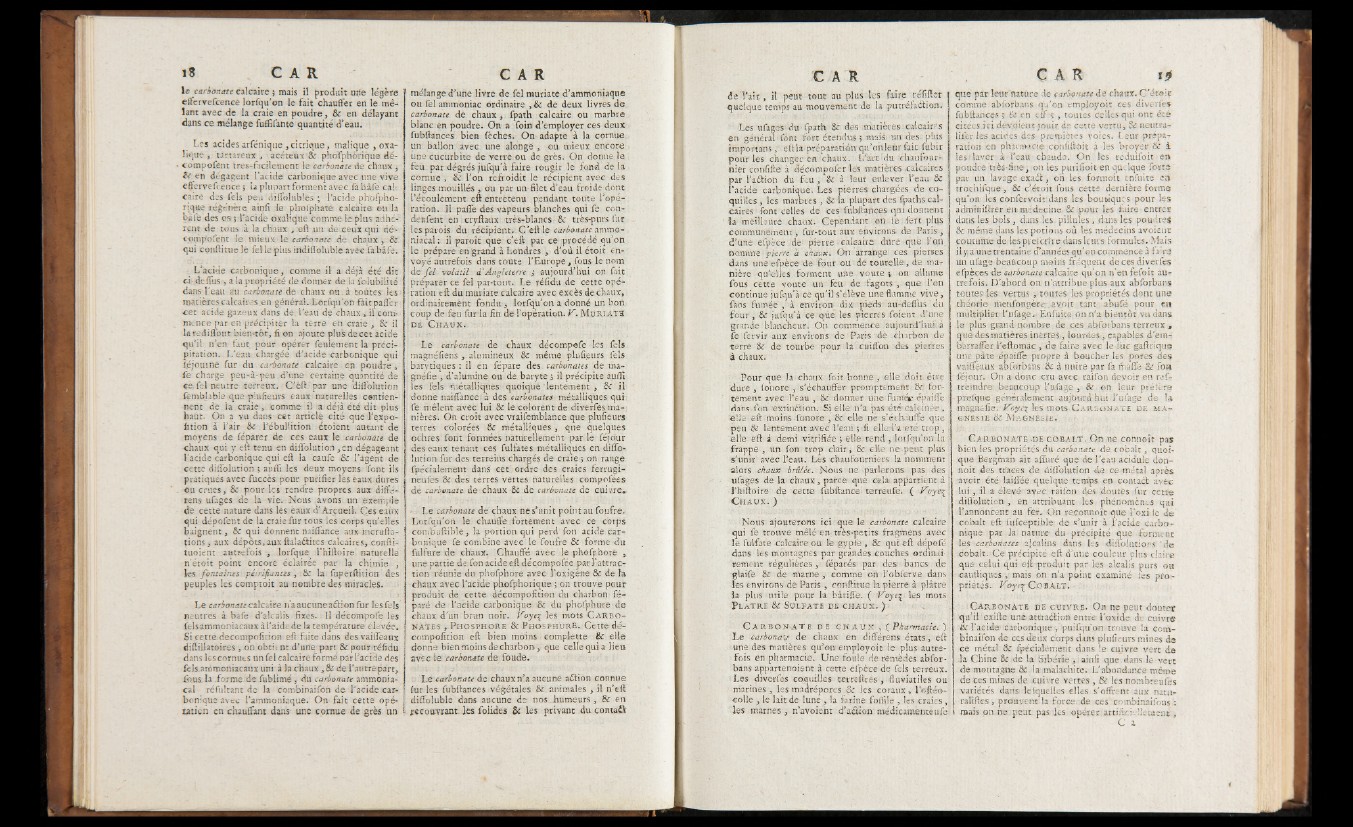
le carbonate calcaire ; mais il produit mie légère
effervefcence lorfqu’on le fait chauffer en le mêlant
avec de la craie en poudre, & en délayant
dans ce mélange fuffifante quantité d’eau.
Les acidesarfénique , citrique, malique 3 oxalique
, tartareux , acéteux & phoTphôrique dé-
compofent tres-facilement le carbonate de cliaux 3
en dégagent l’acide carbonique avec une vive
effervefcence j ia plupart forment avec fa liâfe cah
caire des fels peu diffolubles ; l’acide phofpho-
rtqtie régénère, ainfî le plrofphaté calcaire ©u la
bàfe des os j l’acide oxalique comme le plus adhérent
de tous à la chaux jceft «us de ceux qui dé-
compofent le mieux le carbonate de chaux, &
qui conftitue le felleplus indifioîubleavécTabâfe.
L’acide carbonique, comme il a déjà été dit
ci- dc-ffus , a la propriété de donner de la folubiiité
dans l’eau au carbonate de chaux ou.à toutes les ï
matièrescalcaires.en général. Locfqu'on fàîrpaÜèr
cet acide gazeux dans de l’eau de chaux* il commence
par en précipiter la terre en craie , & il
îarediflout bien-tôt, fi on ajoure plus de cet acide
qu’il n’en faut pour opéreT feulement la précipitation.
L’eau chargée d’acide carbonique qui
ï.éjourne fur du carbonate calcaire en poudre ,
fe charge peu-à-peu d’une certaine quantité de
çe fel neutre terreux. C ’èft par une diffolution
femblable que plufieurs eaux naturelles contiennent
dè la craie , comme il a déjà été dit plus
haut. On a vu dans cet article cité que Texpo-
fition à l’air Sc l’ébullition etoient autant de
moyens de féparer de ces eaux le carbonate de
chaux qui y eft tenu en diffolution ,en dégageant
l’acide carbonique qui eft la caufe & l’agent de
cette diffolution 5 aufli les deux moyens font ils
pratiqués avec fuccès pour purifier les eaux dures
Ou crues, & pour les rendre propres aux diffé-
rens ufages de la vie. Nous .avons un exemple
de cette nature dans les èaux d’Arçueil. Ces eaux
qui dépofent de la craiefur tous ies corps qu’elles
baignent, & qui donnent naiffance aux incrufta-
çions , aux dépôts, aux ftaladtites calcaires j confît
tuoient. .autrefois , lorfque Thiftoire naturelle
n'étoit point encore éclairée par la chimie ,
les fontaines pétrifiantes, . & la fuperftition des
peuples les comptoit au nombre des miracles.
Le carbonate calcaire n’a aucune aétion fur les Tels
neutres à bafe d’alcalis fixes. Il déeompofe les
fels ammoniacaux à l’aide de ia température éle vée.
Si certe-decompofition eft faite dans des vaiffeaux
diftillatoires ,.on obtit nt d’une part & pourréfidu
dans les cornues un fel calcaire formé par l’acide des j
fels ammoniacaux uni à la chaux, & de l’autre part, |
fous, la .forme de fublimé , du. carbonate ammonia^ I
cal réfuîtant de la combinai fon de Tacide :car%. J
bonique avec l’ammoniaque. On fait cette opé-
taticn en chauffant dans- une cornue de grès un
mélange d’une livre de fel ruuriate d’ammoniaque
ou fel ammoniac ordinaire , & de deux livres de
carbonate dé chaux , fpath calcaire ou marbre
blanc en poudre. On a foin d’employer ces deux
fubftances bien fècheSi On adapte à la cornue
un ballon avec une alonge , ou mieux encore
une cucurbite de verre ou de grès. On donne le
feii par degrés jufqu’à faire rougir le fond de la
cornue , & l’on refroidit le récipient avec des
linges mouillés , ou par un-filet d’eau froide dont
l’écoulement eft entretenu pendant toute l’opération.
11 paffe des vapeurs blanches qui fe con-
denfent en cryftaux très-blancs & très-purs fur
les parois du récipients C ’eft le carbonate ammoniacal:
il paroît que c’eft par ce procédé qu’on
le prépare en grand à Londres , d’oùilétoit envoyé
autrefois dans toute l’Europe, fous le nom
de fel volatil d'Angleterre j aujourd’hui on fait
préparer ce fel par-tout. Le réfidu de cette opération
eft du muriate calcaire avec excès de chaux,
ordinairement fondu, lorfqu’on a donné un bon
coup de.feu fur la fin de i’opération. K. Muriate
de C haux.
Le carbonate de chaux déeompofe les, fels
magnéfiens, alumineux & même plufieurs Tels
bary tiques : il en fépare des carbonates de ma-
gnéfie , d’alumine ou de. baryte 5 il précipite suffi
les fels métalliques quoique lentement , &: il
donne naiffancefà des carbonates métalliques qui
fe mêlent avec lui & le colorent de diverfes manières.
On croit avec vraifemblanceque plufieurs
terres colorées & métalliques, que quelques
ochres font formées naturellement par le féjour
des eaux tenant ces fulfates métalliques en diffolution
fur des terréins chargés de craie ; on range
fpécialement dans cet., ordre des craies ferrugi-
neufes & des terres vertes naturelles eompofées
de carbonate de chaux & de carbonate de cui we*
Le carbonate de chaux ne s’ unit point au fonfre.
Lorfqn’on le chauffe f ortement avec ce corps
combuftible, ia portion qui perd fon acide carbonique
fe combine avec le foufre & forme dit
fulfure de chaux. Chauffé avec le phofphoré ,
une partie dcTon acide eft déçompofée par l’attraction
réunie du phofphoré avec Toxigène & de la
chaux avec l’acide phofphorique ; on trouve pour
produit de cette décompofition du charbon fé-
paré de l’acide carbonique & du phofphure de
chaux d’un brun noir. V^oye^ les mots C arbonates
, Phosphore & Phosph'ure. Cette décompofition
eft bien moins complette & elle
donne bien moins de charbon, que celle qui a lieu
avec ie. carbonate de fou de.
Le carbonate de chaux n’a aucune aélibn connue
fur les fubftances végétales & animales , il n’eft
diffoluble dans aucune de nos.humeurs, & en
1 recouvrant les folides & les privant du contaft
de l’aie-, il peut tout au plus les faire réfifter
quelque temps au mouvement de la putréfadfion.
Les ufages; du - fpath 3c des .matières : calcaires j
en générai font Tort étendus 5'mai& un; des. plus
importons, eft là préparation qu’on leùr fait fubir
pour les changer en chaux. L’ârt du chaufour- j
nier confifte' à décompofer les matières calcaires ■
par l’aéfcion du feu , §c à leur enlever l’eau. &
î’açide carbonique. Les pierres chargées de coquilles
, les marbres , & la plupart des fpaths calcaires
font celles de ces fubftances qui donnent
la meilleure chaux. Cependant on-le Ter c plus
communément, fur-tout aux environs de Paris, j
d’une efpèce j de pierre calcaire dure que l’on
fiomme pierre a. chaux. On atrangei ces pierres
dans une efpèce de four ou de tourelle , de mar
niére qu’elles forment une voûte *, on allume
fous cette voûte-un féti de fagots, que Ton
continue jufqu’à ce qu’il s’ élève une flamme vive,
fans fumée , à environ dix pieds ati-deffus. ’ du
four, & jufqu’à ce que les pierre s foient d’une
grande blancheur. On commence aujourd’hui;!
fe fervir aux environs de Paris de charbon de
terre & de tourbe pour la cuiffon des pierres
à chaux.
Pour que la chaux foit bonne, elle .doit être j
duré, fouore , s’échauffer promptement & for- j
;tèment avec l’eau , & donner une fhmée épaiffe
dansffon èxtin&ion. Si elle n’a pas étécalcinée, ;
elle eft moins Tonore , & elle ne s’échauffe que j
peu & lentement avec Peau ; fi elleTa‘été trop, |
elle eft à demi vitrifiée ; elle rend ,dorfqu’on la >
frappe , un fon trop clair, & elle ne peut plus?
s’unir avec l’eau. Les chaufourniers la nomment !
alors chaux brûlée. Nous ne parlerons pas dès
ufages de la chaux, parce que cela appartient à ;
fhiftoire de cette fubftance. terreufe. { Voye^\
C haux. )
Nous ajouterons ici que le carbonate caleaire f
qui fe trouve mêlé en très-petits fragmens avec'
le fulfate calcaire ou le gypîè , & qui eft dépofé
dans les montagnes par grandes couches ordinai rement
régulières féparés par. des bancs d e ,
glaife & de marne -, comme on Tobferve dans
les environs de Paris , conftitue la pierre, à plâtre
la plus utile pour la bâtifl'e. ( 'Vüfe\ les mots
Plâtre & Sulfate de chaux. ) >
C A R B O NA t e DE CHAUX ( Pharmacie. )!j
Le carbonate, de chaux en différens états, eft
une des matières qu’on employoit le plus autrefois
en pharmacie. Une foule de remèdes abforbans
appartenoient à cette efpèce de fels terreux.
Les diverfes coquilles terreftres , Tluviatiles ou
marines, les madrépores & les coraux, Toft-io-
colle, le lait de lune, la farine foflile, les craies,
les marnes, n’aVoiént d’aélion médicamenteufe
que par leur natûre de carbonate dé chaux. C ’étoic
comme abforbar.s qu’on employoit ces diverfes
fubftances en effr.t, toutes celles qui ont été
citées ici devdienç jouir, de. cette vertu, & neutra-
lifer lès acides des premières voies. Leur prép-a-f
ration ien pharmacie coufiftoit à lès broyer & à
lesilaver à Teau chaude. On les réduifoit en
poudre très-fineon les purifloit en quelque forte
par un lavage exaél, oh les formoit enfui te en
trochil'que , & c’étoit fous cette dernière forme
qu’orn les côn fer voit dans les bouwques pour les
admihiftrer eii médecine. & pour les faire - entrer
dans les bols, dans les pillules, dans les poudres
& même «dans les potions où les médecins avoient
coutume dei Jes prefcrke dans leurs formules. Mais
ily, a une trentaine d’années qu’on commence à faire
un ulage-beaucoup moins fréquent de ces diverfes
efpèces de carbonate calcaire qu’on n’en fefoit autrefois.
D’abord on n’attribue plus aux abforbans
toute? les vertus, toutes les propriétés dont une
théorie-, menfongère avoit tant abufé pour en
multiplier l’ufage,,: Enfuite on n’a bientôt vu dans
le plus grand nombre de ces abforbans terreux ,
que des matières inertes-, lourdes, capables d’ern-î
; barraffer l’eftomac, de Taire avec le Tue gaftriqua
une pâte épaifte propre à boucher les pores des
vaiffeaux abforbans &: à nuire par fa maffe & fon
'féjour. On a donc cru avec raifon devoir en ref-
trèindre? beaucoup Tufage , & on leur préfère
-pfefque généralement aujourd'hui l’ufage de la
magnéfie. Vcye^ les .mots.Carbonate de magnésie
& Magnésie.
C a r b o n a t e -de cob a l t. On ne connoît pas
bien les propriétés du carbonate de cobalt, quoique
Bergman ait affuré que de Teau acidulé don-
noit des traces de diffolution de ce métal après
avoir-été laiffée quelque;temps en contact avec
lu i, il a élevé avec; raifon des doutés fur cette
diflolution , en attribuant les phénomènes qui
l’annoncent au fer. On reconnoît que Toxi:le de
cobalt eft fiifceptible de s’unir à Tacide carbonique
par lai nature- du précipité que forment
les carbonates ajcalins dans les diffolutions 'de
Cobalt. Ce précipité eft d’une couleur plus claire
que celui qui elkproduit par les alcalis purs ou
- eauftiques, mais on n’a point examiné les propriétés.
Voye^ C ob a lt. -.
Careonate de cuivre. On ne peut douter
qu’il exifte une attraélion entre l’oxide de cuivre
& Tacide carbonique, puifquon trouve la com-
binaifon de ces deux ebrps dans plufieurs mines de
ce métal & fpécialement dans le cuivre vert de
Ja Chine & ;de la Sibérie , ainfî que dans le vert
de montagne 2e J a malachite. L’abondance même
de ces mines de cuivre vertes, & les nombreufes
variétés dans lefquelles elles s’offrent aux nata-
raliftes , prouvent la force, de ces combinaifons :
l mais pn.na.peut pas ies opérer attincidleineiii ,
C i