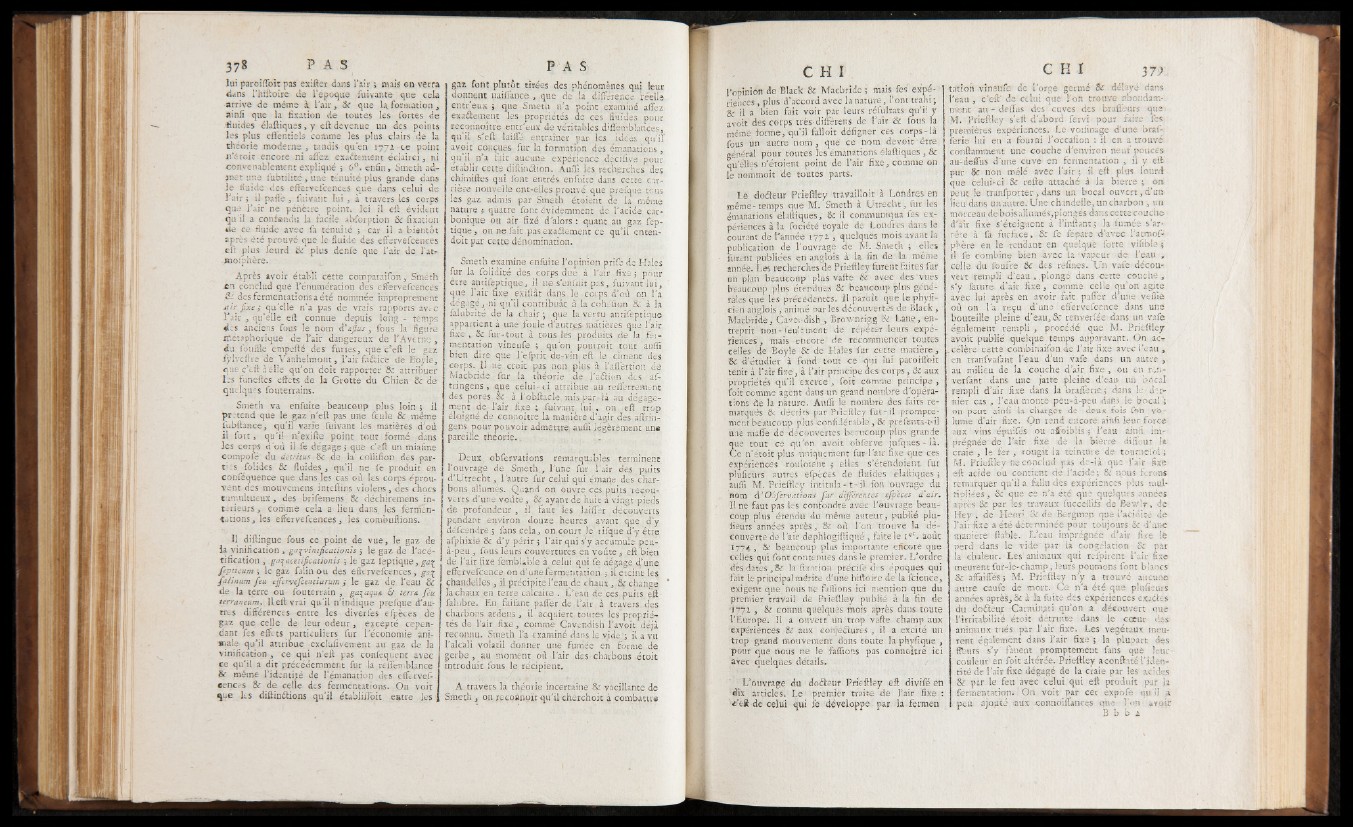
lui paroi (Toit pas exifter dans l’air ; mais ou verra
dans l’hi'ftoire de l’époque fuivante que cela
arrive de même à; l’air , âc que 1^. formation ,
ainfi que la fixation de toutes les fortes de
fluides élaftiques, y eft devenue un des points
les plus effentiels comme les plus clairs de la
théorie moderne , tandis qu’en 1772 ce point
n’étoit encore ni affez exactement éclairci , ni
convenablement expliqué 5 6°. enfin, Smeth admet
une fubtilité, une ténuité plus grande dans
Je'fluide des effervefcences que dans celui de
l’air 3 il pafiè , fui vaut lui , à travers les corps
que l’air ne pénètre point. Ici il eft. évident
qa il a confondu la facile absorption & fixation
de ce fluide avec fa ténuité 5 car il a bientôt
après été prouvé que le fluide des effervefcences
eft plus lourd & plus .dénié que l’air de l'ats-
.jnofphère.
Après avoir établi cette comparaifon, Smeth
en conclud que l’énumération des effervefcences
;2c des fermentations a été nommée improprement
a ir fixe j qu’elle n’a pas de vrais rapports avec
l’ air j qu’elle eft connue depuis long - temps
des anciens fous le nom Waffés , fous la figure
métaphorique de l’air dangereux de l’Averne ,
du fouffle empefté des furies, que c’eft le gaz
fylveflre de Vanheïmont, l’air faétice de Bbyle,
que c’eft à elle qu’on doit rapporter 8c attribuer
les funeftes effets de la Grotte du Chien 8c de
quelques foucerrains.
Smeth va enfuite beaucoup plus loin 5 il
prétend que le gaz n’eft pas une feule & même
iubftance, qu’il varie fuivant les matières d’où
il fort, qu’il n’exifte point tout formé dans
les corps d’où il fe dégage} que çeft un miafme
compofé du détritus 8c de la collifion des partes
folides & fluides , qu’il ne fe produit en
conféquence que dans les cas où les corps éprouvent
des mouvemens inteftins violens, des chocs j
tumultueux, des brifemens ,8c déchiremens intérieurs
, corfime cela a lieu dans, les fermentations
, les effervefcences , les combuflions.
Il diftingue fous ce point de vue, le gaz de
la vinification , ga^vimficationis 3 le gaz de l’acétification
, ga^acetificationis j le gaz ieptique, ga%
fepticum; le gaz falin ou des effervefcences, ga%
falinum feu effcrvefcentiarum ÿ le gaz de, l’eau &
de la terre ou fouterrain , ga^aqua & terra, fêu
terraneum. U eft- vrai qu'il n’indique prefque d’autres
différences entre les diverfes efpèces de
gaz que celle de leur odeur, excepté cependant
fes effits particuliers fur l’économie animale
qu’il attribue exdufivement au gaz de la
vinification, ce qui n’eft pas conféquent avec
ce qu’il a dit précédemment fur la reiïèmblance
&■ même l’identité de l’émanation des. effervef-
eences 8c de celle des fermentations. On voit
que les diftinétions qu’il établirait entre les ;
gaz font plutôt tirées des phénomènes qui leur
donnent naiffance , que de la différence réelle
entr’eux} que Smeth n’a point examiné allez
exactement les propriétés de ces fluides pour
reconnoître entr’eux de véritables. d«fièrr.blançes,
qu'il s’eft laiffé entraîner par- les idées qu’il
avqit conçues fur la formation des émanations,
qu’il n’a fait aucune expérience décifive pour
établir cette diftinétion. Auflî les recherches des
chimiftes qui font entrés enfuite dans cette carrière
nouvelle ent-eîles prouvé que prefque tous
les gaz admis par Smeth étoient de la même
nature 5 quatre font évidemment de l’acide carbonique
ou air fixé d’alors : quant au gaz. fep-
tique, on ne fait pas exactement ce qu’il enten-
doit par cette dénomination.
Smeth examine enfuite l’opinion prife de Haies
fur la folid'ité des corps due. à l’air fixe ; pour
être analeptique, il ne s’enfuit pas, fuivant lui,
que l’air fixe exiftât dans le corps d’où on l’a
dégagé,-ni qu’il contribuât à la cohéfion & à la
falubrité de la chair; que la vertu anrifeptiqu©
appartient à une foule d’autres matières que l'air
fixe & fur-tout à tous les produits de la fej-
mentation vineufe ; qu'on pouf toit- tout aufii
bien dire que l ’efpric-de-vinj.eft le ciment des
corps. 11 ne croit pas non plus à l’aflèrtion de
Mac.bride fur la théorie de l’aérion des af~
tringens, que celui-ci attribue au refferrement
des pores. & à J’obftacle mis par-là au dégagement
de l’air fixe ; fuivant lui , on eft trop
éloigné de connoître la manière d’agir,des affrin-
gens pour pouvoir admettre, auffi légèrement une
pareille théorie..
Deux, obfervations remarquables terminent
l’ouvrage de Smeth., l’une fur l’air des puits
d’Utrecht, l ’autre fur celui qui émane des'charbons
allumés. Quand on ouvre ces puits recouverts
d’une voûte, St ayant de huit a vingt pieds
de profondeur , il faut les laiffer découverts
pendant environ douze heures avant que d’y
défeendre 3 fans cela, on court Je' rifque d’y être
afphixié 8c d’y périr 5 l’air .qui s’y accumule peu-
à-peu, fous leurs couvertures en voûte, eft. bien
de l’air fixe femblable à celui qui fe dégage d’une
efferveicence ou d’une fermentation ; il éteint les,
chandelles , il précipite l’eau de chaux, 8c change
la chaux en terre calcaire . L’eau de ces puits eft
falubre. En-fai fan t paffer de l’air à travers, des
charbons ardens , il acquiert toutes' les propriétés
de l’air fixe, comme Càvendish l’avoit déjà
reconnu. Smeth l’a examiné dans le vjde"; il a vu
l’alcali volatil donner une fumée en forme de
gerbe, au moment où l’air des- charbons étoit
introduit fous le récipient.
A travers la théorie incertaine 8c vacillante de
Smeth, on reconnoit qu’il cherchoit à combattre
l’opinion de Black & Macbrîde ; mais fes expériences
, plus d’accord avec la nature, l’ont trahi;
g- il a bien fait voir par leurs réfultats qu’i! y
avoir des corps très différehs de l’air & fous la
même forme, qu’il H R défigner ces corps-là
fous un autre nom, que' ce' nom dév.oit être
général pour toutes les émanations élaftiques, •&
qu’elles n’étoient point de l’air fixe, comme on
le nommoit de toutes parts.
Le doifteiif Prieftley trâvailîoit à Londres, en
même-temps que M. Smeth à Utrecht, fur les
émanations élaftiques, 8c il communiqua fes expériences
à la fociété royale de Londres dans le
courant de l’année 1772. , quelques mois avant la
publication de l’ouvrage de M. Smeth ; elles»
furent publiées en anglois à la fin de la même
année. Les recherches de Prieftley furent faites fur
un plan beaucoup plus vafte 8c avec des vues
beaucoup plus étendues & beaucoup plus générales'que
les précédentes. Il paroît que le phyfi-
cien anglois, animé par les découvertes de Black, '
Macbride, Cavei di'ih , Brownrigg <k Lane, entreprit
non-Teultment de répéter leurs expériences,
mais encore' de recommencer toutes
celles de Boy le & de Piales fur cette matière,
8c d’étudier à fond tout ce qyi lui paroifloit
tenir à l’air fixe, à Pair principe des corps, 8c aux j
propriétés qu’il exercé, foit comme principe , f
ibit comme agent dans un grand nombre d’opéra- :
tiens de la nature. Ànflr le nombre des faits re- :
marqués 8c décrits par Prieftley fut-il promptement
beaucoup plus confidérablé, 8c préfenta-t-il
u;re maffe de-découvertes beaucoup plus grande
que tout ce qu’on avoit obfervé jufques - là.
Ce n’étoit plus uniquement fupl’air:fixê que ces
expériences rouloient ; elles s’étendoient fur
plufieurs autres efpèces de fluides élaftiques 3
auflî M. Prieftley intitula - t- i) fon ouvrage du
nom d ‘ Ojfervcitions fur différentes efpeces d'air.
ïl ne faut pas les confondre avec l’ouvrage beaucoup
plus étendu du même auteur, publié plufieurs
années après, 8c où l ’on trouve la découverte
de l’air dephlogiftiqu’é , faite le Ier. août
1774, & beaucoup plus importante eficore que
celles qui font contenues dans le premier. L’ordre
des dates, 8c la fixation pré.cife des époques qui
fait le principal mérite d’une hiftoirc de la fcience,
exigent que nous ne faflions ici mention que du
premier travail de Prieftley publié à la fin de
-1772 , 8c Connu quelques mois après dans toute
l’Europe. Il a ouvert un trop vafte champ aux
expériences 8c aux Conjectures , il a excité un
trop grand mouvement dans toute la phyfique ,
pour que nous ne le faflîor.s pas connoître ici
avec quelques détails.
' L’ouvrage du doéteur Prieftley eft divifé en
dix articles. Le premier trake de l’air fixe :
^’eft de celui qui fe développe par la fermen
tatioh vineüfe de l'orge germé 8c délayé dans
l’eau, c’eft' de celui que l’on trouve abondamment
au - deffus des cuves des braffeurs que •
M. Prieftley s’eft d’abord fervi pour faire fes
premières expériences. Le voifinage d’une braf-
ferie lui en a fourni l’occafion : il en a trouvé
conftamment une couche d’environ neuf pouces
au-deftîis d'une cuve en fermentation , il y eft'
pur 8c non mêlé avec l’air; il eft plus lourd
que celui-ci & refte attaché à la bierre ; on
peut Je trânfporter, dans un bocal ouvert,d’un
■ lieu'dans un autre. Une chandelle, un charbon, un
morceau de bois allumés,plongés dans cette couche
d’âlr fixé s’éteignent à l’inftant} la fumée s’arrête
à fa furface, 8r fe fépare d’avec l’atmof-
phère en le rendant en quelque forte vifible ;
il fe combine bien avec la ‘vapeur de l’eau ,
celle du foufre 8c des réfines. Un vafe découvert
rempli d’eau, .plonge dans cette couche,
s’y fature d’air fixe, comme celle qu’on agite
avec lui après en avoir fait paffer d’une veille
où on l ’a reçu d’une effervefcence dans une
bouteille pleine d’eau, 8c renverfée dans un vafe
également rempli , procédé que M. Prieftley
avoir publié quelque temps auparavant. On acr
.célère cette combiriaifon de l’air fixe avec l’eau ,
en tranfvafant l’eau d’un vafe dans un autre,
au milieu de la couche d’air, fixe, ou en ren-
verfawt dans une jatte pleine d’eau un bocal
rempli d’air fixe dans la brafferie 5 dans le dernier
cas , l’eau monte peu-à-peu dans le bocal }
on peut ainfi la charger de deux fois fon volume
d’air fixe. On rend encore ainfi leur force
aux vins épuifés ou affoiblis 3 l’eau ainfi imprégnée'de
l’air fixe de la bierre diffout la
craie , le fer, rougit la teinture de tourneioi 3
M. Prieftley ne conclud pas de-là que l’air fixe
eft acide ou contient de l’acide ; & nous ferons
remarquer qu’il a fallu dès expériences plus multipliées
, 8c que ce n’a été que quelques années
après & par les travaux fucceflifs de Bev/lv, de
Hey ; de Henri oc de Bergman que l’acidité de
l’air fixe a été déterminée pour toujours 8c d’une
manière ftable. L’eau imprégnée d’air fixe ife
perd dans le vide" par la congélation 8c par
la chaleur. Les'animaux qui refpirent l’air fixe
meurent lur-le-champ, leurs poumons font blancs
8c affaiffés } M. Prieftley n’y a trouvé aucune
autre caufe de mort. Ce n’a été que plufieurs
années après, & à la fuite des expériences exabtes
du doéteuf Carminati qu’on a découvert que
l’irritabilité étoit détruite dans le coeur des
animaux tués par l’air fixe. Les végétaux meurent
également dans l’air fixe 5. la plupart des
ffeurs s’y fanent promptement fans que leur
couleur en foit altérée. Prieftley aconftaté l’identité
de l’air fixe dégagé de la craie par les acides
8c par le feu avec celui qui eft produit par la
fermentation. ' On voit par cet expofé qu’il a
peu- ajouté vaux connoiffances que l'on avoir
B b b i