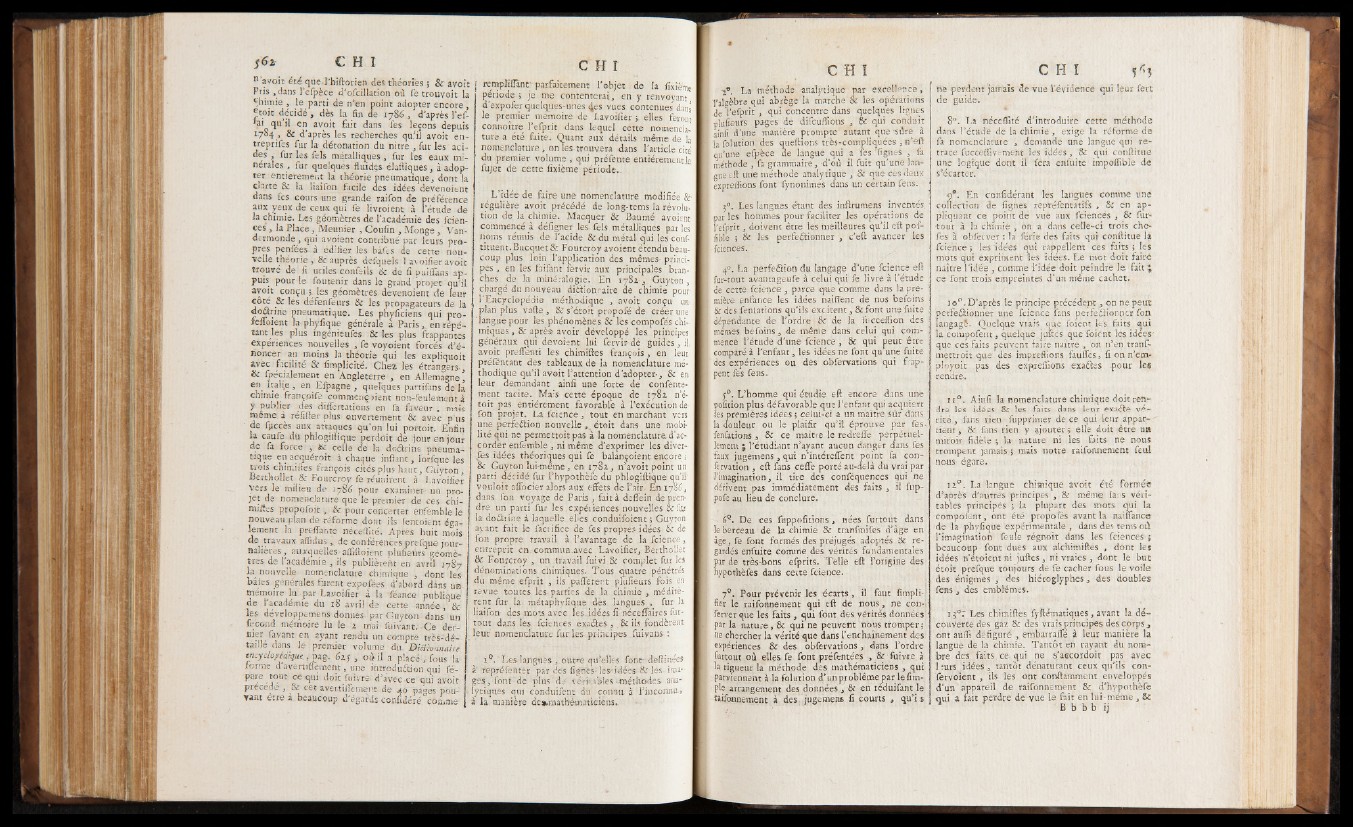
n'avoit-été que.l'hiftorien des théories ; & avoit f
Pris , dans l’efpèce d’ofcillation où fe trouvoit la
Chimie , le parti de n'en point adopter encore,
£toit décidé , dès la fin de 1786, d'après l’ef-
*ai quil en avoit fait dans fes leçons depuis
L7°4.» & d'après les recherches qu'il avoit en-
treprifes fur la détonation du nitre , fur les acid
e s , fur les fels métalliques , fur les eaux minérales
, fur quelques fluides- élafiiques, à adopter
entièrement la théorie pneumatique, dont la
clarté & la liaifon facile des idées, devenoient
dans fes cours une grande rai fon de préférence
aux yeux de ceux qui fe livroient à l'étude de
la chimie. Les géomètres de l'académie des fcien-
ce s , la Place, Meunier , Coufin , Monge,. Van-
dcrmonde, qui a voient contribué par leurs propres
penfées à édifier les bâfes de cette nouvelle
théorie , Sc auprès defquels I avoifier avoit
trouvé de fi utiles confeils & de fi puiffans appuis
pour le foutenir dans le grand projet quil
avoit conçu.> les géomètres devenoient de leur
coté & les défendeurs & les propagateurs de la
doctrine pneumatique. Les phyficiens qui pro-
feffoient la phyfique générale à Paris en répétant
les plus ingénieufes & les plus frappantes
expériences nouvelles , fe voyoient forcés d'énoncer
aii moins la théorie qui les expliquoit
avec facilité & fimplicité. Chez les étrangers-,
& fpéciajement en Angleterre , en Allemagne^
en Italie, en Efpagne , quelques partifans de là
chimie françoife commençaient non-feulement à
y publier des diflertations en fa faveur , mais
même, à réfîfter plus ouvertement & avec p us
de fjjccès aux attaques qu'on lui por-toit. Enfin
la caufe dû phlogifiique perddit de jour en jour
de fa force , &c celle de la doctrine pneumatique
en acquéroit à chaque inftant, lorfque les
trois chimiftés François cités plus haut, Guy ton,
Berthollet & Fourcroy fe réunirent à Lavoifier
vers le milieu de 1786 pour examiner- un projet
de nomenclature que le premier de ces chi-
miftes p r o p o fo i t& pour concerter enfemble le
nouveau.plan de réforme dont ils fentoient également
la. preffante néceftîtéi Après huit mois
de travaux affidus ,. de conférences prefque journalières
, auxquelles affiftoient plufieürs "géomètres
de l'académie , ils publièrent en avril 1787
la^ nouvelle nomenclature chimique , dont les
baies générales furent expofées d'abord dans un-
mémoire lu par Lavoifier à la féance publique'
de l'académie du 18 avril de cette année ; &
lés développemens donnés, par Guy ton dans un
fécond mémoire lu le 2 mai: fuiva-nt,-Ce ^er-
nier favant en ayant rendu un compte très-détaillé
dans le premier volume du, D i f rm m a i r e
tn c y c lo p é d tq u e , pag. 62 ƒ , où il a placée fous la
forme d avertiffement, une introduction qui fé-
pare tout ce qui doit fuivre d'avec-ce qui avoit
précédé , & cet avertiflement de 40 pages pou-
Yant etre a beaucoup d'égards confidéré comme
lempliffanr parfaitement- l'objet de la fixîeme
période ; je me contenterai, en y renvoyant
d'expofer quelques-unes ^es vues contenues dans
le premier mémoire de Lavoifier 5. elles; feront
connoître l'efprit dans lequel cette nomenclature
a été faite. Quant aux détails même de la
nomenclature, on les trouvera dans l'article cité
du premier volume , qui préfente enriérementle”
fujet de cette fixième période..
/ L'idée de faire une nomenclature modifiée &
régulière avoit précédé de long-tems la révolution
de la chimie. Macquer & B.aumé avoient-
commencé à défigner les fêls métalliques par les
noms réunis de l'acide 8c du métal qui les conf-
muent. Buequet & Fourcroy avoient étendu beaucoup
plus loin l'application des mêmes- principes
j en les faifant fervir aux principales branches
d e la minéralogie. En 1781-,.. Guy ton -,
chargé du nouveau diétionraire de chimie pour
l'Encyclopédie méthodique , avoit conçu un
plan plus vafte , & s'étoit propofé de créer une
langue pour les phénomènes 8c lès compofés chimiques
, 8c après? avoir développé les. principes
généraux qui dévoient lui fervir* dé guides, il
avoit prefienti les chimiftés françois , en leur
préféntant des- tableaux de la nomenclature méthodique
qu'il avoit l'attention d’adopter-, & en
leur demandant ainfi une forte de confente-
ment tacite. Mais cette époque de 1782 11'é-
toit pas entièrement favorable à l'exécution de
fon projet. La. fcience, tout en marchant vers
une perfection nouvelle étoit dans une mobilité
qui ne permettoit pas à la nomenclature d'accorder
enfemble, ni même d’exprimer les diverses
idéès théoriques qui fe balançoient encore ;
& Guyton lui-même, en 1782, n'avoit point un
parti décidé fur l'hypothèfe du phlogifiique qu'il
vouloit afibcier alors aux effets de l'air. En 1786,
dans fon voyage de Paris , fait à deffein de pren-
I dre un parti fur les expériences nouvelles & fur
la doCtîi-pig. à laquelle elles conduifoient ; Guyton
ayant fait le facrifice de fes propres idées> & de
fon propre travail à l'avantage de la fcience,,
entreprit en commun .avec Lavoifier, Berthollet
& Fourcroy , un travail fuivi 8c complet fur les
dénominations chimiques. Tous quatre pénétrés
du même, efprit , ils pafferent- plufieurs fois en
revue toutes lès-parties de la chimie , méditèrent
fur la métaphyfique dès langues , fur la
liaifon- des mots avec leslidées fi néceffai,res fur-
tout dans les fciences exactes, & ils fondèrent
leur nomenclature fur les-principes fuivans :
lP. Les-la.ngues, outre qu'elles font-défiinées
à repréfenter par dés lignes-les^idées 8: les-images,
font de plus de vé-rkables-méthodes analytiques
qui conduifent du connu à l’inconnu»
à là. manière de*.matbématiciéns..
i®. La méthode analytique par excellence,
l ’algèbre qui abrège la marche 8c les opérations
de l ’efprit, qui concentre dans quelques ligues
ylufîeurs pages de di fou fiions, & qui conduit
ainfi d'une manière prompte autant que sûre à
5îa folution des quefhons très-compliquées , n’eft
qu'une efpèce de langue qui a fes 'figues , fa
méthode , fa grammaire, d’où il fuit qu’une langue
eft une méthode analytique , 8c que ces deux
exprellions font fynonimes dans un certain f e ns.
2°. Les langues étant des inftrumens inventés,
.par les hommes pour faciliter les opérations de
Fefprit., doivent être les meilleures qu’il eft pof-
fible 5 & les perfectionner , c’efi avancer les
fciences.
4°. La perfection du langage d’une fcience eft
fur-tout av-antageufe à celui qui fe livre à l’étude
de cette fcience, parce que comme dans la pre- ;
mière enfance les idées n ai fient de nos befoins
& des fenlations qu’ils excitent, & font une fuite .
dépendante de l ’ordre & de la fiicceffion des ;
mêmes bèfoins, de même dans celui qui corn- .
niénce l’étude d’une fcience, & qui peut être \
comparé à l ’enfant, les idées ne font qu une fuite
des expériences ou des obfervations qui frappent
fes fens.
50. L'homme qui étudie eft encore dans une ‘
pofition plus défavorable que l ’enfant qui acquiert
les premières idées $ celui-ci a un maître sûr dans ‘
la douleur ou le plaifir qu'il éprouve par fes,
fenfations, & ce maître le redreffe perpétuel- ;
lement 5 l'étudiant n'ayant aucun danger dans fes •
faux jugemens, qui n'intéreffent point fa con-
fervation , eft fans cefle porté au-delà du vrai par .
f imagination, il tire des conféquences qui ne !
dérivënt pas immédiatement des faits , il fup- |
,pofe au fieu de conclure.
- 6Q. De ces fuppofitîons, nées furtout dans
le berceau de la chimie & tranfmifes d'âge en
âge,fe font formés des préjugés adoptés & re -;
gardés enfuite comme des vérités fondamentales
par de très-bons efprits. Telle eft l’origine des
hypothèfes dans ceite fcience.
70. Pour prévenir les écarts, il faut fimpli-j
fier le raifonnement qui eft de nous , ne con-ii
ferver que les faits , qui font des vérités données 1
par la nature, & qui ne peuvent nous tromper;
ne chercher la vérité que dans l’enchaînement des
expériences & des obfervations, dans l'ordre
furtout où elles fe font préfentées , & ' fuivre à
la rigueur la méthode des mathématiciens , qui
parviennent à la folution d’un problème par lefim-
ple arrangement des données., & «n réduifant le
raifonnement à des jugemens lï courts j qu’i s
ne perdent jamais 5e vue l’évidence qui leur fert
de guide.
8°. La néceflité d'introduire cette méthode
dans l’étude de la chimie , exige la réforme de
fa nomenclature demande une langue qui retrace
fucceflîvement les idées, & qui conftitue
une logique dont il fera enfuite impoffible de
s'écarter.
0*; En confidérant les langues comme une
collection de lignes repréfentatrfs , en appliquant
ce point de vue aux fciencés , & fur-
tout à 1a chimie , on a dans celle-ci trois cho-
fes à obferver l ’ la férié des faits qui conftitue la
fcience; les idées qui rappellent ces faits ; les
mots qui expriment les idées. Le met doit faire
naître l’idée , comme i'idée doit peindre le fait £
ce font trois empreintes d’un même cachet.
io°. D’après le principe précédent, on ne peut
perfe&ionner une fcience fans perfedtionpor fon
iangagë. Quelque vrais que foient les faits qui
la composent, quelque jufees que foient les idees'
que ces faits peuvent faire naître , on n'en tranf-
mettroit que des impreffions fauffes, fi on n’ecn-
ployoic pas des exprefiions exaêtes pour le«
rendre. :
i i °. Ainfi la nomenclature chimique doit rendre
les idées 8c les faits dans leur exaéle vérité,
farrs rien fupprimer de ce qui leur appar- '
tient, 8c. fans rien y ajouter; elle doit être ua
miroir fidèle ; la nature ni les faits ne nous
trompent jamais ; mais notre raifonnement feul
nous égare.
12°. La langue chimique avoit été formé«
d'après d'autres principes , 8c même fans véritables
principes ; la plupart des mots qui la
compofent, ont été proposés avant la naiffance
de la phyfique expérimentale , dans des tems où
l'imagination feule régnoit dans les fciences ;
beaucoup font dues aux alchimiftés , dont les
idées n'étoient ni juftes, ni vraies , dont le but
étoit prefque toujours de fe cacher fous le voile
des énigmes , des hiéroglyphes, des doubles
fens a des emblèmes.
1 3°r Les chimiftés fyftématiques, avant la découverte
des gaz 8c des vrais principes des corps *
ont auflî défiguré , embarraffé à leur manière la
langue de la chimie. Tantôt eii rayant du nombre
des'Faits, ce qui ne s’accordoit pas avec
Durs, idées, tantôt dénaturant ceux qu’ils con-
fervoient , ils les ont conftamment enveloppés
d'un appareil de raifonnement & d'hypothèfe
qui a fait petdre de-vue le fait en lui-même , &
B b b b ij