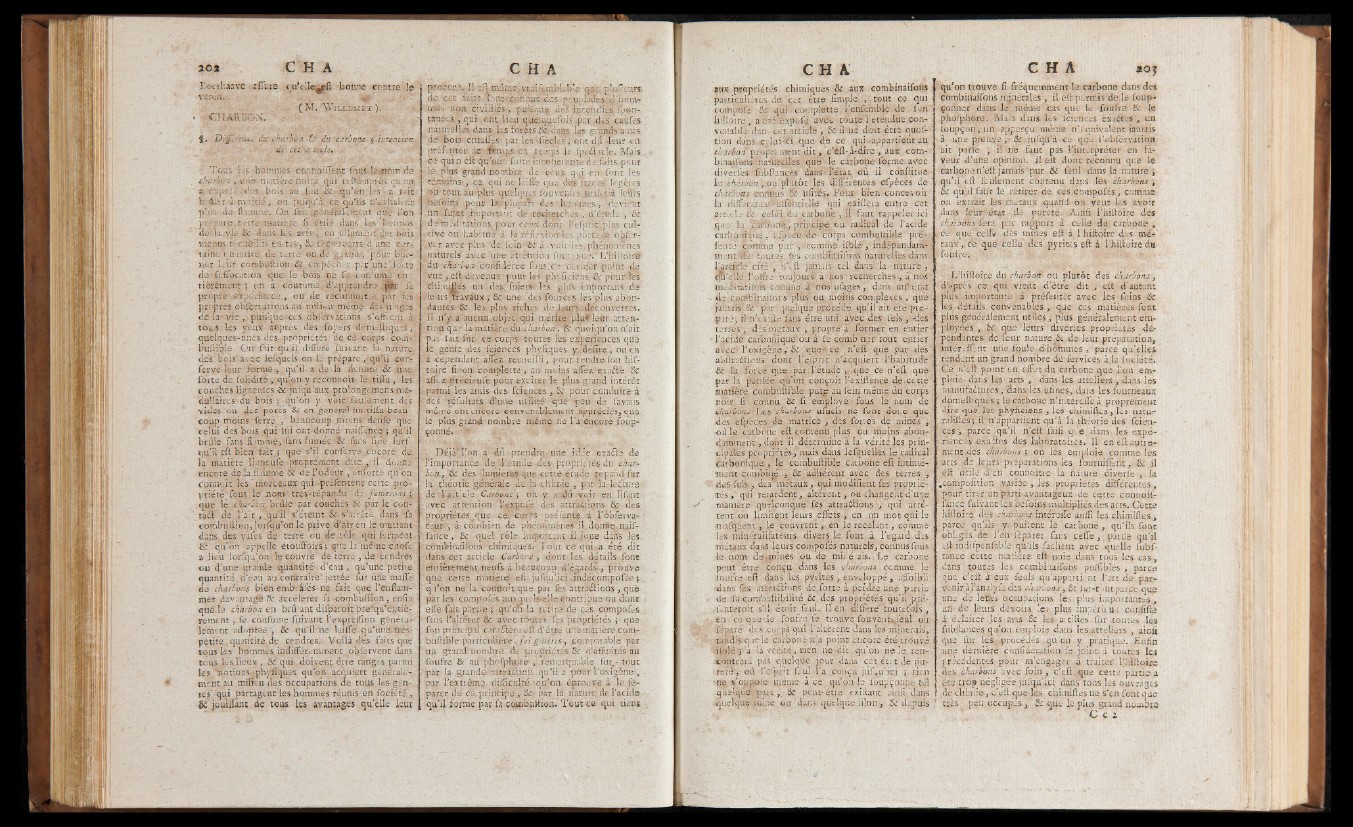
Bocrl.aave îffiire cu’eile^ft bonne contre le
venin., -
(M . WlLLEivIET )v
>;• CHARBON. .:.q '
Différence dur.çkarbon «pf du 'carbone ÿ intentiez
:• de' cet'>a,sreje. m
Tous las hainmes connoillent fous- le*nom de
fjtàrwn vmèf.ma.tière.n'oiï^ qui rtftè:»pr%qii;.opi.
». expoii des bois au qésTa- feit
fcrâler à-moitié,. ou. j^fqu'à' ee qu'ils ifexbalêht?
pi iis de-; flammé... Qa Takigénéf*â.Ufh'ent "que l’on-
prépare cette matière fi utile d»ns^l^‘:Teibi»s
de?4a v ie& dan&fesi artfô|;' en aUgmaritdes bois,
menus recueillis en tas, 8 c e e r *
taille euincité d^.terrë"'ou-de p ién-, gRu.
lier leur combuftion &.. èmji^nej:-.-p; r lunéjjlî te
de .fiifTocation quelle bois ée f%CQn’urne en .
tièrement > on a coutume!, d'apprendre ; par fà
propre -expérîënce., ou de reconnoit'^;par fes
propres. obfervatiq.ns.au milieu- pîêrné 'des*trfagb.s
dê-la- vie y puifquô' ces .cbfefyàtio'ns S4ôffrer|| Il
-tou S : les yeux auprès, des -foyers 'deniéftiquys J*
quelques-tinesUlès. -prdprié^és''de ce corps cp.rr--;
btiuible On fait qu’il cl i fibre fui vaut la nature
des bpislavec lefquels on le prépare ,qqu’ii coii?
ferve leur forme, qu'il a de Ta denûté & une
forte de foiiditéÿ qif pn y rèconaoït le tiffu, les
couches ligneules-& jufqu'aux .prbldngemensmér
dullaires- du bois ? qu’on* y voit feulement des
vides ou des pores & en général un tiffu beaucoup
moins ferré beaucoup moins denfe que
relui des bois qui lui ont donné naiifance 5 qu’il
bride fans fl i m me i • fans finné e Mc fa n s Tu je lorf
qulileft bien fait $ que sTl conferve Encore dé-
la matière ligneufe .pEoprbinfintL-dite,;,, : U~.'Sbahe '
encore deJaft.ùriniè &”de l’odeur 3 enforte. qu’on
connoît les moreaux qui -préfentenr cevte^pro- ;
prié té' fous • le nom très- répandu ' de jfumeron$j
que lé .cKa'ÿbii brûle par couches 6c patde'con-
ta é ld e
eombufti&n, îqrfqu’pn le prive d'air en le mettant
dans, des yàfes d|£ terré ou de itôfe qui ferméat
■ ët qu’orr -appelle étouffoirs} que lrniême chofe
a lieu lorfqulôn - le couvre' de terre | de tendres
ou d’une grande quantité* •• d’eau j; qu’ une'petite,
rntité d’eau au contrài'fé! jettée fur ùfïe m.affé
charbons bien enibîâfé& ne fait que l’enflammer
davantage & accélérer fà combuftion ,_ enfin
quë.fè charbbn en bru ant difpâroît prefqu''ëntièr
rement, fe confume fuiyant l’expreffion générar
lefntnt adoptée., & qu'il ne laifle' qu*ii'riëi'frèsV
petite .quantitéde cendres.- Voilà dès faits que
tous les hommes.indifféremment pb fer vent dans,
tous les lieux ,. qui ^doivent. être rangés parmi
lès 'notions-? phyfiques qu’on acquiert généralement
au milieu des occupations de tous.les genres
qui partagent les ..hqmm.es réunis en fociéte ,
ët jouiilant de tous les avantages qu'elle leur
procuré. .11 cil 65ui^e^v-rai:lmbl.ib‘e g:îî; plufteurs
de ces faits 1 rm.sqpomius/ ces. p eupJades :j,tvh0;m-
inés non; Civiiiites 3 puÜqa^ des incend^s. fpon-
tanecs^qui.ont. lieu quelquefois parades caufes
naturelles dans les forêts Hans, lés-grands am.as
de-ibois' esTtailés par les 'fièdesîÿ ont dd -»leur efl
préfèter de ^ù^sren At^.ir.|sie ,fp;e<^.ic|e. Mais
ci qui néil qu’une.fui te incohérence de faits.peur
le . plus grand nombre de ceux .qin èn -font les
tém^ins-.^c^. qui lie kiïïe que d(^ t^ces slégeres
otr tout âuéplns quelques.fouvbuirs viriles à léàfs
befbms pour la piup-af r des hommes., de vient
un fujst important de rechercb.es, d’émas 3 -&
T-de^Mît^ibns^p'our ceux donp .lbfpritvplus cul-
■ rivé ou Kabitué- a la réfleviqn les porte à.obfcr-
bver avec plus 'de: foin &z à.-vôir-les^ p^énorrienes
naturels’ avec "unek'ttëhtidh fo ut; r- ue. L’h i ftô i r è'
[àiY-charbon- ’cOhfidéréè fo^séCéi'de rnier poiéït ^
vue ^efl d^yépue -pour les phyßcisns?^ pourries
chim^es «n des; fujers Ms riBSt importans de
deurs travaux 16ç'»UBeèdes fôuECfî.d$s••plus abondantes
& les, plus richcs de leurs découvertes.
11 lï’y .a aucun|objet- qrii niéjitè;;plu¥leur atten-
tîon quev. l a - q u o i q u ’on n’ait
pas fait fur ce corps toutes les expériences que
.’is . genie ;des -feiences- phyfîqüés y^édélife.é on en
à Cependant àffèz recueilli, pour-réndre fon hif»
toirè finon:..completté.au: moins affez-éxaèlè &
afïlz ipréoifufe po'ur exckei le plus grand intérêt
parmi les amis-des fciences 3r& pour conduire à
'dej;*fëfuitats d’une utilité' -qtïév%eu de 'fayans
même ;ont encor er convenablement appréciés3 que.
le plus grand nombre même me l’a encore foup-
çonné. .
% Déjà* l’on a dtV.ptenflr^kUtîe' l'dteê ÿexâélê. de
l’importance de,;|Kétude-ddes- propriétés du charbon,
'& des. ;lumières qujg-cet«teH|tude re pancî fur
la ^théoriè ^générale de la chimie 3 par la lecture
de ' l’article Cainbone '-, oh y aodû voir en lifant
_avec attention^ i^xpofé' des at’trallions. % des
propriétés que. ce, corps pré fente à-l’ôbferva-
teur 3 à combien de phénomènes’il.donne n.aif-
; fahee, | '$tr quel rôle-, import^iit il|oue dariS les
cômfeinâifohs^chiihiquéStT’out^ eéqui ,a été dit
dans .cet arti c Carbone ^ dont-les détails Tont
entièrement neufs à béatieoup.T-égardsI3 prouve
qde beite matièreb efl jufq.uU.ci.dndécompofée ^
qu'on neia' conno’t.que par fes’-artra&ions 3 què
par les compofés auxqucis-elle contribue ou dont
elle fait partie > qu’ob la retire de ces compoïes
fans l'alterer & avec toutes fes propriétés j que
fon ptinciprii caraélère éü d’être une matière com-
biifliblé^rticuHèVé'i3j»f|^/2«rii'3 ?çqthpafable ^p‘ar
un grand nombre de pro prié té s 8e d’affinités' au
foufre & au phofphpre-Tfëmarquabl.e fui;- tout
par- la- g^andçoattr^qiqfi qu’il à- poèr l’oxigëne-,
■ par l’éxtiême dißiculfe -:qu?on. éprouye.à le fé-
parer dé ce, |)rincipe>: &y par là. riaturè de. l’acide
qu’il formé par fa cosibufiion. Tout ce qui tiens
?ux propriétés chimiquès & .aux combinaîfons
particulières de cet être iimple , tout ce qui
compofe 5-r qui complette l’enfemble de Ion
h iïlo ir e a été. expofé avëç toute léteudu'e;con-
veUable dam cet article 3 8e il ne doit ^être quef-
tion dans, .celui-ci que de ce qui- appartient au
charbon proprement,dit., c’eil-à-dirô, aux combinai
fons f n at'ù re il e s que le carbone forme avec
diverlès fubflances dans l’état où il confUtue
le chhrbëfiJj iQ^ plutôt; les différentes efpéces • de-
charbons connus 8è iificés. Pour bien eoneev'oir
h' ..di^éi;4nc^ëlBtitiwlM qui exiflera entre, cet
article' fe. celui ;iftu.,î:ArJ?.ojde-3 il faut rappeler ici
que M: é^fboîiëq principe ou radical de l’acide
carbonique 3 ufpèce^fâe'corps combuitibleprë-;^
fente comme pqf^cpmmé■ ivfôlé 3 iridépeiuiam'-;
mentMeAputéSt les combînaifonS naturelles dans:
l’article cité 3 u’d l jamais tel dans la nature /
qu’elle l’offre- toujours; à nos - recherches-3; ài nos
méditations comme à nos ufages 3 dans uni état
de combinai! or s plus ou moins complexes , que
jaui.ïis & 4 par quelque procédé qu’il ait été préparé,
il n’exiiee fins être.uni avec des tels 3 -des
terres’, dis métaux, propreJ'à’ former en'entier
l’acide carbonique- ou à fe cqmb nar tout encier
avec' l’ oxigene, & q u e l ce n’eiï que par des
a-biiractions dont l’eipnt n’acquiert l'habitude
& la force que par l'étude.., que ce n’efl. que
par la penfée qu’on conçoit l’exiflençe de.cettè
matière corobultible puce au fein même du corps
noir fi 'connu & fi employé : lbus le nom de
charb'on. i Ltshdiarbons ufuels ne fon t do: ; c que
des efpeces, de matrice , des fores dè mines ,
où le carbone eft cotitenu pliis où moins abon-
d.ammèntvj dqnt il détermine a la: véritéles pri-n-
cipales propriétés, mais dans; Jefquèllês le radical
.carbonique, ,Te combuftible carbone eft intimé-,'
ment combiné , & adhérent avec des terres ,
des Tels , des* métaux, qui modifient fes propriétés
, qui fetjardent, altèrent, ou changent'd’upe.
M qui arrêtent;
où limife.nt leurs .effets en un mot qui le
mafquent, le couvrent.,, en le recelant, comme
- les minéraliiateurs- divers^ le; font à, Tégard^ dis
métaux dans leurs compofés naturels, connus fous■
le nom déi|nines ou de miré ais.i Le carbone
peut êtré? conçu vdan$ - les chfarbqns ' comme ie
foutre eft dans -les pyrites,.enveloppé, rÆoibli
:dans fes attraétions dé forte à perdre une p irde
de fa comb'jftibiiité & des propriétés qu’ii pré-
,f;nte.roit s’il ét.oit feui. Il en ,difiere' toutefois ,
.én . ce que Je. foufre (e trouve fou-yent^féul ou
.féparé d^s .corps qui l’ altèrent dans les minerais,
tandisfquéle carbone-n^a pointléncore. été tfbuy.é
iiblé|| à . là v é i r i . ë .n . ne dit qu’.on ne lé. reii-
:c outre m pas quelque jour dans cet. etc t de, pureté:,
où I’ciprit féiil Ta conçu jufqu’ici j rien
ne s’opp.ofe même à ce
.quelque, paît &-• peut- être e xi'tant aijjfi' dans
iqueldue inine ou dans quelque, iiionr, depuis
qu’on trouve fi fréquemment le carbone dans des
combihaifon.s rmnérales , il eft permis de le foup-
çodner dans le même' cas que le fôufré & lé
phbfphore. Mais dans Us fciences éxaéles , un
lbupçdn, .un. apperçu même n’équivalent jamais
à une preuve,- jufqiTà ce que l’obferyatioiï
ait parlé , il nè faut pas l’interpréter en fay
yeur d’une opinion, ile it donc reconnu que le
carbone n’eft jamais 'pur & feuT dans la nature
qu’il eft feulement contenu dans les. charbons 1
éc qufilfaut le retirer de, ces,compofés, comme
on extrait les métaux .quand on veut les avoir
dans leur: état dé, pureté. .Ainfi i’iiiftoire des
charbons fera par rapport à celle du carbone ,
r;ceqqué^elf® .dès mines eft à rhiftoire dès mé-‘
ta u x c e que celle des py rite s eft à 1 hiftoire d»
Toùff efr m
L’hiftoire dû charbo/i ou plutôt des. charbons. 3
d’après c e . qui vient. d’être >dit ; eft d’autant
pLüs: importante à préfenter avec les -foins .&
les détails convenables , que ccs matières font
plus généralement utiles , plus, généralement employées
, 6c que leurs diveries propriétés dé-
pendantes de leur nature fit de: leur préparation,
inter.- (Ttnt uîie.fbale d'hoTnmes , parce qu’elles
rendent un-grand nombre de fervices àja fociétéi
Ce n’éft point en elfe t d u.ca r b 0 n e., que,T on emploie
dans lcs arts , dans-les. atteliers , dans les
■ m a n ufaéliir esj, â ansyle s ufinès, dans les fourneaux
dpmeftjques j le carbone n’intéreffe à proprement
dire que les-: phyfîciens , les drimiftes, dès oatu^
raliftes ; il n’appartient qu’à la théorie des 'fciences
, parce" qu’il n’eft iaifî qi e dans, les expériences
exaltes des laboratoires. Il en eft autrement
des charbons,}; on les em ploie comme les
uarts de leurs : préparations les. fourni fTeù t , dgè il
eft utile d'en connoître la naMiré diverlè-, k
.cqmpofition; ; variée, les propriétés différentes „
pour tirer un parti avantageux de cette .connoil-
| fance..fuiyant ies befoins multipliés des.^rcs,.Cetçe
hiftoire des|charbons intérelfe aufii les chimiftes ,
parce qu’ils y. puifent ïè '.carbone , qu’ils, font
’ obligés de l ’èn feparer fins- celle 3i parce qu’il
eft indifpenfabîe: qu’ils fâchent avec quelle fubf-
tancé idette matière eft unie dans tous* les cas-,
dans tputss les cc.înbinai fons poftîbles , parce
oué c’eit . f eux feuls qu’appartient Tart de par-
v.eniràl’anaiyfedes charbons s, lur-t mtpareeque
une de leùrs occupations les plus importantes,
un de le tu s devoirs les plus impérieux confifte
à éclairer des. arcs ' éc les. ai tiftes - fur .toutes les
fubftances qa’on emploie (dans les atteliers , ainfi
que fur le^procédês ^qn'011 y pratique. Enfin
urié dernière confldérâticn fe joint,à toutes les
j récéclentes pour m’engager à traiter rhiftoire
.des. .ghtirborts'- ayée. ..foin que cette partie.»
été ‘trop négligée ■ jùfq.udci dans tous les ouvrages
;dè chimie,.c’eft que les chimiftes ne s'en font que
très ,' peu.occupes , éc que le plu,s grand nomore
C e i