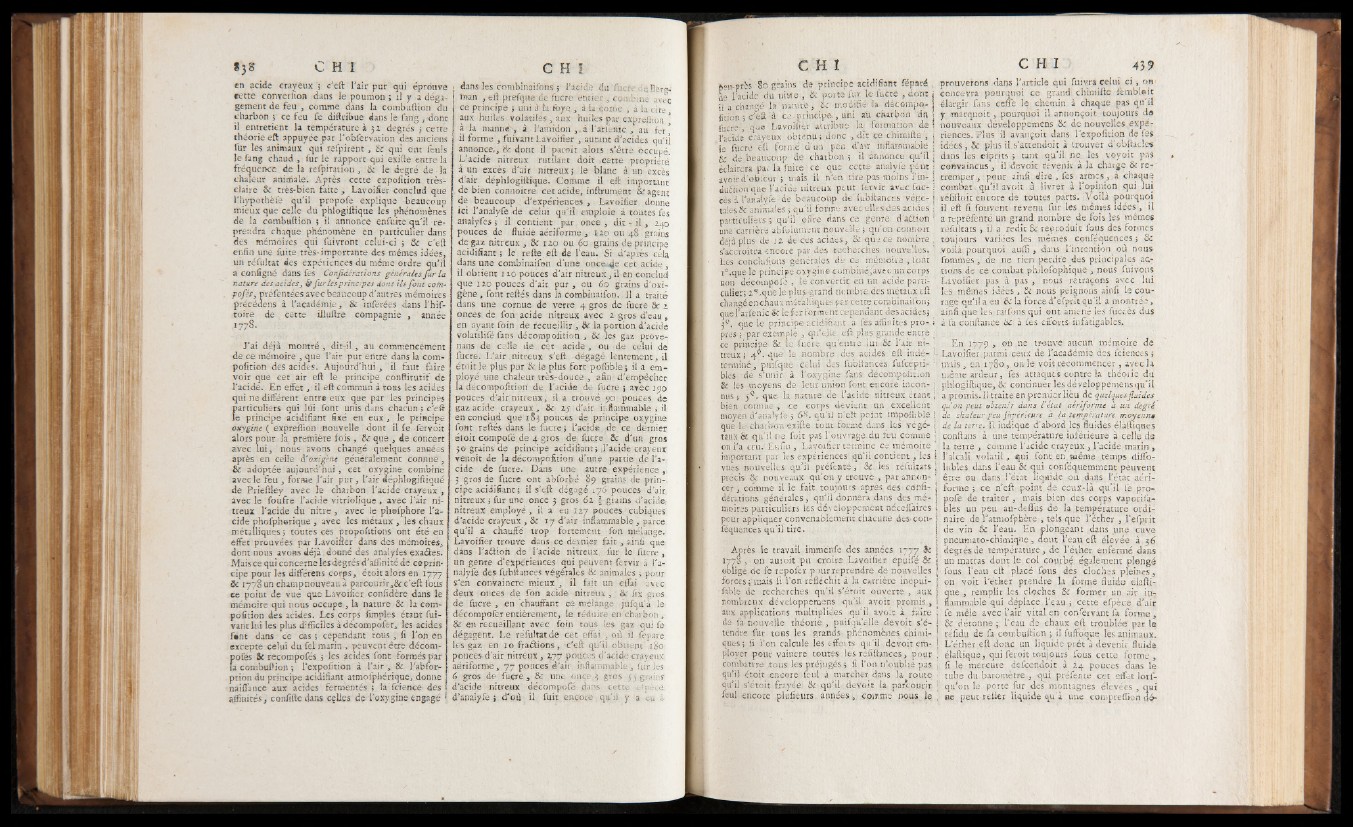
en acide crayeux c’eft: l’air pur qiii éprouve
eette converhon dans le poumon j il y a dégagement
de feu , comme dans la combuftion du
charbon 3 ce feu fe diftribue dans le fan'g , dont
il entretient la température à 3 2 degrés 5 cette
théorie eft appuyée par l’obfervation des anciens
fur les animaux qui refpirent, 8e qui ont feuls
le fang chaud , fur le rapport qui exifte entre la
fréquence de la refpiration, 8e le degré de la
chaleur animale. Après cette expofïtion très-
claire 8e très-bien faite , Lavoifier conclud que
l’hypothèfe qu’il propofe explique beaucoup
mieux que celle du phlogiftique les phénomènes
de la combuftion ; il annonce enfuite qu’il reprendra
chaque phénomène en particulier dans
des mémoires qui fuivront celui-ci j & c’eft
enfin une fuite tres-importante des mêmes idées,
un réfultat des expériences du même ordre qu’il
a configné dans fes Conjîdcrat ions générales fur la
nature des acides , éP fur les principes dont ils font coin-
pofés3 préfentées avec beaucoup d’autres mémoires
précédens à l’académie, & inférées dans l’hif-
toire de cette iliuftre compagnie , année
,1778.
J’ai déjà montré, dit-il, au commencement
de ce mémoire , que l’air pur entre dans la c.om-
pofition des acides. Aujourd'hui, il faut faire
voir que cet air eft le principe conftitutif de
l'acide. En effet , il eft commun à tous les acides
qui ne différent entre eux que par les principes
particuliers qui lui font unis dans chacun 3 c’eft
le principe acidifiant fixé en eux / le principe
oxygine ( expreifion nouvelle dont il fe fervoit
alors pour la, première fois , & que , de concert
avec lui, nous-avons changé quelques années
après en celle d’ oxigénc généralement connue,
& adoptée aujourd’hui , cet oxygine combiné
avec le feu , forme J’air pur, l’air déphlogiftiqué
de Prieftley avec fe charbon l’acide crayeux ,
avec le foufre l’acide vitriolique , avec l’air nitreux
l’acide du nitre , avec le phofphore l’acide
phofphorique , avec les métaux , les chaux
métalliques 3 toutes ces propofitions ont été en
effet prouvées par Lavoiner dans des mémoires,
dont nous avons déjà, donné des analyfes exaâes.
Mais ce qui concerne les degrés d’affinité de ceprin-
cipe pour les différens corps, étoit alors en 1777
& 1778 un champ nouveau a parcourir,& c’eft fous .
ce point de vue que Lavoiner. confidère dans ‘le
mémoire qui nous occupe, la nature & la corn-
pofition des acides. Les corps fimples étant fui-
vantlui les plus difficiles àdécompofer, les acides
font dans ce cas 5 cependant tous, fi l’on, en
excepte celui du fel marin , peuvent être décom-
pofés 8c recompofés 3 les acides font forméspar
la combuftion ; l’expofition à l’air , & l’abfor-
ption du principe acidifiant atmofphérique, donne
naiffance aux acides fermentés ; la fcience des
affinités, confifte dans celles de Toxygine engagé
> dans les combir.aifons 3 l’acide du fuciV cfo Bergman
, eft prefque de fucre entier , combiné avec
ce principe 3 uni a la Ébye , à la corne , à la cire
aux huiles volatiles, aux huiles par expreifion *
à la mannè^, à l’amidon,.à l'artenic . , au fer*
il forme , fuivant Lavoifier , autant d’acides qu’il
annonce,, & dont il 'parent alors s’être occupé.
L’acide nitreux rutilant doit mette propriété
à un excès d’air nitreux > le blanc à un excès
d’air déphlogiftiqué. Comme il eft important
. de bien connoître cet acide, inftrument & agent
de beaucoup J d’expériences , Lavoifier donne
ici l’analyfe de celui qu’il - emploie à toutes fes
analyfes 3 il contient par once , dit - il , 240
pouces de fluide aériforme , 120 ou 48 grains
de gaz nitreux , & 120 ou 60 grains de principe
\ acidifiant} le refte eft de l’eau. Si d’après cela
dans une combinaifon d'une once^de cet acide ,
: il obtient n o pouces d’air nitreux,il en conclud
; que 120 pouces d’air pur , eu 60 grains d’oxi-
gène, font reftés dans là combinaifon. 11 a traité
dans une cornue de verre 4 gros de fucre & 2
onces de fon acide nitreux avec 2 gros d’eau,
en ayant foin de Recueillir, & la portion d’acide
volatilifé fans décompolition , & les gaz prove-
nans de celle de cet acide, ou de celui de
fucre. L’air nitreux s’eft dégagé lentement, il
étoit le plus pur 8c le plus fort poffible 3 il a employé
une chaleur très-douce , afin d’empêcher
la décompofition de l’acide de fucre} avec, 190
pouces d'air nitreux, il a trouvé 90 pouces de
gaz acide crayeux, & 25 d’air inflammable j il
enconçiiyi que 183 pouces de principe oxygine
font reftés dans le fucre} l’acide de ce dernier
étoit compofé de 4 gros de fucre &r d’un gros
30 grains de principe acidifiant} ,1’ acide crayeux
venoit de la décompofition d’une partie de l’acide
de fucre. Dans une. autre expérience,
3 gros de fucre ont abforbé 89 grains de principe
acidifiant} il s’eft dégagé 176 pouces d’air
nitreux3 fur une once 3 gros 6z § grains d’acide
nitreux employé, il a eu 127 pouces cubiques
d’acide crayeux , 6c 17 d’air inflammable , parce
qu’il a chauffé trop fortement fon mélange.
Lavoifier trouve dans ce dernier fait, ainfi que
dans l’aétion de, l’acide nitreux, fur le fucre,
un genre d’expériences qui peuvent fervir à i’a-
nalÿfe des fubftances végétales & animales ; pour
s’en convaincre mieux , il fait un effai avec
deux onces de fon acide nitreux, 8e fix gros
de fucre , en chauffant ce mélange jufqu’à le-
décompofer entièrement, le réduire en charbon ,
8c en recueillant avec foin tous les gaz qui fe
dégagent. Le réfultat de cet , effai , où il fepare
les gaz en 10 fractions, -c’eft qu’il obtient .180
pouces d’air nirreux, 277 pouces d’acide crayeux
aériforme, 77 pouces d'air ihflammable, for les
6 gros de fucre , 8c une once . 3 gros j y grains
d’acide nitreux décompofé dans cette elpècé
d’analyfe > d’où il fuit encore qu’il y a eu i
psu-près 80 grains de principe acidifiant féparé ,
de l'acide du uivte , & porté fur le lucre , dont j
ii a changé la narute, te modifié1 la décompo- j
fition } c’eft a ce principe, uni au charbon du j
fucre , que Lavoifier attribue la^ formation de |
l’acide crayeux obtenu} donc , dit ce chirmfte , •;
le fucre eft formé d’un peu d’air inflammable J
g: de.beaucoup de charbon » il annonce qu’il 1
éclairera |af la fuite ce que cette analy fe peut j
avoir d'obfcur } mais il n’en rire pas moins fin-j
duélion que l ’acide nitreux peut fervir avec, foc-j
cès à l’analyië'de beaucoup defubftances végë- j
taies & animales 3 qu’il forme avec elles des acides ;
particuliers § qu’il offre dans ce genre d'aétioîi;
une carrière abfoluvnent nouvelle 5 qu’on ccnnoit
déjà plus de 12 de ces acides, & que ce nombre ,
s’accroîtra encore par des recherches nouvelles. ’
Les conduirons generales de ce mémoire , font
i°.que le principe oxygine combiné^avcc un corps
non décompofé , le convertit en un acide particulier}
2^ .que le plu^-granid nombre des métaux eft
prouverons dans l’article qui fuivra celui c i , on
concevra pourquoi ce grand chimifte fembfoit
élargir fans ceîfe le chemin à chaque pas qu'il
y mafqup.it, pourquoi il annonçoit toujours do
nouveaux développemens & de nouvelles expér
riences. Plus il avançoit dans 1 expofïtion de fes
idées, & plus il.s’atcendcit à trouver a’obftades
dans les eiprits ; tant qu’il ne les voyoit pas
convaincus , il devoir revenir à la charge & retremper.,
changéenefiaux métalliques par cette combinaifon}
quel’ arfênic & le fer forment cependant desacides;
39. que le principe acidifiant a fes affinités pro- ;
près 3 par exemple , qu’ejle eft plus grande entre ;■
ce principe & J e fucre qu'entra liai 8e l’air ni- i
treux} 49. que le nombre des acides eft indé- y
terminé, puifqne celui des fubftances fufeepti.- 7
blés de s’unir à l’oxygine fans décompofition .
& les moyens de leur union font encore incon- ;
nus ; y9. que la nature de l’acide nitreux étant j
bien connue, ce corps devient un excellent -
moyen d’ analyfe 3 6^. qu’il n’elt point impofiible \
que le charbon exifte tout formé dans les végé- \
taux & qu’il ne foit pas l’ouvrage.du feu comme \
on i’a cru.' Enfin , Lavoifier termine ce mémoire
important par les expériences qu’il contient , les |
vues nouvelles qu’il préfente i & les réfuitats 1
précis & nouveaux qu’on y trouve , par an non- \
cer, comme il le fait toujours après, des confédérations
générales, qu’ il donnera dans des mémoires
particuliers les développement néceffaires
pour appliquer convenablement chacune des-con- j
féquences qu’il tire.
Après le travail imménfe des années 1777 Sc j
17.781 on arnoit pu croire Lavoifier épuifé &
obligé.de fe repofer pour reprendre de nouvelles
forces yimis fi l’on réfléchit à la carrière inépui-
fable de recherches, qu’il s’étoit ouverte , aux
nombreux développemens qu’il avoit promis.,
aux applications multipliées qu’il avoit à faire
de fa nouvelle théorie, puifqu’clle devoir s’é- :
tendre fur tons les grands phénomènes, chimiques;
fi l’on calcule les effoits qu'il devoir employer
pour vaincre toutes les réfiftanc.es, pour ’
combattre .tous les préjugés > fi l’on n’oublie pas j
qu’il étoit encore feu 1 à marcher dans la route
qu’il s’étoit frayée & qu’il devoir la parcourir ;
feul encore plufieurs années , coi^me nous le ,
pour ainfi dire, fes armes, à chaque
combat , qu’il avoit à livrer à l’opinion qui lui
réfiftoit encore de toutes parts. Voilà pourquoi
il eft fi fouvent revenu fur les mêmes idées, il
a repréfenté un grand nombre de fois les mêmes
réfuitats , ii a redit & reproduit fous des formes
toujours variées les mêmes conséquences 3 &
.voilà pourquoi auffi, dans l ’intention où nous
fommes, de ne rien perdre des principales actions,
de ce combat philofophique , nous fuivons
Lavoifier pas à pas, no,us retraçons avec lui
les mêmes idées, & nous peignons ainfi le courage
qu’il a eu & la forced’efprit qu’il a montrée,
ainfi que les raifons qui ont amené les fuccès dus
à fa confiance te à fes efforts infatigables.
En 1779 > on ,ne trouve aucun mémoire de
Lavoifier,parmi ceux de l’académie des fciences}
mais , en 1780, on le voit recommencer, avec la
même ardeur, fes attaques contre la théorie du
phlogiftique, & continuer les développemens qu’il
a promis. Il traite en premier lièu de quelques fluides
qu on peut obtenir dans Vétat aériforme a un degré
de chaleur peu flnvérieure a la température moyenne
de la terre. Il indique d’abord,les fluides élaftiques
conftans à. une température inférieure à celle de
la terre , comme l'acide crayeux , l ’acide, marin ,
l'alcali volatil, qui font en,même temps diffo-
lubles dans l’eau & qui conféquemment peuvent
être ou dans l’état liquide pu dans l’état aériforme;
ce n’eft point de ceux-là. qu’il fè propofe
de traiter , mais bien des corps vaporifa-
bles un peu au-deffus de la . température ordinaire
de j ’atmofphère , tels que l’éther , l’efprit
de vin -& l’eau. En plongeant dans une cuve
pneumato-chimique, dont l’eau eft élevée à 3 6
degrés de température, de l’éther enfermé dans
un raatras dont le col courbé., également plongé
fous l’eau eft placé fous des cloches pleines,
on voit l'éther prendre la forme fluide élafti-
que , remplir les cloches & former un air inflammable
qui déplace. l’eau } cette efpèce d’air
fe mêle avec l’air vital en conservant fa forme ,
& détonne ; l'eau de chaux eft troublée par le
réfidu de fa combuftion 3 il fuffoque les animaux.
L’éther eft donc un liquide prêt à devenir fluide
élaftique, qui feroit toujours fous cette forme,
fi le mercure defeendeit à 24 pouces dans le
tube du baromètre , qui préfente cet effet lorf-
qu’on le porte fur des montagnes élevées , qui
ne peut relier liquide qu’à une compreffion dé