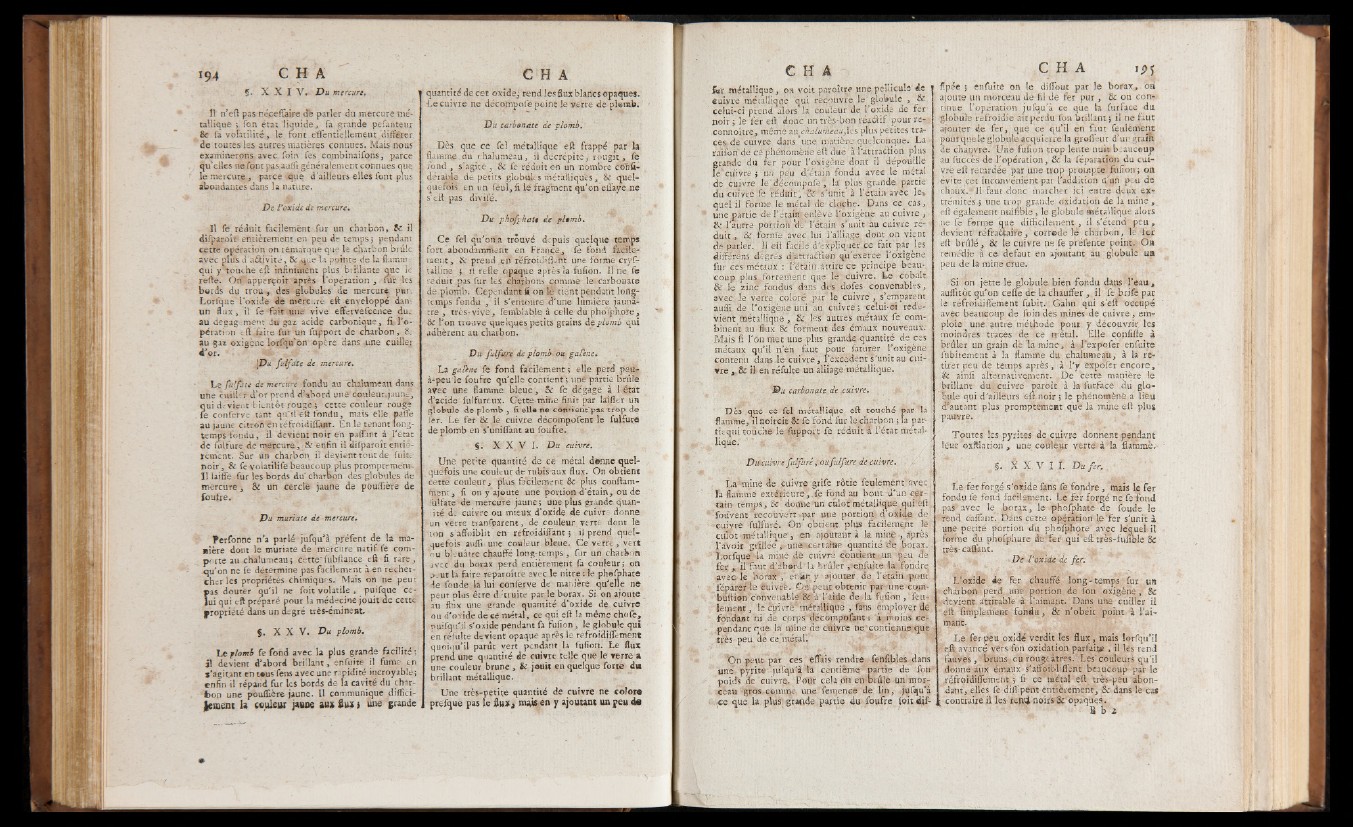
C H A
§. X X I V . Du mercure.
11 n'eft pas nécefïaire dè parler du mercure métallique
; Ton état liquide fa grande pefanteur
& fa volatilité, le font elfentiellement différer
de toutes les autres matières connues. Mais nous
examinerons avec foin fes combinaifons, parce
qu’elles ne font pas auffi généralement connues que
le mercure, parce que d'ailleurs elles font plus
abondantes dans la nature.
De l'oxide de mercure.
Il fe réduit facilement .fur un charbon, & il
difparoît entièrement en peu de temps ; pendant
cette opération on remarque que le charbon brûle
avec plus da&ivité, &: que-la pointe de la flamm :
qui y touche eft infiniment plus brillante que le
refte. Oh apperçoit après l ’opération , fur les
bords du trou , des globules de mercure pur.
Lorlque i'oxidè de mercure eft enveloppé dam
un flux, il fe fait une vive effervefcence du.
au degag-ment du gaz acide carbonique, fl l'opération
eft faite fur un fupport de charbon, &
au gaz oxigène lorfqu'on opère Sans aine cuiller
d'or.
[Du fuifdte de mercure.
Le fulfate de mercure fondu au chalumeau dans
une cuiiLr d'or prend d'abord une couleur.jaune,
qui de vient bientôt rouge.; cette couleur rouge
ïe confefve tant qu'il eft fondu, mats elle paffe
au jaune citron en réfroidiffant. En le tenant longtemps
fondu, il devient noir en paflant à l'état
de fulfure de mercure, & enfin il difparoît entièrement.
Sur un charbon il deyient tout de fuite
noir, & fe volatilifebeaucoup plus promptement«..
Il laiffe. fur les bords du'charbon des globules de?
mercure, & un cercle jaune de pouftièrë de
foufre.
Du munatc de mercure.
Perfonne n'a parlé jufqu'à préfent de la manière
dont le muriate de mercure natif fe comporte
au chalumeau; cette'fubftance eft fi rare,
qu'on ne fe détermine pas facilement à-en rechercher
les propriétés chimiques* Mais on ne peut
pas douter qu'il ne foit volatile, puifaue celui
qui eft préparé pour la médecine jouit de cette
propriété dans un degré très-éminent.
§. X X V . Du plomb.
Le plomb fe fond avec la plus grande facilité ;
2 devient d'abord brillant, enfuite il fume ,en
s'agitant en t»us fens avec une rapidité incroyable;
enfin il répand fur les bords de la cavité du charbon
une pouflière jaune. Il communique diffici- I
Jenaent 1* couleur jaune au» flux > une grande J
quantité de cet oxidej rend les flux blancs opaques.
Le cuivre ne décompofe point le verre de plomb.
Du carbonate de plomb.
Dès que ce fel métallique eft frappé par la
flamme du chalumeau, il décrépite, rougit, fe
fond , s'agite, & fe réduit en un nombre côhfi-
derable de petits globules métalliques, & quelquefois'
en un feul, fi lé fragment qu’on eifaye. ne
s'eft pas divile.
Du phofphatt de plomb.
Ce fel qu'on a trouvé depuis quelque temps
fort abondamment en France, fe fond facilement,
& prend .en rëfroùlifla’nt une forme cryf-
tailine ; fl refte opaque après la fufion. Il ne fe
réduit pas fur les charbons.comme le carbonate
de plomb. Cependant fi on lé tient pendant longtemps
fondu , il s'entoure d’une lumière jaunâtre
, très-vive, femblable à celle du phofph.ore,
& l'on trouve quelques petits grains de plomb qui
adhèrent au charbon.
Du fulfure de plomb, ou gâtent.
La gctène fe fond facilement ; elle perd pëu-
à-peu le foufre quelle contient!uné partie brûle
avec une flamme bleue , 5c fe dégage à 1 état
d'acide fulfureux. Cette mine finit par laifler un
globule de plomb, fi elle ne cohrient'pas trop de
fer. Le fer- & Je cuivre décompofent le fulfure;
de plomb en s'unifiant au foufre.
$. X X V I. Du cuivre.
Une petite quantité de ce métal donne quelquefois
une couleur de rubis-aux fluje. On obtient
cette couleur, plus facilement & plus conftam-
menr, fi on y ajoute une portion d’étain, où de
fulfate de mercure jaune; une plus grande, quan-
ité de cuivre ou mieux d’oxide de cuivre donne
un verre tranfparent, de couleur verte dont le
ton s'affoiblit en- réfroidifiant ; il prend quelquefois
auffi une couleur bleue. Ce verre, ver»
ou bkuâtre chauffé long-temps-, fur un charbon
avec du borax perd entièrement fa couleur; on
p. ut la faire reparoître avec le nitre : le phéfphate
de fonde la lui conferve de manière qu'elle ne
peut plus être détruite par Je borax. Si on ajoute
au fltix une grande quantité d'oxide de cuivre
ou d'oxide de ce métal, ce qui eft la même chofe,
puifqu'ii s’oxide pendant fa fufion, le globule qui
en réfulte devient opaque après le refroidiffement
quoiqu’il parût vert pendant la fufion. Le flux
prend une quantité de cuivre telle que le verre a
une couleur brune , & jouît en quelque forte du
brillant métallique.
Une très-petite quantité de cuivre ne coloru
préfque pas le flux, nuis en y ajoutant un peu de
1er métallique , on voit parpître une, pellicule de
euiy.fi métallique qui recouvre, lé "globule , &
celui-ci prend alors la couleur de l'oxide de fer
noir ; le ter eft donc un tre^bon réaèfif pour
connoîtrè, même au clialumeau3les plus petites traces;
de cuivre dans.*une. matièrequelconque; 'Las?
raifon de ce phénomène eft due à l'attradtipn plus
grande du fer pour Fpxigène dont il dépouille
lévcuivre ; un peu d'étain fondu avec .le métal
de cuivre Je'décompofe ! la plias grande partie
du cuivre fe réduit., & s’unit à- l'étain-avec le»
quel il forme le métal de cloche. Dans ce cas,
une partie de j'ét$irf;enlèvé- Èqxigène au cuivre ,
& l ’atirre portion ’de Fétairt s'unit au cuivre ré- *
duit, ôç fornîe avec lui l ’alliage dont on vient
de parle*. Il eft facil é; d'expli quer'fce fait par J les
differens degrés d’attraèfion qu’exerce j ’oxigène
fur ces métaux : l'etàin attire cè^ principe beaucoup,
plus... fortement que lé Cuivre. Le cobalt,
& le zinc fondus dans dé's dofes convenables,
avec; le verre, coloré .par*' le cuivre 3 s'emparent
auffi.de Foxigène Uni. au cuivré ; celui-ci redevient
métallique , & lés’ autre's ni,éraüx fe combinent
au flux & forment dés émaux nouveaux; j
Mais fi l'on met une plus grande quantité de ces ;
métaux qu'il n’eh, faut pour fatùrer Foxigène ?
contenu dans Je cuivre', l’èxcêdent s’unit au eux- ;;
vre , & ilen réfulte un alliage- métallique.
Du carbonate de suivre.
Dès que ce fel métallique eft touché par ’la ;
flamme, il noircit & fe fond fur le^cfiarbon ; la partis
qui touché ta fupport fe réduit'a l’état métal-f
lique;
Du cuivre fidfurê pou fulfure de cuivre.
\ - > i
La' mine de .cuivre grife rôtie feulement' avec.
la flafemé extérieuréj.fe fond au bout d’un certain
temps, & dotfhe un culot métallique qui*lft;
fouyent recouvert >par une portion d’oxide dej
cuiyre fulfuré. Gn obtient plus facilement lé
citîbx ^métall mue', en ajoutant: à la mine , après:
l’avoir gilUéu ^uné^&rtiine quantité ’dé borax..
Lprfquéfeja miné fflè cuivré éontientAun peu i é
feç ^;îTTaut d’abbfd’ U brûler ^enfuite la; fondre
avec- je borax , enfin y • ajouter de F étain pour,
'réparer Je cuivre. Oit peut obtenir paruneeom-
büftibh'Vbfivenable à l’aide de Ja fufion, ‘ ïèu^i
, fans, employer dé
fondant ni de cprpsT décompôfant j à moiuisl cer
pendant que la mine de cuivre 'ne*contifnne que
tjès-peu de ce'méfalV
lOn peut- par ces efiais- rendre fenfibîes dans
’iinev p’yfite jufqu’à lh c.èntfêmë partie de i-on
jpoid^ de cuivre. Poür cela on en brûle un mor-
cèau gros comme un.e.1 ferqence de lin, jufqu'à
tâjèsf, que la plus; grande partie du foufre ibu diffipée
; enfuite on le difiout par le borax, oa
ajoute un morceau de fil dë fer pur , & on continue
l’opération jufqu’à ce que la furface du
globule refroidie ait perdu fon brillant; il ne faut
ajouter de fer, que ce qu'il en faut feulément
poutquelç globule gcquierre la grofteur d’un grain
de chanvre. Une fufion trop lente nuit beaucoup
au fucces de l’opération, & la féparation du cuivre
eft retardée par une trop prompte fufion'; on
évite cet inconvénient-par l’addition d’un peu de
cHaux.^Il Faut.donc marcher ici entre deux exr
trémités,; une trop grande oxidation de la miné,
eft également nuifible, le globule Haétallique alors
!ne fe ferrpe que difficilement , il s'étend peu^
devient réfractaire, correde le charbon, le 1er
eft brûlé, &c le cuivre ne fe préfente point.- Oa
remédie a ce defaut en ajoutant au globule* ua
peu de lâ raine crue.
Si on jette le globule bien fondu dans l'eau,
auflîtôt qu^on ceffe de la chauffer,. il fe.brife par
le réfroidiftement fubit. : Gahn qui s'eft occupé
avec beaucoup de foin des mines de cuivre, emploie
une autre méthode pour y découvrir, les
moindres traces de ?Cë métal. Elle confine à
brûler un grain de la mine-,; à J ’expofer enfuite
fubitement à la flamme du chalumeau, à là retirer
peu de temps après, à l'y éxpôfer encore, •
$c ainfi alternativement.- De cette manière le
brillant du f cuivre paroît à la furface au globule
qui d’aillèurs eft.noir ; le phénomènè a lieu
cFautant plus promptemeat que là mine eft plus
pauvre.
Toutes les pyrites de cuivre donnent pendant
. leur oxîHation , une couleur vertë à la flamme.
J . X X V I i. Du fer, - <
Le fer forgé s'oxide fans fe fondre, mais le fer
fondu fe fond facilement. Le fer forgé ne fe fond
, pa§^ avec fe bor|X, fe phofphate de foude le
Çfend caftant. Dans cette Opération le’fer s'unit à
une petitë portion du phofphore' avec lequel il
forme du pnofphure de fer qui eft trës-fuüble Ôc
près-caftant.
De l'oxide de fer. r
L'oxide de fe,r chauffé long-temps fur un
f & m m m une portion de fon oxigène, Se
| deyient attirable à. F aimant. Dans une cuiller il
eft fîmplement fondu, & n'obéit: point à l'aimant.
v .Le^fer peu ,pxidé verdit les flux, mais lorfqu'il
B Â avance yëf s fon oxidation parfais , il les rend
fauves , brunsvbu rougeâtres.' Les'couleurs qu'il
donne aux émaux s’affoiblinent beaucoup par 1e
réfroidiftement ; fi cer métal eft très-peu abondant,
elles fe diffipent entièrement! & dans fe cas
; ^ contraire il les ren4 noirs & opaques.
B b 2