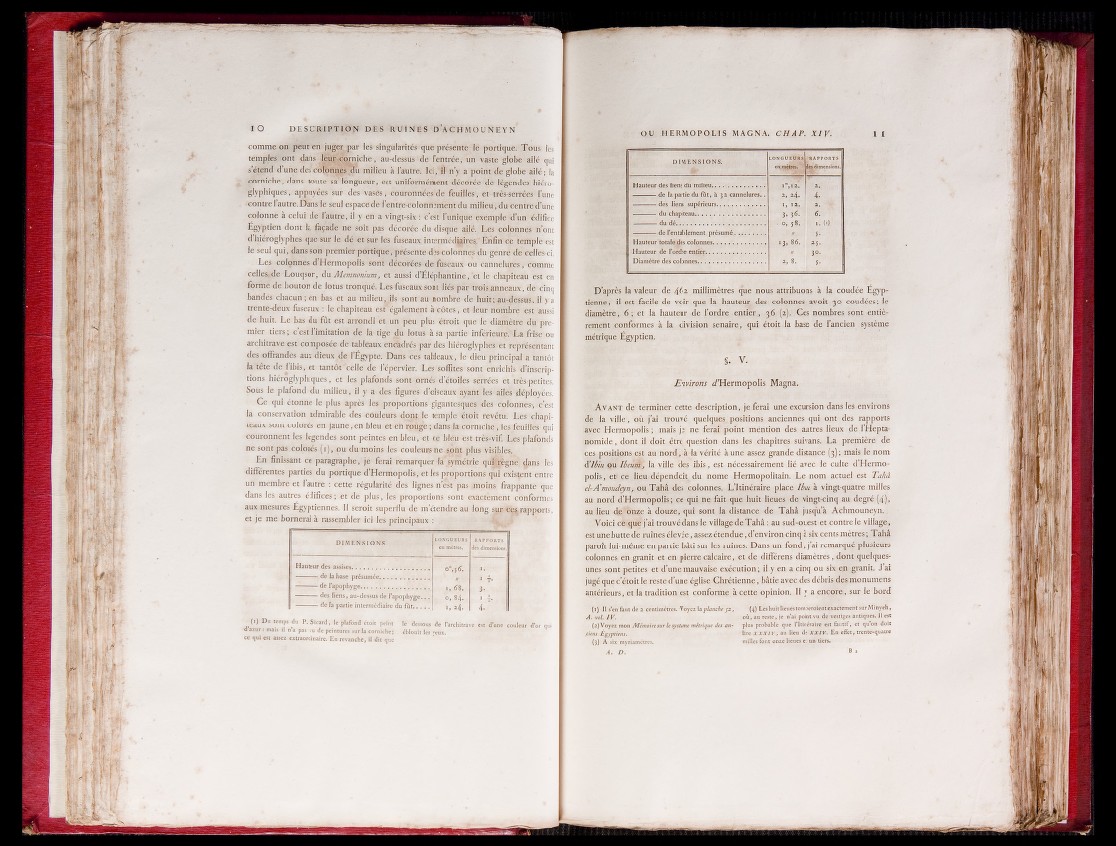
D E S C R I P T I O N D E S R U I N E S d ’a C H M O U N E Y N
comme on peut en juger par les singularités que présente le portique. Tous les
temples ont dans leur .corniche, au-dessus de l’entrée, un vaste globe ailé qui
s’étend d une des colonnes du milieu à l’autre. Ici, il n’y a point de globe ailé ; la
corniche, dans toute sa longueur, est uniformément décorée de légendes hiéroglyphiques
, appuyées sur des vases, couronnées de feuilles, et très-serrées l’une
contre] autre. Dans le seul espace de l’eiifre-colonnement du milieu, du centre d’une
colonne à celui de 1 autre, il y en a vingt-six : c’est l’unique exemple d’un édifice
Égypden dont la façade ne soit pas décorée du disque ailé. Les colonnes n’ont
d hiéroglyphes que sur le dé et sur les fuseaux intermédiaire^.' Enfin ce temple est
le seul qui, dans son premier portique, présente des-colonnes du genre de celles-ci.
Les colonnes d Hermopolis sont décorées de fuseaux ou cannelures, comme
celles»de Louqsor, du Memnonmm, et aussi d’Éléphantine,‘et le chapiteau est en
forme de bouton de lotus tronque. Les fuseaux sont liés par trois jumeaux, de cinq
bandes chacun ; en bas et au milieu, .ils sont au nombre de huit; au-dessus, il y a
trente-deux fuseaux : le chapiteau est également à côtes, et leur nombre est aussi
de huit. Le bas du fût est arrondi et un peu plus étroit que le diamètre du premier
tiers; cest limitation de la tige du lotus à sa partie inférieure. La frise ou
architrave est composée de tableaux encadrés par des hiéroglyphes et représentant
des offrandes aux dieux de lÉgypte. Dans ces tableaux, le dieu principal a tantôt
la tete de 1 ibis, et tantôt celle de l’épervier. Les soffttes sont enrichis d’inscriptions
hiéroglyphiques, et les plafonds sont ornés d’étoiles serrées et très-petites.
Sous le plafond du milieu, il y a des figures d’oiseaux ayant les ailes déployées.
Ce qui étonne le plus après les proportions gigantesques des colonnes«, c’est
la conservation admirable des couleurs dont le temple étoit revêtu. Les chapiteaux
sont colorés en jaune, en bleu et en roüge ; dans la corniche, les feuilles qui
couronnent les légendes sont peintes en bleu, et ce bleu est très-vif. Les plafonds
ne sont pas colorés (i), ou du moins les couleurs ne s.ont plus visibles.
En finissant ce paragraphe, je ferai remarquer la symétrie quKrègne. dans les
différentes parties du portique d’Hermopolis, et les proportions qui existent entre
un membre et 1 autre : cette régularité des lignes n’est pas moins frappante que
dans les autres édifices ; et de plus, les proportions sont exactement conformes
aux mesures Egyptiennes. Il seroit superflu de m’étendre au long sur ces rapports,
et je me bornerai à rassembler ici les principaux :
D IM E N S I O N S .
Hauteur des assises...................................................
■----------- de la base présumée.................................
de l’apophyge............................. ...............
-----------des liens, au-dessus de J’ap ophy ge.. .
---------- de la partie intermédiaire du fût............
( 0 Du temps du P. Sicard, le plafond étoit peint le des!
d azur: mais il n’a pas vu de peintures sur la corniche; éblouit
ce qui est assez extraordinaire. En revanche, il dit que
LONGU EUR S
en mètres.
R A P PO R T S
des dimensions.
de l’architrave est d’une couleur d’or qui
yeux.
O U H E R M O P O L I S M A G N A . C H A P . X I V .
D IM E N S I O N S .
LONGUEURS
en mètres.
RAPPORTS
des^dimensions.
u A V A
-----------de la partie du fû t, à 3 2 cannelures.. 2 , 2 4 . i .
-------------des liens supérieurs................................. I , 12.
3> 36*.
2 .
6.
1 . (■)
-------------de l’entablement, présumé.. ................... Í -
Hauteur totale .des colonnes...................................
Vo
00
rr\
a 5-
u 3° .
2 , 8.
D’après la valeur de 462. millimètres que nous attribuons à la coudée Egyptienne,
il est facile de voir que la hauteur des colonnes avoit 30 coudées; le
diamètre, 6 ; et la hauteur de l’ordre entier, 36 (2). Ces nombres sont entièrement
conformes à la division senaire, qui étoit la base de l’ancien système
métrique Égyptien.
§. v.
Environs 4 ’HermopoIis Magna.
A v a n t de terminer cette description, je ferai une excursion dans les environs
de la ville , où j’ai trouvé quelques positions anciennes qui ont des rapports
avec Hermopolis ; mais je ne ferai point mention des autres lieux de l’Hepta-
nomide, dont il doit être question dans les chapitres suivans. La première de
ces positions est au nord, à la vérité à une assez grande distance (3) ; mais le nom
A'ib'iu ou Ibeum, la ville des ibis, est nécessairement lié avec le culte d’Hermopolis
, et- ce lieu dépendoit du nome Hermopolitain. Le nom actuel est Tahâ
el-Amoudeyn, ou Tahâ des colonnes. L ’Itinéraire place Ibiu à vingt-quatre milles
au nord d’Hermopolis; ce qui ne fait que huit lieues de vingt-cinq au degré (4 ),
au lieu de onze à douze, qui sont la distance de Tahâ jusqu’à Achmouneyn,.
Voici ce que j’ai trouvé dans le village de Tahâ : au sud-ouest et contre le village,
est une butte de ruines élevée, assez étendue, d’environ cinq à six cents mètres ; Tahâ
paroît lui-même en partie bâti sur les ruines. Dans un fond, j’ai remarqué plusieurs
colonnes en granit et en pierre calcaire, et de différens diamètres, dont quelques-
unes sont petites et d’une mauvaise exécution; il y en a cinq ou six en granit. J ai
jugé que c’étoit le reste d’une église Chrétienne, bâtie avec des débris des monumens
antérieurs, et la tradition est conforme à cette opinion. Il y a encore, sur le bord
(1) Il s’en faut de 2 centimètres. Voyez la planche ya , (4) Les huit lieuestomberoient exactement surMinyeh,
A. vol. IV . où, au reste, je n’ai point vu de vestiges antiques. Il est
(2) Voyez mon Mémoire sur le système métrique des an- plus probable que l’Itinéraire est fautif, et quon doit
_ckns Égyptiens. lire X X X I V , au lieu de X X I V . En effet, trente-quatre
(3) A six myriamètres. milles font onze lieues et un tiers.
A . D . B a